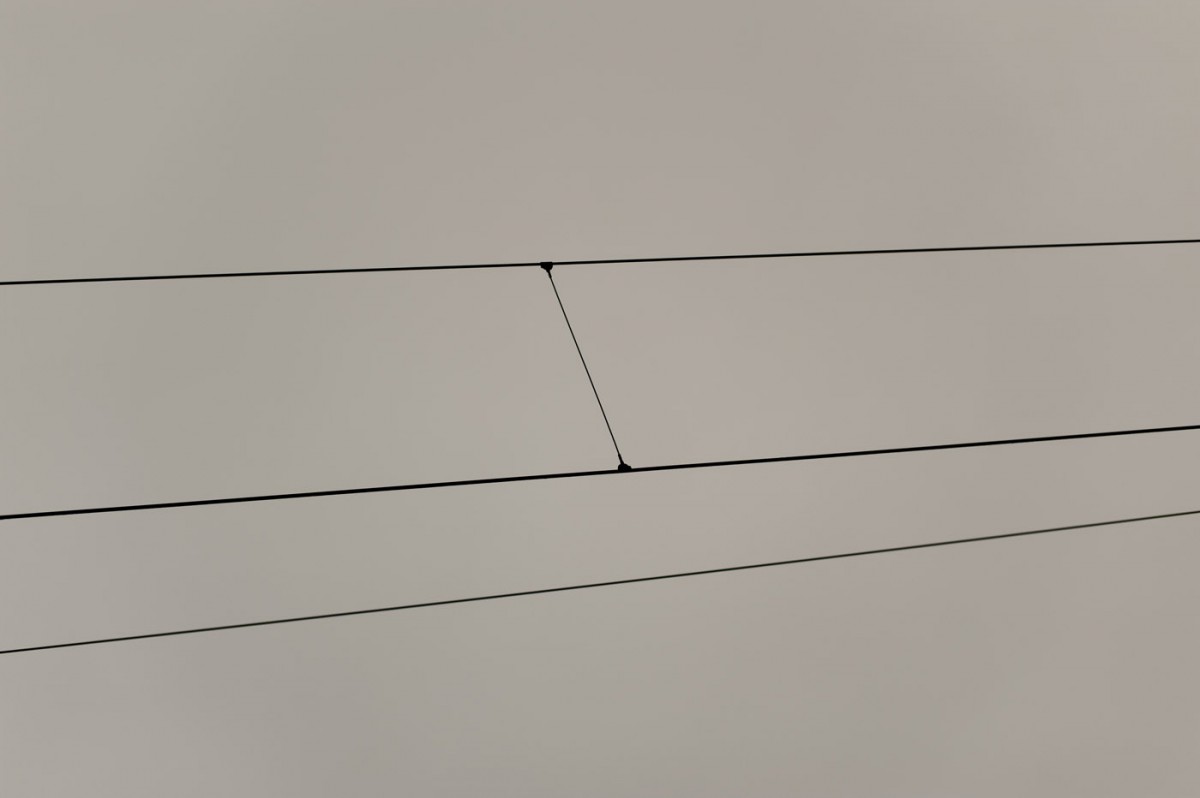Samedi 27 octobre – jeudi 1er novembre 2012
« J’ai habité là », nous dit Suzanne. C’est en effet près de la meule que nous logeons pendant ces belles journées d’automne, accueillis à l’arrivée, comme au départ, par une fraîche coïncidence de grêle.
C’est au Moulin d’Andé que nous sommes, au Moulin d’Andé que l’on s’abandonne, lieu propice aux divagations et au travail, pas de trouble, pas de tâches. Ces jours sont l’occasion d’un autre genre de travail, un travail de construction, de réflexion, l’idée d’un livre de photos du Japon, les images du premier été, l’an passé, le regard neuf, ébloui, ravi, aux aguets, un peu perdu sûrement, ni repère ni habitudes, vingt-trois jours de photographies entre des parenthèses d’avion. Au milieu des photos qu’il faut sélectionner je cherche les mots dans mes carnets (le grand avec les souvenirs encore frais et les collages, le petit avec les croquis et les regards en direct), dans mes souvenirs, dans ce qu’évoquent toutes mes images ou encore dans les écrits de Kawabata. Dans Les quatre saisons de Kyôto, où l’auteur accompagne croquis et peintures de Kaii Higashima, j’apprends les noms des objets (sudare, mushiko, noren…), je découvre l’idée merveilleuse des paysages empruntés, je revois les camphriers majestueux du Shôren-in.
Bref… au Moulin le temps passe aussi dans les promenades. Autour de ce lieu de vie où je parlais d’abandon, l’abandon d’un certain soi-même pour autre chose, autour de ce lieu on utilisera le même mot, des signes d’abandon, l’abandon d’un autrefois pas si ancien, d’une industrie dont il reste des fantômes et quelques activités fragiles au loin. Les feuilles sont roussies, les falaises dominent, le bar-tabac-épicerie est presque le centre de tout, en face c’est Porte-Joie et nous voici, imaginez donc un peu, qui pédalons sur cette Seine au calme apparent. Et les cimetières, évidemment, que, le 1er novembre, d’autres aussi visitent un balai à la main, comme on brosserait un peu les cheveux d’un ancêtre.
Et puis on partage, les repas ou la musique, on fait connaissance, on sourit des tasses disparues, réapparues dans un film puis un autre, on évoque encore ce champignon géant, et l’ombre d’un certain Butterfly virevolte, improbable.
Le soir on se promène, les ombres sont vert-de-gris sous la pleine lune, le chemin plongé dans le noir si celle-ci est nuageuse et puis on regarde un film : Road One de Robert Kramer, Liberté Oléron de Bruno Podalydès, L’Argent de Bresson (Bresson qui dit que « l’art trop préparé ce n’est pas de l’art », Bresson qui me subjugue par des cadrages splendides où des portes s’ouvrent et se ferment comme jamais), L’enfance Nue de Pialat et l’Amour existe du même Pialat, fulgurant court-métrage que j’attends de revoir, et brièvement je note un bout de phrase :
…la fin du travail à l’heure où ferment les musées…
Le dernier jour, juste avant le départ, le fauteuil respire, les ombres vont et viennent sur le tissu rouge, ce rouge qu’on retrouve dans le coin de la pièce sur les livres anciens ou les reliures des Illustration, années 19, 22, d’autres années sûrement encore mais je n’y prête pas attention, trop tard : il est l’heure.
Vendredi 26 octobre 2012
Je ne crois pas que mes années 80 aient été fluos, en dehors d’un énorme machin jaune accroché à la ceinture — mais comment appelait-on cela ? —, d’un porte-clés en forme de skate-board acheté je crois à Seignosse et de quelques scoubidous. Sur scène, ce soir, chez Pompidou, c’était flash-black à la fois dervicho-fascinant (le début) et fesso-barbant (la fin). Les années 80 reviennent et la chenille redémarre ?
Jeudi 25 octobre 2012
Mercredi 24 octobre 2012
Fémis. Déchirés / Grave, film de Vincent Dieutre. Ils miment, imitent, raniment quelques fantômes télé-réels dont j’ignore tout, caricatures, personnages hybrides, enfants inventés de figures emblématiques décortiquées lors d’un workshop. Quelques-uns, deux en fait, sont insupportables, la dernière surtout, je ne crois pas en elle, je ne crois pas à ça, et pourtant elle a existé, des morceaux ont existé, les mots ont vraiment été prononcé, elle est un collage, et ce collage cristallise un sentiment d’exaspération. Dans le taxi qui à la maison nous ramènera, c’est à la raison que tu me ramèneras.
Mardi 23 octobre 2012
Lundi 22 octobre 2012
L’homme très grand, très très grand s’assied en ignorant complètement celui qui, de longues minutes, va être son voisin de banquette. Le vieux monsieur jette un regard ou deux, un vers moi et je lui souris avec un mélange de compassion et de moquerie envers l’autre, là…
Dimanche 21 octobre 2012
J’avais fini l’affiche, j’avais trouvé le truc, un peu gonflé, un peu décalé, un peu hypnotique, ça évoquait le temps et une radicalité graphique vers laquelle j’ai envie de tendre, dans laquelle je me sens plus à l’aise évidemment. Alors on est allés au Bal, enfin, depuis le temps qu’on en parlait. Sur les murs : Paul Graham, entre photographie sociale regardant les années Thatcher avec force et street photography regardant les secondes passer, avec facilité peut-être. Comme il faisait beau ensuite on a marché. Comme il faisait drôle le soir, dans le Podalydès.
Samedi 20 octobre 2012
C’était plutôt pas mal que le film ne soit pas bien. Enfin, je ne sais pas s’il n’était pas bien, c’est peut-être un jugement de valeur un peu hâtif (quoi que 30 minutes, c’est une hâte de tortue nous dirait La Fontaine), mais je sais qu’on en est partis, c’est rare qu’on parte, mais qu’importe, donc c’était plutôt pas mal car on a improvisé une séance de cinéma Ozonienne. Ozon je l’avais un peu laissé de côté depuis quelques films, mais qu’importe, j’avais le pied gauche humide, je ne savais pas pourquoi, ou plutôt par où était entrée l’humidité, par les coutures peut-être. Et l’Ozon donc c’était agréable, un film de samedi après-midi, ni un chef d’œuvre ni l’opposé, un film simple, souriant malgré les apparences et les caricatures, rien de plus. Le soir on a regardé Loulou, un autre genre d’apparence ; du genre tout le temps à poil…
Vendredi 19 octobre 2012
 M.G. est à l’entrée, surprise. Moi, poser ? Il sait bien que j’aime ça, ça m’amuse, je suis presque prêt à presque tout, alors si ça peut rendre service… et puis ça ne sera pas la première fois, hein ?…
M.G. est à l’entrée, surprise. Moi, poser ? Il sait bien que j’aime ça, ça m’amuse, je suis presque prêt à presque tout, alors si ça peut rendre service… et puis ça ne sera pas la première fois, hein ?…
Au Mac/Val, Fabrice Hyber a installé son magasin, son bric-à-brac, ses objets à regarder, à toucher, à enfiler, à utiliser… Et l’objet banal (ou pas) devient quelque chose d’autre (ou pas).
Un tour ensuite dans le nouvel accrochage du lieu, on passe de Cécile Paris à Sarkis (ci-contre, superbe), et le temps d’un verre on retrouve les visages de Nogent, d’Ivry ou d’ailleurs. On dîne à la maison ?
Jeudi 18 octobre 2012
Délicieux est un adjectif ravissant qui prend ses sources dans la délicatesse et se termine en ciel, en rêve… C’est ça, tout à fait ça, c’est tout ça Elisabeth Clark, délicieux, délicat, onirique. Cette fois c’est coloré et ça flotte au plafond d’un sous-sol, c’est fragile, c’est un détail qu’on n’ose pas regarder, quelques mots sur un mur, un joli moment bercé de ce joli accent, moment bref car il faut y aller. Et on a bien fait d’y aller, d’y aller tôt je veux dire, on était si bien placés.
Mercredi 17 octobre 2012
Il me traverse alors l’esprit, dans cette salle sombre du PdT, que je pourrais rédiger un billet sur ce que je suis en train d’entendre. Pascal Rousseau revient, ou plutôt va et vient sur les origines de l’abstraction. Les origines, les prémisses, les balbutiements, la procréation… On passe de Kupka aux toiles futuristes d’une peintre suédoise vers 1860, de Newton à Mondrian en passant par le spiritisme, trois figures style Sécession (hop, je divague un peu et repense à Liège), la représentation du son ou la photographie de la pensée. L’Art nouveau est alors cité en exemple, ses arabesques, ses motifs géométriques, Klimt ou Van de Velde. Évidemment Van de Velde ! … Et c’est là que ça me traverse l’esprti, un billet sur les Chardons mais un vrai billet ne verra probablement pas le jour, une allusion sera peut-être suffisante, voire un simple copier-coller de ce que vous êtes en train de lire, vous avez bien compris que j’étais passé à autre chose, d’autres choses et je n’arrive à étirer le temps. Pascal Rousseau, donc, entamait ce mercredi son cycle de conférences au Palais de Tokyo (http://www.palaisdetokyo.com/fr/conference/attractions-0).
Et alors ?
Passionnant. D’abord que je suis curieux et que sur le sujet j’ai presque tout à apprendre. Ensuite parce que Pascal Rousseau est brillant, captivant, un orateur sans le moindre de ces « heu » qui rognent un discours. La voix est nette, le regard présent, on se demande à quoi servent ces feuilles posées là devant lui. Vivement le 14 novembre pour la suite…
Pour le moment, la suite, c’est ceci et cela, le travail de Damir Očko surtout, oh oui surtout, entre fragilités, envols et graphisme Rodtchenko-esques. On dîne ici ?
Mardi 16 octobre 2012
« Et vous, vous êtes qui ? », me dit-il. Il ne sait pas. Je ne savais pas qu’il ne savait pas, je ne pouvais même pas m’en douter. Alors il me dit « On m’a dit que ». Je lui dis qu’on ne m’a jamais dit ça, que je ne peux pas deviner si on ne me dit pas qu’on dit que. En même temps on n’a pas besoin de me le dire, j’en suis conscient… Bref.
Dimanche 14 octobre 2012
Vendredi 12 octobre 2012
Gare Montparnasse. Applaudissements. Je devine que ça provient des alentours de ce piano posé dans le hall depuis… depuis quand en fait ? Quelques mois ? Je m’approche, on joue à présent une sorte de musique répétitive ; l’acoustique du lieu génère un peu de confusion. Au clavier, ils sont deux, l’un est assis, l’autre est à sa droite. À quatre mains, les regards sont rivés sur eux, une majorité de sourires, sourires heureux ou surpris, surpris parce qu’évidemment ces deux jeunes on ne les imaginerait pas à un piano, avec leurs baskets, leur survêt, leur capuche qui dépasse du blouson en cuir. Celui qui est debout s’éloigne. Sur le tabouret, le pianiste passe à autre chose, une musique qu’on dira pop jusqu’à ce que je la reconnaisse et c’est alors moi qui sourit : Barbie Girl.
Et sinon : toi à Italie, le courrier des lecteurs du Monde où le mariage pour tous montre l’aveuglement de notre société hétérocentrée, la campagne, l’automne, les cèpes.
Jeudi 11 octobre 2012
Clac clac clac clac. Rafale. La photographe n’entend donc pas le bruit qu’elle fait ? Sur scène ils l’entendent, ça les dérange, forcément ça les dérange, toi aussi j’imagine, moi aussi, je m’énerve sur mon fauteuil, je ne comprends pas, puisque sur scène aucun mouvement, un battement de paupière peut-être.
Lumière revenue, on en parle, d’autres lui disent, elle tombe des nues : elle n’a donc pas entendu le bruit qu’elle faisait.
Et aussi : colloque à Fontenay, épaule d’agneau…
Mercredi 10 octobre 2012
En arrivant je n’avais rien senti. Il est probable que ça ne sentait rien. Quelle heure était-il quand on a fait la première remarque ? Moins de 10 h. Ensuite ce fut l’emphase, l’hyperbole : « ça sentait la merde », disait-elle.
Non. Ça sentait l’enfance, les week-ends de vendange ou plutôt les jours d’après, l’odeur provenant du chai quand on passait dans la souillarde, bref : le moût. Les vendanges, ah les vendanges… Je vous ai déjà parlé de la rédaction dans le petit carnet bleu ? Ah oui : le 7 décembre 2009…
NB. Hep toi le grand redskin avec ton total look, c’est pour nous offrir un peu de tendresse en supplément de ta tête de grand gentil que tu fais dépasser de ta manche le grand coeur rose accroché à un bracelet ?
Mardi 9 octobre 2012
 Trois carcasses en survêt’ rappent devant une foule nippée bien autrement. On ne distingue même pas une casquette sur la tête d’un spectateur, mais on a l’habitude de se décoiffer en tel lieu. Un argot américain distille un flot de syllabes que je capte à peine. Lorsque ce petit show qui terminait le court métrage s’achève, le réalisateur du dit court se lève, pointe le doigt en l’air, vainqueur d’on ne sait quoi. La modestie est piétinée par ce doigt, cette moue, cette attitude. Pourtant c’était plutôt beau, ce bleu, la voix de Charlotte R…
Trois carcasses en survêt’ rappent devant une foule nippée bien autrement. On ne distingue même pas une casquette sur la tête d’un spectateur, mais on a l’habitude de se décoiffer en tel lieu. Un argot américain distille un flot de syllabes que je capte à peine. Lorsque ce petit show qui terminait le court métrage s’achève, le réalisateur du dit court se lève, pointe le doigt en l’air, vainqueur d’on ne sait quoi. La modestie est piétinée par ce doigt, cette moue, cette attitude. Pourtant c’était plutôt beau, ce bleu, la voix de Charlotte R…
Lundi 8 octobre 2012
Elle se dit que c’est encore un peu l’été. Elle porte donc une robe très courte à l’imprimé improbable, un mélange de panthère et de camouflage aux couleurs d’automne. Des talons hauts bien sûr. Elle vérifie dans la vitre, sombre sous le tunnel, que sa permanente tient bien ; elle y passe un peu ses doigts avant d’arriver à Nation. Alors elle se lève, tenant d’une main ferme son petit sac noir et un sac plastique multicolore de chez Pylones. J’en suis à la page 25, il fait beau, Blanche a donc saisi une ombrelle en cretonne imprimée à carreaux. On vient de déclarer la guerre dans ce 14 d’Echenoz. La veille aussi, la même déclaration de guerre, dans Downton Abbey, avait suscité l’émotion ou l’enthousiasme, c’est selon. Après le Riboulet ou le Bozon, cette fichue guerre était décidément au coeur de notre rentrée culturelle.
Dimanche 7 octobre 2012
– Il n’est pas assez cuit le riz.
– Oui mais j’aime le risotto un peu croquant.
Samedi 6 octobre 2012
Il y a 18 mois, nous avions déjeuné dans un bouiboui du Marais, ce n’étais pas fameux je crois, mais c’était sans importance puisque alors on se retrouvait après des années sans se voir, peut-être douze. On avait évoqué nos vies, toutes les années passées, loin, pas si loin : c’est un mouchoir l’Europe. Ce samedi Virginie terminait une laborieuse semaine parisienne, et j’avais mieux choisi le lieu, La Fresque, service amusé et cuisine simple et efficace. Je crois que moi-même j’étais plus rieur que la fois précédente, durant ces deux heures conclues par une évidence : au printemps on verrait Munich.
Après le déjeuner, prévoyant que le soir on trinquerait encore, je partais à la recherche de verres à vin dignes de ce nom ; ils nous offriraient plus de parfums que le pourtant joli service étoilé qu’on aime tant. Autre parfum, celui de l’encre, me voici dans les rayons, les tranchées par Echenoz, le Mexique par Plossu, Venise par Gautier, le japonais aussi puisque je ne lâche pas le morceau, courageux dites-vous…
Le soir, un peu grisé, je repasse au présent, ils sont là, soudain on rêve de Venise en janvier, j’imagine la brume, le froid, sorte de folie romantique et photogénique ; as-tu des bottes, toi ?
La nuit enfin, Fanny Adler et Vincent Madame illuminent un recoin de Nuit Blanche de leurs voix que j’aime tant, de leurs textes qui frappent, tout droit venus de petites annonces amoureuses, perdues, éperdues, attendues, tendues, arquées, osées, claires, nettes, précises. Photo du spécimen contre un timbre.
Vendredi 5 octobre 2012
Cave à vin, chéri ; Kawase, Chiri.
Jeudi 4 octobre 2012
Et si on passait au salon ?
Mercredi 3 octobre 2012
 Parfois, derrière l’un d’eux, une feuille passe. Il y a celui qui hésite, fébrile. Il y a celle qui lit, presque froidement. Ceux qui décrivent. Celles qui racontent. Celui qui impose. Celui qui a la même couleur de veste que toi. Celui qui me fait éclater de rire. Toi que j’aimerais écouter encore. Parfois on a envie de lever la main, d’interpeler, faire remarquer. Mais ils ne sont pas là, ils sont sur l’écran, et je les écoute, même si évidemment parfois je divague. D’ailleurs qui a dit « Le son est une dimension de l’image » ? J’ai noté la phrase mais…
Parfois, derrière l’un d’eux, une feuille passe. Il y a celui qui hésite, fébrile. Il y a celle qui lit, presque froidement. Ceux qui décrivent. Celles qui racontent. Celui qui impose. Celui qui a la même couleur de veste que toi. Celui qui me fait éclater de rire. Toi que j’aimerais écouter encore. Parfois on a envie de lever la main, d’interpeler, faire remarquer. Mais ils ne sont pas là, ils sont sur l’écran, et je les écoute, même si évidemment parfois je divague. D’ailleurs qui a dit « Le son est une dimension de l’image » ? J’ai noté la phrase mais…
Sinon Labarthe a dit qu’avec les jumelles de théâtre, le spectateur est devenu acteur de ce qu’il voyait. C’est pas mal cette idée, faudra que je la replace. À la cantine ça va faire son petit effet.
Mardi 2 octobre 2012
En partant, le matin, je ne prends pas mon appareil photo. Trop lourd, ça suffit pour une fois… De toute façon à quoi ça sert ? Avec moi, Le Seul Visage, d’Hervé Guibert, recueil photographique qui rend presque vaine toute autre image.
Lundi 1er octobre 2012
Two Gates of Sleep.
Regarder un film avec un titre pareil à une heure tardive est évidemment la porte ouverte à quelques évidences… Néanmoins je n’ai pas compris le rapport entre le film et son titre, même à la fin (vue le lendemain, vous pensez bien…)