
Dimanche 10 janvier 2021



Le présent n’existe pas. Le film a commencé il y a une vingtaine de minutes et le sous-titre affiche cette phrase : Le présent n’existe pas.
Nostalgie de la lumière est un film que, depuis longtemps, je devais regarder. Depuis sa sortie peut-être. Dix ans. Je ne suis pourtant pas tout à fait attentif depuis le début du film, car il y a quelques échanges avec D, notamment. J’ai beau dire ou écrire que le cinéma est une compagnie, il y en a d’autres. Même si elles n’offrent que rarement la poésie de ce sous-titre et de sa version en langue espagnole, elles offrent d’autres souffles, une attention.
Revoici, dans ce film, par ce film, le Chili, ce pays de là-bas. Revoici le désert, celui d’Atacama, au nord, cette étendue sèche dont je n’ai arpenté que ce que la ville d’Arica nous en offre : sa poussière, sa sécheresse. Je disais l’autre jour à ma sœur que je n’avais rien fait des images, qu’elles pourraient rejoindre le livre. Mais je ne sais pas.
Or, justement, là derrière moi il y a cette image, cette façade derrière un mur ocre, photographiée là-bas. Je l’ai récupérée en fin après-midi, après que nous avions bu un vin chaud et mangé une gaufre avec P ; elle est posée par terre, recouverte d’un poids pour réduire la courbe du papier. Elle sera bientôt, peut-être demain, accrochée au mur, en remplacement d’un de ces corps japonais qui, depuis 2011, me suivent.
Tu m’avais justement dit quelque chose sur tous ces gens accrochés aux murs tandis que tu étais chez moi. Peut-être avais-tu dit que c’était impoli, qu’ils te tournent le dos, je ne sais plus, ou c’était agaçant, je ne sais plus j’avais ri, et pourtant il y avait une part de sérieux dans cette remarque. C’est assez vertigineux de réaliser que cela va faire 10 ans que ces gens me suivent.
Je vais donc remplacer des collégiennes marchant rapidement par un trottoir. Je vais remplacer des mouvements par l’immobile, leurs rires par un mur, des respirations par une rigueur, passer du temps court au temps long, du furtif à l’infini, comme si le présent d’alors s’étendait jusqu’ici. Même s’il n’existe pas.

Va voir ailleurs si j’y suis. Ce que la langue formule là est prodigieux, et la méthode imparable. Mais la logique sait l’être aussi : et si l’enfant à qui nous donnons ce conseil, lui-même d’emblée de plain-pied dans le registre des mots qui est encore pour lui aussi celui des choses, revenait de sa quête en nous disant que, en effet, il nous a trouvés, et que nous sommes aussi ailleurs, alors où serions-nous ?
::: Mathieu Riboulet ; Nous campons sur les rives.


Peut-être qu’alors il y aurait des jours silencieux.
Simone Weil disait que Karl Marx lui était cher, mais qu’elle aimait mieux encore la vérité. À qui raisonne comme elle, ou comme Walter Benjamin, ou comme Georges Bataille, ou comme Pier Paolo Pasolini, ou comme Jean Genet, ou comme Marguerite Duras, à qui cherche la vérité au-delà du vraisemblable idéologique, dans l’articulation toujours périlleuse des idées et de la vie sensible, à qui risque sa pensée à l’intersection de soi et du dehors, à l’endroit où vivre dans ce monde est une blessure, la tâche de l’époque serait de commencer à décrire les lieux de la cité et les habitudes de la société qui, en œuvrant pour l’uniformité du monde, hâtent la venue de la fin.
::: Olivier Cheval – Dernière leçon sur le confinement ; Lundi matin
Tu fumes une dernière cigarette. Il fait froid, alors je t’ai dit de fumer à l’intérieur. Tu me remercies, pour tout. Tu dis qu’il y aura eu des rigolades, des engueulades. Et nous sourions de nous.
– Comment on dit gentiment « Ferme ta bouche. » ?
– On ne le dit pas.
– Pourquoi il y a une chaussette en boule par terre, là ?
– Mmmm… Parce qu’il y a l’autre un peu plus loin derrière.
Alors je ris.

Pour la troisième année consécutive c’est ensemble que nous célébrons ton anniversaire. À chaque fois c’est différent ; cette fois, toute la journée nous sommes ensemble, puisque tu es là. Je creuse dans les souvenirs pour en puiser un sens, une formule, une joliesse, ce que cela dit de nous. Il y avait, il y a deux ans, une certaine folie née de cette solitude que tu refusais, puisque cet autre que tu avais choisi ne t’accompagnait pas. Il y avait, l’an dernier, une certaine folie née de ces accoutrements que l’on revêtait, puisque cet autre que toi était dans le miroir. Quelle forme de folie cette année ? Peut-être, juste, un petit grain, née de bulles à quinze heures.

Je m’étais demandé comment exprimer, cette fois-ci, des vœux. Comme F me l’exprimera pour lui-même, je n’étais pas très inspiré. J’avais bien pensé prendre des morceaux de visages, ceux qui me sont chers, ceux que j’espérais revoir, et n’en faire qu’un. L’idée était un peu naze mais cela aurait eu du sens, rejoignant en image ce que je disais hier. Mais surtout le résultat risquait d’être moche, vraiment moche.
Alors à la place, j’ai essayé le beau. Ou quelque chose qui s’en approche, par en quelque sorte une représentation objective de la beauté : une pivoine. Vous connaissez quelqu’un qui trouve ça moche, une pivoine ? Au pire certains trouveront ça ringard. J’assume.
La fleur avait un avantage certain, je pouvais la faire parler. Selon le destinataire, la fleur ainsi transformée viendrait souhaiter une année colorée, de la légèreté, le parfum délicat d’une peau, de la douceur telle celle d’un pétale, un peu de fragilité peut-être pour donner un peu de sensibilité à nos vies, et puis du silence. Beaucoup de silence. Celui qui nous laisse en paix. Celui qui fait taire les commentateurs. Et celui qui englobe, comme des bras, les voix de ceux qu’on aime, ou comme la nuit, leur souffle qui nous manque.

Est-ce immuable ? Faire un bilan le dernier jour ? Regarder derrière pour peut-être mieux voir ce qui nous attend devant, ou ce que l’on souhaite. Mais non, pour cela c’est inutile : oh l’on sait déjà ce que l’on espère pour les lendemains, quel que soit le jour du calendrier.
Regarder derrière, tout de même, pour rendre hommage. 366 jours, tout de même ! Voir les moments intrépides, les ciels dégagés, et les douleurs des autres. Chercher à sourire des épreuves, des traversées immobiles et cloitrées. Penser à vous. Ici combien de fois vous ai-je parlé ? Si l’on me demandait quel souvenir de 2020 j’aimerais emporter sur une île déserte, serait-ce ces mots avant d’entrer chez le coiffeur, ou cet inattendu dans un couloir d’hôtel, ou cette heure apaisée à parler de nous, ou cette seconde où l’on sait qu’il n’y en aura pas d’autres, ou cette main qui remonte des cheveux et qu’un sourire subsiste sur une image floue, ou la tête que tu penches à peine, ou ton regard comme ça presque sévère, ou ta main qui désigne ce chemin de croix au creux du crépuscule. Puisque malgré cette année de distance, de silence, d’attente et de solitude, j’aime à penser à vous et aux autres, j’aime à me dire que la solitude n’existe pas. Et tandis que le dernier soleil décline, dans cette langue dont je ne sais rien, tu es là qui chante l’amour.
– Arnaud, merci pour tout ce que tu as fait pour moi.
– Oh ce n’était rien.
– Oui, ça c’est vrai.
– (Rires)
Alors le continent indien s’invite dans la cuisine.



Il y a, sur la table basse où l’on a préparé l’apéritif, trois objets empilés : une boîte de chocolats, surmontée d’une chemise bleue à élastiques, sur laquelle est posée une bouteille de jus de yuzu emballée dans une page de magazine de photographie sur laquelle l’image est belle. La chemise bleue contient une cinquantaine de feuilles, imprimées recto-verso. Sur la première, il y a mon nom et un titre : « Ce lieu de l’absence de nous.«
Enfin, en ce 24 décembre 2020, je dévoile à mes parents, et bien sûr d’abord à mon père, le livre que j’écris sur mon grand-père, Antonio, que je n’ai pas connu, réfugié espagnol en 1939 lors de la Retirada, naturalisé Français en 1949 et mort en 1965 d’un accident du travail sur le pont du Garigliano. Ce récit n’est pas qu’une histoire, c’est mon histoire et celle de ma famille. Ici, dans cette centaine de pages, je vais au-delà des faits, je creuse ce que questionne dans ma vie la présence de ce grand-père. Je sais que ce que j’ai reçu de chacun de mes grands-parents – que l’on pourrait regrouper dans une valeur fondamentale : le respect – a été essentiel dans l’homme que je suis aujourd’hui. Mais la vie d’Antonio m’emporte ailleurs, sur des terrains guerriers et héroïques, dans des bateaux et des camps de détention, dans des photos longtemps inconnues et, puisque nous avons un courrier de 1940 qui précise qu’il est accepté comme réfugié au Mexique, m’emporte de l’autre côté de l’Atlantique. Et s’il était parti ?
Alors, voilà, pour Noël, j’ai offert à mes parents et à mes sœurs quelque chose d’un cadeau : ce qui nous rassemble. S’il était parti, nous ne serions pas là, nous ne serions pas nous.

Il est 19h48, j’ai enfin le vague sentiment d’être en vacances même s’il faudra pour l’être vraiment se détacher du travail. Soudain, il y a ce petit bruit qui signale un message : « Tu me manques bcp. » Je suis touché. Je te réponds immédiatement, te propose que l’on se voie la semaine prochaine. Les mois ont passé. Trois, presque. La dernière fois, tu avais écrit quelque chose de joli, déjà : « Ça m’étrange quand quelques jours passent et que tu ne m’adresses plus la parole.«
« Ça m’étrange« . Je ne savais pas si tu avais fait une faute de frappe, étranglé, ou si ton français, pourtant très très bon, avait commis cette irrégularité poétique. Le verbe, étranger, du premier groupe, nous offrirait alors l’idée que sans mes mots tu ne serais plus toi-même. Il rejoindrait alors cette difficulté que nous avions eu d’être toi-même et moi-même, notamment un soir de printemps, chez J, ensemble. Il rejoindrait cette idée qu’on n’est plus tout à fait soi-même lors d’une rencontre et cette contradiction qu’on ne l’est plus non plus sans l’autre.
J’avais, déjà, alors, proposé que l’on se voie la semaine suivante. Cela n’avait pas eu lieu. La proposition avait perdu, je suppose, contre mon envie d’être seul que je t’avais aussi exprimée. Est-ce que cela m’avait étrangé ?

Les mains de Joseph sont posées à plat sur ses cuisses. Elles ont l’air d’avoir une vie propre et sont parcourues de menus tressaillements. Elles sont rondes et courtes,des mains presque jeunes comme d’enfance et cependant sans âge. Les ongles carrés sont coupés au ras de la chair, on voit leurépaisseur, on voit que c’est net, Joseph entretient ses mains, elles lui servent pour son travail, il fait le nécessaire. Les poignets sont solides, larges, on devine leur envers très blanc, charnu, onctueux et légèrement bombé. La peau est lisse, sans poil, et les veines saillent sous elle.
::: Marie-Hélène Lafon ; Joseph
Comme d’autres fois, je me dis que c’est le matin qu’il faut venir, pour voir le soleil frapper l’autre rive, puisque j’ai traversé. Ici ou là, la boue, brille sous mes yeux ou se colle sous mes pieds. J’essaye de regarder autrement le décor d’un paysage qui va entrer dans l’hiver. J’ai osé, pour changer, un objectif 85mm, celui-là dont le grain peut faire des merveilles quand des visages sont devant lui et que la mise au point, manuelles, a bien voulu être précise là où on le souhaitait. Ici, alors, j’essaye de remplacer les visages, le leur, le vôtre, le tien. Mais est-ce possible ?

Nous marchons. C’est presque devenu un rendez-vous, même si nous en avons tant. Tu me dis que je t’ai fait pleurer. Je te dis que j’espère bien et je souris doucement ; le temps aussi est à la pluie.
Je ne lui demande pas si elle accepterait d’être ici, dans mon journal. Je n’y pense pas. Il y aurait, sinon, cet éclat de rire dans une veste orange, lumières devant un ciel gris.
La nuit tombe.
J’entre dans mon appartement où il n’y a personne. Il fait froid aujourd’hui pour une fin d’avril. Il est déjà 8h. J’ai faim. En préparant une salade, je réchauffe le curry, restant d’hier. Installée à la petite table dans la cuisine, je commence mon dîner tardif. Je n’entends que le tic-tac de la pendule. C’est samedi. Mon fils, chez son père depuis hier, reviendra demain soir.
::: Aki Shimazaki ; Suzuran
Nous nous retrouvons en bas ; j’ai deux ou trois minutes de retard, encore les yeux un peu humides d’exaspération. Tu me dis « mon compagnon » dans cette réponse à ma question sur la raison de ta venue dans cette ville. Je ressens alors un petit quelque chose : cela me fait plaisir pour toi. Sincèrement. Nous n’en reparlerons pas ; plus tard vous serez au bord de la mer. Nous n’en reparlerons pas mais il n’est pas impossible que cela explique l’aisance que j’aurai par la suite, comme libéré de nous, d’une certaine manière, même si ce ne sont que des mots, peut-être mal choisis. Et puis nous voilà chez moi. Tout au long du repas, je n’arrive pas à intégrer le fait que non, tu n’es jamais venu ici. Je crois que nos années de vie commune en sont la raison, chez moi serait encore forcément chez toi. C’est étrange. Parfois, alors, je dois te sembler bizarre, mais d’abord tu m’offres ce livre. Je n’avais pas pensé à cela, t’offrir quelque chose puisque bien entendu c’est la période. À croire que j’avais oublié combien tu y tenais, à ce genre de petites attentions et combien tu en étais, plus souvent de que moi, l’auteur. Cela ne m’a pas effleuré, peut-être parce qu’il y a cette distance que tu mets dans les mots. Toujours tu m’écris « Bonjour », comme si la solennité était ce qu’il restait de nous, mais ce n’est là qu’une option parmi tant d’autres. Cela ne m’a pas effleuré et tu as pu penser que cela ne t’étonnait pas : cela me ressemblait bien.

Et puis parfois il n’y a rien d’autre à regarder que cette ville.

Alors, pour la première fois peut-être depuis que j’ai cet emploi, qui parfois m’offre de la satisfaction, j’éprouve un immense plaisir : celui d’écrire sur des images. Puis je répète les mots. Demain je les dirai.

À mon sens, connaître notre nature humaine est donc essentiel. Et cela passe forcément par l’enseignement de l’incertitude. On se rend compte aujourd’hui qu’il y a des phénomènes qu’on ne peut pas contrôler, y compris dans des disciplines comme la micro-physique. On est certain de sa mort mais on ne sait pas quand elle va arriver. On se marie, on pense qu’on va être heureux, mais ce peut être un mariage épouvantable. On cherche du travail sans être sûr d’en trouver… La certitude fait partie du destin humain, mais nul n’est préparé à l’affronter. À mon avis, la réforme de l’enseignement dois d’abord aller dans ce sens.
::: Edgar Morin.
Il y a, dans mes projets d’écriture, un abécédaire. A la lettre A, il y aurait probablement l’un de vous deux.
Toi qui es assis là, dans la joliesse coordonnée de ces couleurs qui t’habillent et qui recouvrent le canapé. Tu vois, en d’autres temps, j’aurais écrit ce que ta présence disparue me procure, lors des jours sans rien ou lorsque, comme ici, te voilà. Dans mon abécédaire, tu dépasserais peut-être tout le monde, pour cette place que tu as eue, ce truc qui se produisait, là, dans la cage thoracique surtout. Mais aujourd’hui, tu vois, je raconte tes couleurs. La dernière fois déjà, c’est de celle de ton pantalon que j’avais parlé ; mais encore je t’aimais tant.
Toi qui viens plus tard, et qui m’offre ton aisance à poser ainsi, bien vite sans ce tee-shirt trop ample qui cassait trop de lignes, toi qui m’offre surtout ainsi une heure, une heure qu’il me faut pour te regarder, te tourner autour, déplacer la lumière, puisque je ne sais pas, puisque je n’ai jamais fait cela, ni jamais, ainsi, reçu autant de patience et de temps, reçu autant de légers mouvements de tête auxquels on peut répondre « Ne bouge plus !« , reçu autant de mystère lorsque ton visage se ferme, reçu autant de joie que celle que tu exprimes en voyant les images.

J’ai montré, cet après-midi, à P, des photos de toi. Mais il est déjà tard lorsque c’est ta voix qui réapparait, sur un enregistrement sonore nommé « plage ». Nous étions le 4 septembre, il était 15h43 lorsque j’avais commencé à enregistrer la musique que tu passais ; puis il y avait eu ta voix, tes questions, tu me demandais par exemple quelle était ma chanson préférée, c’est-à-dire celle que je pourrais écouter toujours, je t’avais répondu que c’était La Question, de François Hardy. A 15h55, j’avais mis fin à l’enregistrement, il était l’heure d’aller nager, disais-tu.
Vendredi, je t’avais dit que je pensais tout le temps à toi, parce que les objets que tu avais fabriqués étaient toujours là, quelque part sur moi ou près de moi. Je savais qu’à tout instant, tu pouvais être là. Ainsi, encore.

Dans cette boutique étroite, où l’on s’interroge sur les distances que l’on devrait appliquer, où l’on se dit que les règles sanitaires disparaissent sous l’accueillant moelleux d’une écharpe en laine péruvienne, il y a surtout ses yeux, brillants, clairs, ceux-là mêmes que je n’avais jusqu’à présent vu qu’à travers quelques images sur quelques réseaux sociaux. Dans cette boutique, il n’y a que ces yeux : le masque s’impose sur son visage. J’y décèle pourtant, soudain, son sourire.
Je te dirai plus tard que j’étais heureux de ce moment avec toi, toi qui connaissais ses yeux. J’étais heureux parce que cela reprend et rejoint ce que j’écrivais l’autre jour, à savoir l’idée du faire, et surtout du faire ensemble, comme nous l’avions expérimenté dimanche. Je comprends qu’être, et son extension grégaire et amicale être ensemble ne me suffit pas en ce moment. J’oserais presque dire que cela ne m’apporte rien si ces mots ne risquaient pas d’être mal interprétés. L’être ensemble ne donne que du dire et je crois que j’ai besoin parfois de silences. Peut-être pour mieux apprécier les miens.
Bien sûr, ensemble, après être sortis de cette exiguïté aux tentations multiples, nous parlons. De lui par exemple, ses yeux bien sûr. Du matin souriant. De nous. De demain. Des passants. Des instants et de ce qu’ils valent. Et encore nous parlerons puisque je t’appellerai un peu plus tard après que tu auras préféré rentrer chez toi. Je t’appellerai pour revenir sur tes mots qui avaient été suivis de mon silence. Je m’en voulais. Ou plutôt, sur le moment, je n’avais pas su quoi dire et puis le flots des phrases avaient recouvert cela. Chez moi les mots étaient remontés à la surface. Comme rarement, j’avais alors senti la nécessité d’un appel et, dans la nécessité de cet appel, ce que nous sommes, toi et moi, l’un pour l’autre.
Alors encore nous avons parlé. D’être.

Je me suis souvenue de ce texte de Marx sur l’aliénation, dans les Manuscrits de 1844, et surtout sur l’incurie ; le manque de soins que les individus s’infligent à eux-mêmes et aux autres quand les valeurs ne guident plus le monde : « L’homme retourne à sa tanière, mais elle est maintenant empestée par le souffle pestilentiel et méphitique de la civilisation et il ne l’habite plus que d’une façon précaire, comme une puissance étrangère qui peut chaque jour se dérober à lui, dont il peut chaque jour être expulsé s’il ne paie pas. Celle maison de mort, il faut qu’il la paie. […] La saleté, cette stagnation, cette putréfaction de l’homme, ce cloaque (au sens littéral) de la civilisation devient son élément de vie. L’incurie complète et contre nature, la nature putride devient l’élément de sa vie. » Cette phrase, « cette maison de mort, il faut qu’il la paie », cette phrase terrible, qui pue l’injustice, l’arbitraire, la force sûre d’elle, de son abus, cette phrase a tapé dans ma tête.
::: Cynthia Fleury ; Le Soin est un humanisme
L’Espagne est désormais une énorme tache de sang que les singes de la sagesse ne parviendront jamais à absorber, malgré tout le sable du monde. Et, au pied des Pyrénées, la mort n’est plus enchâssée dans une tapisserie de l’homme, de l’animal et de la cape sur un métier à tisser de l’ombre avalant lentement le soleil.
::: Jay Allen ; Préface de « La mort en marche« , de Robert Capa
Alors il me fait entrer dans son univers fascinant, où les femmes célèbres sont parées de parfum et d’effets Photoshop.


– Il y a déjà de la neige sur le mont Fuji. C’est bien de la neige, n’est-ce-pas ? demanda Jirô.
Utako regarda elle aussi le Fuji par la fenêtre du train.
– En effet. C’est la première neige.
– Ce ne sont pas des nuages, c’est bien de la neige, c’est-ce-pas ? insista Jirô.
::: Yasunari Kawabata ; Première neige sur la Mont Fuji
Il est l’un de ces caissiers qui travaillent au Super U. J’y vais souvent, au Super U. D, non, il n’y va pas, il n’aime pas, il trouve que c’est sale. J’y achète presque toujours la même chose, les achats sont mécaniques. C’est un peu partout pareil, mes achats sont mécaniques lorsqu’il s’agit de manger. La même pizza à la mozza et au pesto, les mêmes raviolis aux cèpes, la même tablette de chocolat, le même café, le même lait d’amande, les mêmes desserts chocolatés. Au Japan Market idem, mécanique, les mêmes edamame, les mêmes gyozas… oh parfois j’hésite ici ou là. À la Recharge, mécanique encore, les mêmes pommes, le même muesli, le même vin, le même gâteau basque lorsque ils en ont, c’est une tuerie, nous en avons ri avec la vendeuse samedi, j’ose toujours dire que cela devrait être interdit, ce truc. Au marché, mécanique aussi, les mêmes étals, les Portugais du 47, le fromager pour son Saint Marcelin, un coup d’œil chez le Grec… Oh parfois je flâne un peu mais est-ce que je regarde vraiment ?
Bref, je disais quoi ? Ah oui le caissier. Je crois qu’il ne travaille pas ici depuis longtemps, il est très jeune, il a les cheveux décolorés, carrément blancs, est-ce possible ? Je paye (pizza, raviolis, chocolat, lait d’amande…). Et alors il me dit : « J’adore vos habits. Comment c’est assorti. » Je le remercie, je souris. C’est tout. Je ne dis rien de plus. Mon esprit est déjà ailleurs : je pense au mot habits. C’est étrange, ce mot, là, dans sa bouche sous le masque. Un peu désuet.
Le caissier, il ne sait pas les images du matin. Personne ne saura les images du matin. Personne ne peut les voir. Elle montre peut-être ce qu’il y a de plus beau, parce que de plus sombre en toi.

Nous nous étions amusés hier d’une métaphore bricoleuse, et de ces schémas presque enfantins qui accompagnent les meubles de cette marque pour laquelle tu travailles peut-être ou peut-être pas. Dans ce mystère qui t’entoure, il y a donc aussi des rires, et aujourd’hui encore, puisque te voilà donc.
En d’autres occasions, j’aurais peut-être fait semblant de rien, je n’aurais rien dit de toi, j’aurais laissé traîné une image, le grain d’une peau tenant ton appareil photo, et j’aurais divagué sur la matinée passée entre amis, à la recherche d’un mobilier en rupture de stock. Certains en voyant l’image se seraient demandé si… Pourtant, je sais que, dans ce que tu as d’inatteignable, je peux tout dire. Il n’y a aucun défi à relever. Il n’y a pas l’attente du mot du lendemain, ou plutôt elle n’a pas le goût que j’aurais sans doute aimé qu’elle ait, ce goût qu’elle a avec D peut-être en ce moment.
Il y a les reliefs d’un partage qu’ici j’ai déjà envie de mettre en exergue, puisque nous nous sommes dit qu’il y aurait peut-être, à l’horizon, une amitié entre nous. C’était amusant et joli, de se dire cela, de prévoir ce que cela pourrait donner. On pourrait lire cela dans des carnets d’adolescents, ne crois-tu pas ?
Alors me voici sur tes images. C’est là que quelque chose se produit. Tu cherches sur moi quelques détails que je n’aime pas vraiment, puisque ce sont les traces du temps qui s’est installé, les traces des 46 ans, ce nombre dont on s’étonne, dont on ne sait pas quoi faire. Mais elles sont là, c’est que tu veux regarder, alors je te les laisse, bien entendu, elles ne sont pas qu’à moi, il est drôle de penser que nos visages nous appartiennent entièrement alors que nous sommes les seuls à ne pas les voir tels qu’ils sont.
Ce quelque chose qui se produit, c’est ce partage créatif. Je sais que c’est ce qu’il me manque ici. Je te le dirai plus tard, après que tu m’as envoyé les images. Dans cette ville où l’amitié est forte de quelques initiales, il manque un A majuscule mais il manque aussi ça, un partage né du faire. Est-ce toi ?

Peut-être aurais-je pu percer un peu plus le mystère qui t’entoure. Mais tu n’es pas venu. Fébrile, tu m’as dit être. Peut-être était-ce ton corps, cette fois, qui donnait un signe. Peut-être que, lorsque tu es venu mercredi m’apporter la petite boîte jaune qui m’aiderait peut-être à aller mieux, je t’avais transmis un petit chose, juste le temps que tu as été là, oh si peu, une fraction de minute, un petit rien mais réconfortant.
L’après-midi, j’y ai cru encore.
Mais tu as renoncé.
Et puis il y a eu cette chanson de Joni Mitchell.
Elle m’en a rappelé une autre, qui hante toujours cette période de Noël.
Et que j’ai bien sûr chanté.
Il serait tard, le froid pincerait, folie photographique de vouloir capturer autrement les bords de Garonne perdus dans la nuit ; il n’y a personne. Il n’y a vraiment personne et la nuit m’enveloppe. Au skate-park je lutte, le lieu a la photogénie des ombres et des courbes, mais pas de celles qu’on caresse autrement que des yeux et que A montrera : « des vagues, des collines, des dunes » écrira-t-il.

Et puis le corps reprend.

Peut-être est-ce simplement le corps qui ne veut plus.
Ainsi tu reviens, parfois. Entre chaque visite, les mois sont amples. A chaque fois, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose que ta jeunesse t’offre, une audace, une boucle, aujourd’hui ces ongles vernis, un peu écaillés déjà. Et ce si beau pantalon. « Zazou ? » zozoterait-on.
Tu es un peu moins timoré peut-être. Moi aussi je crois. Ce que tu montres de toi, ailleurs, ce que tu fais lire, ailleurs, est sans doute l’espace qui t’aide à devenir celui que tu deviens, dans cette affirmation d’être soi. C’est aussi l’espace, puisque fait de mots et d’images, qui nous relie lors de nos absences ; des mois, dis-je.
Tu es peut-être déjà celui que je voulais être, à cet âge qui est le tien, sans alors le savoir, sans jamais avoir eu la beauté douce et brutale de ton visage, sans jamais avoir osé le vernis. Les pantalons, si.
Encore de toi je fais des images. Tu aimes. Tu es venu aussi pour cela, pas seulement pour être là, quelques heures, à partager mon espace de travail pour rendre le tien moins solitaire. Et le mien, donc.
Sur celle-ci tu n’aimes pas tes cheveux, alors d’un geste brusque tu les aplatis. Je ris.
Alors, parmi tout, nous parlons de l’écrire. Il y a sur la table basse un livre, dont le titre contient le mot absence. Cela me parle, ce mot, elle est partout, l’absence. Tu ne le sais pas forcément, car tu n’as lu que ce projet-objet, que tu as imprimé, annoté : quelques pétouilles, dis-tu.


Tu avais été un moment d’espoir, il y a quelques jours. Oh ça n’avait pas duré longtemps, mais encore j’en ris, tellement je peux rire de moi dans ce que j’exprime de fulgurant parfois, dès qu’une petite lueur brille, dès qu’une petite surface se craquelle ; cette fois j’avais pris E à témoin. Tu m’avais abordé pour me féliciter de mes images, j’allais en faire autant. Nous avions donc parlé d’images. Et continué à en parler après que tu avais précisé les contours de ta vie amoureuse. Ça changeait tout et ça ne changeait rien.
Ce matin nous nous sommes rencontrés. Il y avait bien sûr cette lumière d’hiver, si belle, si belle qu’on en oublie le froid, sur ce pont, démasqués. Je ne savais pas encore si ta photogénie, claquant devant le bleu du ciel, ferait portrait. Je ne le sais pas encore.

Il dit mon nom, je me retourne. Il me dit que le scanner montre en effet que c’est un peu gros, mais que ce n’est pas inquiétant, que c’est normal, que plein de gens ont ça. Il me rassure sur un autre point, mes yeux s’écarquillent, mon esprit se soulage. Il est jeune, ses cheveux sont frisés, il doit être amusant quand il n’est pas au travail : il a une bonne tête derrière le masque, là, debout derrière ma chaise, dans l’espace d’attente des scanners de l’hôpital, un espace étrange que ce coin de couloir où passe les patients, en une allitération alitée, donc.
Creuser, dans le peu qu’il y aurait à montrer. Voir dans les replis d’un vêtement de sport en matière synthétique, peut-être, l’allégorie d’une quête intérieure. Et puis, chercher encore à faire rire. Mais la voix est plate malgré l’accent chantant ; mardi on avait pu en jouer, du ton du président, en jouer autant qu’il joue, avec les mots, les pauses et les doubles consonnes sur lesquelles il s’applique comme j’aime tant le faire le soir, quand personne ne m’entends lire, puisque personne ne m’écoute lire.


Ce journal pourrait alors devenir celui d’un objet littéraire en attente. Il pourrait aussi être celui de l’attente d’O, car combien manque-t-il ! O c’est toute une histoire, de mots surtout, des mots, des mots, ceux qu’on aime et ceux avec lesquels on joue. Mais soudain, il est onze heures, le revoici. Il a lu l’objet et il sait quoi en dire, il sait toucher, il sait offrir. Alors je lui réponds presque muet : je dis « Eh ben. »
Et puis plus tard il m’offre ça : « Qu’est ce qu’aimer un homme ? Qu’il soit là, et faire l’amour, rêver, et il revient, il fait l’amour. Tout n’est qu’attente. / Tu n’as d’existence qu’au travers de ton empreinte sur la mienne. T’écrire, ce n’est rien d’autre que faire le tour de ton absence. » C’est d’Annie Ernaux. Encore un beau cadeau.
Hier soir j’avais franchi le pas. Je t’avais envoyé le pdf. Je m’en étais libéré.
Déjà tu me réponds. Tu reprends mes mots, tu dis que ce n’est pas du tout fou, ni insupportable. Tu dis que c’est simplement beau. Tu dis que ça t’a fait rire, sourire et même un peu pleurer (un tout petit peu) des fois. Tu ajoutes que c’est purement moi et vraiment beau. Je relis cela : tes pleurs. Je relis cela : c’est purement moi. C’est purement moi : c’est beau cette formule et sûrement tellement vrai, de dire ça, tellement vrai dans ce que cela dit d’un morceau de moi, ce moi qui nomme un livre Présence de l’amour à l’intérieur.
Et j’ai ton accord. Cet objet, peut-être, vivra.
Or, je suis dans le tram. Il est tard pourtant, 20h10 : le travail m’engloutit parfois.
Donc je suis dans le tram. Et je pleure. Un tout petit peu.

Alors on invente des histoires. Alors on se voit. C’est simple, il fait beau, j’apporte des gâteaux. Quand on ne se voit que tous les deux, c’est toujours autre chose. C’est toujours pour se dire autre chose. Pour se dire encore que nous sommes pareils, toi et moi. C’est inestimable, d’être pareils : ça offre des sourires, ceux qui viennent de ces connivences. C’est reposant, d’être pareils : ça offre des silences, ceux qui viennent de ce qui n’a pas besoin d’être expliqué. C’est amusant, d’être pareils : ça offre des audaces dans ce que l’on dévoile, puisque nous ne le sommes pas tout à fait, pareils.
Mais, pareils ou pas, c’est si bien d’être là. Tandis que nous déjeunons, je réalise que j’ai loupé notre anniversaire. C’était le 13, je crois ; pourtant je n’en dis rien. Peut-être nous serions nous étreints ? Tu avais, ce soir-là, voulu me dire que tu étais dans une situation particulière. Mais nous étions pareils, déjà.

Il me fixe. Je suis en train de faire le tour du quartier après avoir fait les courses : quelques légumes et fruits de saison. Je ne me suis pas encore demandé si les poires Conférence sont devenues des poires visio-conférences : ça ne me viendra à l’esprit que là, sous vos yeux, à 0h47.
J’ai pris en photo un coin de rue : des toits baignés de soleil. Et donc il me fixe. Il est évident qu’il me prend pour quelqu’un d’autre, mais mon cerveau creuse tout de même pour s’assurer que je ne le connais pas. Je marche encore un peu, quelques pas, je le regarde, il me regarde, je m’éloigne encore un peu, hésitant, tourne une dernière fois la tête et le voilà qui me fait signe : il veut que j’enlève ma casquette. Je m’approche de lui et m’exécute. Il me demande de l’excuser : ce n’était pas moi qu’il croyait voir.
Ainsi les seuls contacts humains pourraient-ils naître du fait de ne pas être reconnus par des inconnus, ou quelque chose du genre, quelque chose d’absurde, pas plus absurde que cette attestation, sur laquelle tu dis que tu vas te promener, parce qu’il faudra peut-être dire à un agent de police que tu es en train de te promener, que tu as commencé à te promener à 15h17, bien que du sac dépassent quelques poireaux.

Je te dis que je suis là. Si besoin, tu le sais. Je peux venir. Prendre un train. Qui d’autre que moi ? Tu dis que non, que tu vas te débrouiller, malgré la douleur, malgré les mouvements qu’il t’est presque impossible de faire, encore quinze jours au moins, un mois peut-être. Puisque tu n’es pas seul chez toi dominant l’horizon.
Encore tu me racontes comment tu as caressé la main de l’infirmier tandis que ton épaule reprenait place. Un, deux, trois, disait-il. Un, deux, trois, répétait-il. Tu es un peu honteux. Et nous rions encore.

Alors ta joie : depuis ton île de pluie, ton avenir sur le continent européen se dessine. Dans un recoin la mienne, joie, mineure peut-être face à ton bonheur à peine exprimé – tu n’as plus de batterie. Elle vient de la tienne : elle s’y emmêle, dans cette joie et dans une syntaxe osée. Elle vient aussi de l’assurance que nous nous reverrons, même si je n’ai pas la rêverie soudaine d’un château en Espagne où tu m’attendrais, même si je sais que rien de vraiment fou ne viendra avec ton retour, sauf ce qu’il y a de meilleur entre nous, sauf ce qu’il y a de précieux, même si ce rire grave qui est le tien est source de tumultes.

Il y avait eu hier ce petit caillou lancé dans la phrase prononcée à l’autre bout du fil. Mais je n’avais dis rien. C’était quoi ? Maladroit ? Inconscient ? Vache ? Cette fois-ci, je saute sur l’occasion : je propose qu’on en parle de tout ça, non pas du caillou mais de ce qu’elle voudrait, de ce qu’il faudrait, de ce qui n’est pas super, etc., je suis constructif, d’ailleurs il y a ce truc qui attend, d’ailleurs, etc. D’ailleurs quoi… D’ailleurs pfffff…

C’est par exemple ce soir que je pourrais t’appeler. Comme convenu hier entre nous. « Dans la semaine » on s’était dit. J’avais réinstallé cette application sur laquelle nous nous étions rencontrés. J’avais vu ton image, cette image, restée dans les favoris, et j’avais cliqué. Je croyais pouvoir passer inaperçu en regardant ce petit bout de toi et de nous, mais l’option était désactivée. Tu avais donc vu que j’avais vu. Alors tu m’avais écrit : une interpellation courte. J’avais répondu en utilisant le même adjectif. Je te le renvoyais, j’insistais : no it’s you.
Nous ne nous étions pas écrit depuis le 18 juillet. Le 17 tu m’avais demandé s’il y avait des « exciting news », c’est-à-dire des vacances, un mariage, un voyage. « A mariage? Yeah, come! » j’avais répondu en faisant suivre cela de deux smileys hilares alors que je ne riais pas et que tu le savais.
Bien sûr souvent je pensais à toi. Bien sûr souvent je pense à toi. Je ne voulais pas t’écrire. Je ne voulais pas t’appeler. Pas avant d’avoir fini. Pas avant d’être sûr et de te demander ton adresse et de t’envoyer ça, ce qui traine, là, sur la table, cette histoire de nous deux, dont la maquette, maintenant que j’en ai imprimé un exemplaire, ne me plait pas. Elle ne sied pas à la lecture. Elle ne sied peut-être plus, non plus, à autre chose qu’à être un brouillon, et à mon vœu de voir cela édité. Est-ce que tu es d’accord ? Je ne sais plus si moi-même je le suis. J’ai parfois envie de tout enfouir. De te faire disparaître.
D’ailleurs H m’a répondu.
Elle m’a dit qu’il fallait que je me dépêche.
Moi je m’en fous moi de la température, l’humidité, la moisissure, la lumière… Elle a raison si tu veux mais j’m’en fiche… Le cinéma c’est vivant, c’est pas un truc dans une boite fermée dans un musée que plus personne ne regarde et que plus personne ne touche. Le film voilà ça s’projette, donc ça s’use ça se raye y a des poussières, ça gondole, voilà mais c’est la vie, c’est la vie de la pellicule, comme la vie d’un homme.
::: Boris Lehmann ; Documentaire sur France Culture
Il y avait déjà bien longtemps que je marchais au travers des pinèdes, beaucoup plus vastes, au demeurant, qu’on aurait pu l’imaginer d’après les gravures.
À quoi rimait pour moi de marcher, et encore marcher dans des lieux plantés uniquement de pins… ? Pourquoi diable est-ce que je continuais d’avancer si ces pins, eux, ne se manifestaient pas d’avantage… ? J’aurais mieux fait, d’emblée, de reste en place, de fixer de près un arbre et de jour à qui rirait le premier !
::: Natsume Sōseki ; Le Mineur
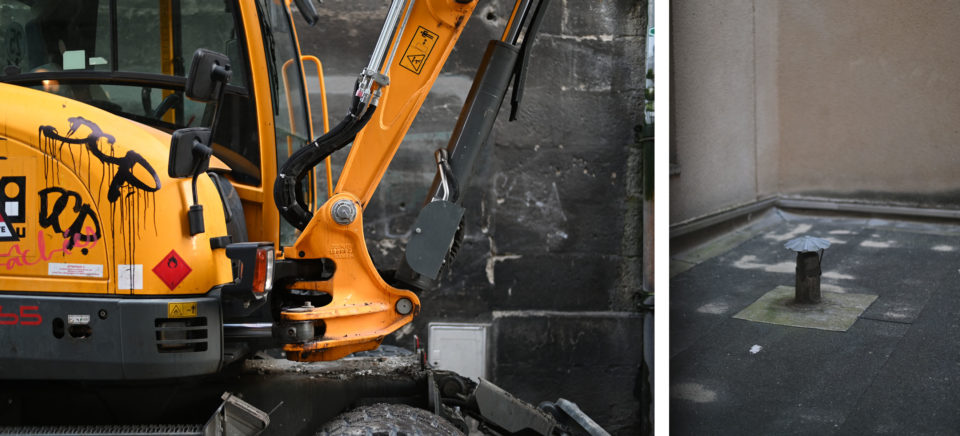
Nous dérivons, nous voilà au Sénégal. Tu me parles d’une île, d’un cimetière. Tu me parles des couleurs, des gens souriants. J’interviens avec le microbiote. C’est soudain moins poétique, moins beau. Mais peut-être tout autant étonnant.