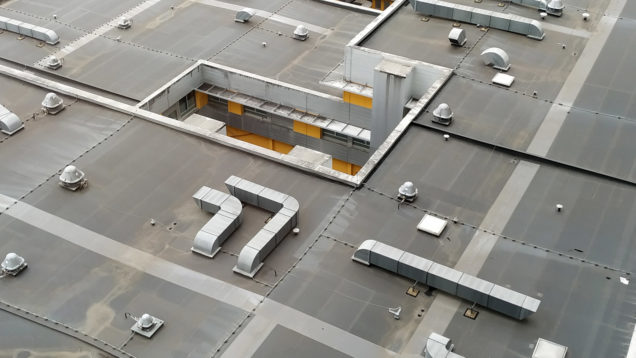On se rappellera les inquiétudes d’un été japonais, le premier, ou le troisième si l’on regarde les traces et qu’on caresse la chronologie des juillet. D’emblée j’écris « premier » car c’est celui qui m’inscrira définitivement dans la japonité. Que serait le Soleil levant sans cette petite carte, qui m’offrait trois ans là-bas, carte obtenue après tant d’attente et qui fut trouée par un individu au guichet de l’immigration de l’aéroport d’Osaka-Kansai le 1er mai 2017 ? Clac.
Ainsi je cherche à te rassurer et te comprendre par ma propre expérience, qui n’a de comparable qu’une tracasserie administrative non sans importance. Qui a de comparable peut-être aussi, vaguement, d’une certaine manière, l’idée d’un deux, c’est-à-dire de ce qu’un permis de séjour donne comme permis de vivre quelque chose à deux.
C’est justement ce pays qui revient. C’est là où tu iras bientôt et d’où tu reviendras. C’est donc là que tu t’interroges.
Dimanche 14 juillet 2019
Samedi 13 juillet 2019
Vendredi 12 juillet 2019
Jeudi 11 juillet 2019
Il exprime son absence, son silence, tous ces mois de silences. Plus discrètement ce moment partagé, sa fuite. Les excuses m’étonnent, j’ai toujours su qu’il reviendrait, ayant toujours eu l’indiscutable sentiment qu’il n’était pas réapparu parce que ce n’était pas le moment.
Nous supposons que c’était un jour d’automne assez frais. Je pense que je ne connaissais pas encore E. Nous savons que lui non plus. Il me semblait avoir décrit dans ce journal le motif de son manteau, avoir évoqué les mots ; il aurait alors été simple de retrouver la date. A trop vouloir être vague, souvent je ne me comprends pas, je ne me retrouve pas. Et puis il suffit d’insister. Janvier.
Mercredi 10 juillet 2019
Les mois ont passé. Du Kenya je n’ai rien dit, alors il était temps, et l’écriture se précise, j’élague. Je parle à E d’une version allégée. Dans ce journal de là-bas, j’écris qu’alors j’écris à Jean-Luc, des mots que jamais il ne recevra de ma main. J’y interroge les troncs pris en photo sur la plage, je me demande si ce ne sont pas là les portraits que je n’ai jamais faits. Derrière les troncs il y a la mer, ce bras qui longe la mangrove et qui n’est pas l’océan. Derrière ces troncs il y a ce « Jusqu’au rien » dont parle Duras, et que j’étire pour lui donner un sens.
Mardi 9 juillet 2019
Ainsi nous formons, petit à petit, une habitude. Riant de nos dissemblances, corrigeant quelque vue péremptoire, acceptant une dissonance, salant un autre goût, montant en mayonnaise un œuf de la mauvaise couleur, écoutant ce que l’autre n’ose pas dire, attendant ce que l’on ne saura pas soi-même apporter, prenant ce que l’on entend dire de soi, nous devisons ainsi, de tout de rien de nous, pour devenir ici, et nous projeter là-bas. Quand sera-ce déjà ?
Lundi 8 juillet 2019
J me parle des premiers jours. Je lui parle des premières semaines. Comme à chaque conversation, nos histoires vont et viennent. Que ne se dit-on pas ? Pourtant je ne dis rien de ces musiques que tu m’as fait découvrir, rien de ce morceau qu’ensuite j’écouterai et qui réclame à l’autre les first six monthes of love, tant d’années après.
Je ne dis rien. Pourtant c’est important. Un liant : avec F elle m’avait entraîné ailleurs, avec Ch elle enveloppait les silences, avec Z elle nous faisait danser. C’est peut-être ce qui nous a manqué, avec P, la musique. Souvent il chantait dans sa cuisine, pourtant.
Dimanche 7 juillet 2019
Elle sait pas trop si elle est artiste. C’est ainsi qu’on la qualifie, pourtant. On, c’est-à-dire les autres.
C’est vous l’artiste ?, lui avait-on dit. Là c’était nous, on.
Elle faisait tourner un artefact de ses jumelles sur pied qu’on trouve ici ou là, souvent au bord, parfois en surplomb, toujours loin de quelque chose. Il faut un panorama, un point à fixer, peut-être des oiseaux pourraient-ils passer dans le champ une fois qu’on aurait mis la pièce dans la fente. Tac.
Je n’ai pas compris exactement comme ça marchait, ces jumelles, c’est-à-dire les siennes, les fausses, en carton, on y voyait des rues, Google nous montrait le quartier, pas loin, et j’ai dit oui, ah, d’accord. C’est là qu’elle a dit que c’était elle l’artiste, mais bon qu’enfin heu sinon elle était architecte.
Vous êtes artistes ?, nous a-t-elle demandés. J’ai dit oui, un peu photographe mais enfin heu sinon…
Samedi 6 juillet 2019
Elle s’approche. Elle dit que c’est elle, la photographe. Peut-être a-t-elle entendu ce que l’on disait d’elle. Te souviens-tu ce que l’on en disait ? Te souvenais-tu qu’on en avait aimé ailleurs ?
Il y avait beaucoup de choses à dire sur les images de Valérie Six. Les couleurs, les lignes. les rapprochements. Parfois elle en disait peut-être trop ; tu sais comme j’aime le silence, surtout celui des images.
Vendredi 5 juillet 2019
Si peu.
Jeudi 4 juillet 2019
Et soudain cette image que l’on aurait pas dû voir. Elle fait entrer l’autre, celui sur l’image, déjà présent dans ce que l’on en entend et de ce que l’on en dit, dans une autre dimension, visuelle, palpable. Elle fait rester l’autre dans ce rôle qu’il finira bientôt par quitter, puisque tôt ou tard, tout se déplace.
Mercredi 3 juillet 2019
On inventerait le verbe cresser. Sa définition hésiterait entre la prière, la quête autour de soi pour qu’un projet se concrétise, l’espoir. A une terrasse alors, puisqu’il le dit encore, puisqu’il veut qu’on m’édite, cressons.
Mardi 2 juillet 2019
Lundi 1er juillet 2019
Me voici en partance puisque déjà j’y pense : Trouville. Dans un mois, pour deux jours. Oui c’est tout. Oui c’est court. Oui c’est bien. Oui seul. Trouville c’est Duras, et son fantôme passant un jour sur la plage. Trouville c’est ce 30 mai improvisé et des rires soulagés. Trouville c’est donc l’absence, puisque tout est absence. Absence = vide = trou –> Trouville. Rire.
Dimanche 30 juin 2019
Il y a cet équilibre à trouver dans l’espace et dans le temps. Il passe aussi pour moi par le besoin d’exprimer ce qui se passe et de comment cela se passe. Être loin, se voir peu, dans une alternance de tout et rien, voilà ce qui est, mais le rien n’est pas rien puisque nous sommes là, je veux dire que même loin, dans la non-présence physique, l’autre est là. Et ce n’est pas rien. Mais que faire des peaux ?
De ce que nous ressentons, toi, moi, de ce que nous sommes, toi, moi, ou ensemble, de ce que nous proposons, interrogeons, taisons, imaginons, évoquons, au détour d’un verbe, d’un adjectif, d’une traduction incertaine, de tout cela souvent nous rions. Je cherche ainsi à rire de moi, à te faire rire de moi puisque c’est cela que nous voulons, être légers et rieurs, ainsi toi-même tu oses proposer autre chose de nous, là allongés après le déjeuner sur ces matelas recouvert de matière plastique, et malgré tout j’en ris. Un rire teinté peut-être.
Là nous écoutons Bizet. Je n’avais jamais entendu la version italienne de cet air que j’aime tant, que j’aimerais tant pouvoir/savoir chanter, et que tu as choisi de me faire écouter. Je souris. La musique c’est aussi les peaux, ça passe par là, regarde mes bras frissonnent. Par où passent ces airs que je t’envoie, de ma voix hésitante et que tu dis aimer ? La musique c’est aussi les corps qui dansent, encore, décidément c’est tous les jours se dira le lecteur, ainsi nous tout à l’heure, Danze danze mit mihr, dans cette rue avant la Loire longée par ce chemin, avant les plantes, les orties, les chardons, avant l’espace rien que pour nous deux et cet horizon d’arbres.
Que dire encore de ce dimanche ? Oui dire les paysages, ceux d’Olivier Debré, et qu’alors tu parles du ciel et du regard qui s’envole au-delà des étendues rouges, bleues, jaunes. Dire les êtres de Fabien Mérelle, entre légèreté délicieuse et crayonnés acharnés donnant aux forêts et aux oiseaux qui s’envolent des contours inédits. Dire le livre sur les espaces et leurs usages au Japon, toi le tien, moi le mien, pour ne pas seulement partager un air de Bizet qu’on croit entendre encore.
Samedi 29 juin 2019
Vendredi 28 juin 2019
L’objet filmique intéressant sur le papier, bien sûr touchant ici ou là, propose quelques beaux moments quand on coupe les cheveux ou quand les amis savent de quoi ils parlent et surtout comment en parler (merci Brice) mais le voici à mon goût malheureusement trop fragile dans sa construction, dans cette tentative d’autofiction où le je n’a tellement rien à dire qu’il doit montrer qu’il en a une grosse, dans son absence de montage, et je le répète car je crois que moi non plus on ne m’entend pas très bien, dans un son extrêmement mauvais (comme c’est pénible). Ainsi, l’obsession de plonger le spectateur dans la réalité fait plouf. Ou splash. Ou scouitch. L’objet est comme l’histoire, comme l’amour de ces garçons : il faut tendre l’oreille.
Si j’aimerais aimer le film, c’est peut-être parce qu’il renvoie à ce que je disais à Pascale, il y a une semaine, à propos de l’intime qui existe ici, et qui existe aussi dans des images et des textes restant enfouis, pour l’instant ou pour toujours, qui existe dans des recherches de correspondances entre les hommes et les territoires, dans des paysages-peaux. Continents d’amour, ça s’appelle. Elle a noté le titre. Le lendemain tu riais parce que je te photographiais.
Jeudi 27 juin 2019
J’ai derrière moi un nombre précis mais oublié de moments musicaux dans les églises, celle de Clichy principalement. C’était autrefois. En creusant, on s’amuserait à trouver le nombre en question, trois dimanches par an, dans un rythme et d’autres cycles que j’ai fini par ne plus aimer. Je raconte parfois le papier laissé sur le piano.
Ce soir c’est au temple. On pourrait réciter un Notre Père, qui es aux cieux. Mais on ferme les yeux. Parfois on regarde un chanteur, qui est soucieux.
Mercredi 26 juin 2019
Au même moment ma mère, qui suit ses études d’optique, s’est enamourée du curé de Courlandon ; elle vole de l’argent à sa tante pour le lui apporter ; elle se fait accompagner à bicyclette par sa sœur Gisèle et sa cousine Micheline jusqu’au presbytère ; les deux complices font le guet tandis que ma mère échange les quelques billets qu’elle a réussi à chouraver contre les étreintes du prêtre.
::: Hervé Guibert ; Mes parents
Mardi 25 juin 2019
Et les bretelles, je vous ai parlé des bretelles ?
Lundi 24 juin 2019
Dimanche 23 juin 2019
Un train, nous l’un en face de l’autre et à ta droite un paysage que tu ignores. Puis une plage, autour de nous des familles qui parlent ta langue, et puis l’eau, pas si salée dis-tu ; ainsi la goûte-t-on. On dit des grains de sable qu’ils viennent tout enrayer. Ne viennent-ils pas adoucir, sur ce bord de bassin, ce qui fait les jours ? Allongés je divague et tu lis ce roman, depuis quand te suit-il ? C’est peut-être ainsi que tu aimes que l’on t’accompagne, dans le rythme lent et ajouré des pages sur lequel le temps glisse, dans l’incertitude de ce que contiendra le chapitre suivant. Mais soudain tu ris, comme un autre soleil.
Samedi 22 juin 2019
Vendredi 21 juin 2019
Jeudi 20 juin 2019
Il y a sur la table, griffonné sur une enveloppe : « Tu dors avec les chansons des oiseaux toute la nuit. » J’ai le souvenir vague de ta voix et du bonheur que tu avais de raconter cela, mais tout ce qui entourait ce moment a disparu, recouvert par mon geste qui attrapa le stylo et mit un tu, pour te donner une autre place, pour offrir un élan à une narration dont tu étais l’acteur. Il y avait sans doute des fenêtres ouvertes.
Mercredi 19 juin 2019
Je n’avais pas encore acheté ce clin d’œil glacé, une boule yuzu recouverte par une autre chocolat intense, dont je t’enverrais la photographie. C’est alors que c’est arrivé. Comme une vague passant par tous les pores de ma peau, tsunami d’émotion, ça m’a envahi. Toi. Ta présence. Je ne savais pas ce que cela voulait dire, ni si cela avait un nom au-delà du moment où cela arrivait. Je ne savais pas comment l’écrire, comme une explosion dont on ne saurait décrire que la force. Je ne savais pas si je devais te le dire.
Mardi 18 juin 2019
Ils racontent des ailleurs que je ne connais pas. J’écoute, paisible, bercé par leur soleil et les colonnades décaties, bercé par le vino verde.
Tu ne dis rien ? Si, je dis les oiseaux. Ils sont là-haut, sur le toit, ainsi voient-ils le ciel et l’horizon inatteignable. Diamants Mandarins, ils ont un nom qui brille, un nom qui va au-delà du tripode, tout à l’est. Un nom qui donne des ailes, et ce matin peut-être m’en ont-ils donné, en allant voir un peu, du côté du cervelet.
Lundi 17 juin 2019
C’est comme ses mythes où les tonneaux se vident, il faut alors revoir cette langue dont on savait tant et peu, il y a deux ans à peine. Elle fuit. Par quel chemin est-elle passé pour disparaître ainsi, hop, discrètement ? Je tente de la rattraper, je l’ai retrouvée, là, dans cette application devenue compagne de voyage, partenaire de déjeuner, épaule sur l’oreiller susurrant des mots perdus. Je la prends par le bras, elle me prend la main et me dit d’insister, me ramène sur nos chemins et je lui demande de me donner une chance de ne pas l’oublier. Reste avec moi veux-tu ? お願いします。
Dimanche 16 juin 2019
Samedi 15 juin 2019
Au sortir du théâtre, son visage, un an peut-être depuis que : c’était à la caisse du magasin bio où je ne vais plus, pourtant à deux pas. Il dit qu’il a beaucoup beaucoup aimé, il le dit plus facilement que moi, mais j’ai beaucoup beaucoup aimé. Il y a alors ce truc qui flotte, qui n’ose pas vraiment, dans notre conversation, parce que je n’ose pas. Il a oublié mon métier, j’ai oublié le sien mais j’ai le souvenir vague du domaine, et c’est pour ça que je n’ose pas, j’ai peur de dire un truc un peu idiot, peut-être parce que derrière il y a l’idée de charmer l’homme charmant qui dit, d’une voix charmante, qu’il a beaucoup beaucoup aimé, et il y a l’éventualité de dire une banalité, sur les corps, la force, l’humour et toute l’écriture de Charmatz qui compose avec tous ces corps et leur bras, leurs jambes, leurs fesses, leur peau, leurs pas, leurs sauts, leurs cris, leurs soupirs, leurs émotions. Alors je lui parle de toi.
Vendredi 14 juin 2019
J’ai oublié les villages qui entouraient nos vacances les étés 2002 et 2003. En creusant dans les cartes et les traces d’autrefois, sans doute ma mémoire aurait-elle retrouvé les étendues et les clochers mais lorsqu’il nous dit où ses vins naissent, je ne dis rien, je ne sais plus. C’est après avoir goûté une gamme allant d’un âpre villageois à la surprise de la dernière bouteille que je demande, avec le seul nom qu’il me reste, le seul nom et la seule vision au loin des Dentelles de Montmirail. Il dit oui : il vient de ce pays oublié.
Et je parle du mien, pays, cette terre saintongeaise dont le vin n’a pas bercé mes souvenirs de bouche, car des quelques vignes du grand-père il ne reste aucun goût mais des doigts qui collent sous le raisin, les petits ciseaux, les rires, la boue, l’odeur, les voix qui résonnent dans les chais. Le vin c’est un peu de mon enfance et ce n’est rien de ce que je sais, ce ne sont aujourd’hui que des plaisirs, des moues, ou avant-hier un Languedoc aérien, quelque chose loin de la boue, plus près du ciel, la pinte encore accrochée au palais, et donc de S la moue.
Et nous marchons ainsi, chacun vers chez soi, c’est du moins ce qu’on croit, avant qu’on se retrouve là, attablés, dans un entre-nous-deux étonnamment rare, trop rare, sans E déjà vers chez lui. L’incontournable s’impose d’abord : le travail, la réunion du matin, les idées, la quête d’un absolu qui n’existe pas, ma place, la tienne. Et puis l’on s’en détourne, le fromage coule presque voluptueusement sur le pain où l’ail tente sa chance et y parvient : voilà l’écriture, les mots, les lignes, entre les lignes et tout autour.
Jeudi 13 juin 2019
Tu me dis que tu as aimé ce que j’ai écrit. C’est en anglais que tu me le dis. Tu me dis que tu as aimé ce que j’ai écrit suite à ce que l’on s’était dit. C’est comme une spirale : les mots sur les mots à propos des mots et ainsi de suite. C’est joli les spirales, ça commence petitement, et puis ça virevolte, la tête tourne, et l’on se dit que ça pourrait ne jamais finir. C’est comme une danse, ça pourrait ne jamais finir. Une danse. Voici justement O, O qui m’avait demandé d’écrire. Faire l’amour. C’est quoi faire l’amour ? Ça dit quoi ? Ça veut dire quoi ? Alors j’avais écrit quelque chose ; j’y disais « Je prends ta main. » Les mots existent ailleurs, ils ont été lus, m’a-t-il dit. Ils avaient terminé le spectacle, m’a-t-il dit et j’ai sûrement répondu par une onomatopée. Voici que ce soir, vidéo, 9 minutes et un souffle de poussières, autre forme d’amour, il lui prend la main. La dame est très âgée, elle n’est pas vraiment là.
Car depuis peu je te sais lecteur. Comment puis-je alors dire ? C’est toujours ainsi que j’écris, en sachant qu’il y a quelqu’un, à l’autre bout, ou bien qu’il peut y avoir quelqu’un. C’est un jeu, un frisson parfois, une contrainte sans doute. Oulipesque ? Presque. Que choisir ici dans tout ce que j’ai envie de crier, puisque être lu partout, n’est-ce pas un peu crier ? Ecrire, c’est hurler sans bruit, dit Duras. J’en reçois / perçois à présent un autre sens que celui de la douleur : l’étendue. Que choisir de nous que tu sais déjà et que j’aime retranscrire ? Et que dire de nous qu’on ne s’est pas encore dit, qu’on ne se dira peut-être pas, et que je pourrais exprimer ici et pas ailleurs, que je voudrais dire maintenant, dans l’instant i de ce qui est, dans l’instant i porté par ta présence, même quand tu n’es pas là, au moment où tu n’es pas là. Ainsi je risque d’écrire que tu me manques. N’es-tu pas vraiment là ?
Mercredi 12 juin 2019
Alors Perec s’immisce dans le dîner.
Mardi 11 juin 2019
Alors, il y a cette quête du volume, c’est-à-dire de la prise de volume, non pas globale mais précise, ici, là, transformer le corps, en arrondir certains angles, en redessiner certaines lignes, en affronter certaines particularités liées à l’âge ou à soi-même. On finit par connaître le corps, et pourtant parfois, il surprend encore. Et puis voici qu’il danse, puisque c’est ainsi que tu le vois et que nous rions.
Nous rions plus facilement puisque te voici plus près, revenu de là-bas, revenu mais encore loin et il faudra attendre. Nous rions et je souris puisque voici ta voix, manquée hier, puisque j’étais happé par quelques élucubrations difficilement articulées, happé donc déçu de ce loupé, ainsi je l’avais exprimé, ainsi l’on s’était moqué (maousse).
Lundi 10 juin 2019
Dimanche 9 juin 2019
Dorénavant, sur l’agenda, par superstition, j’ajoute un point d’interrogation à son prénom.
::: Hervé Guibert ; Fou de Vincent
Tu me demandes d’où vient l’idée. Je ne sais pas vraiment. Il a suffi de cette lumière, de ces fleurs qui offrent encore quelque chose de fragile et de beau malgré leur déliquescence, de cette envie d’un virage photographique, de ces images vues ensemble et que l’on avait tant aimées. Il y a aussi cette envie de questionner l’idée d’être ici, de montrer encore une fois ce qui m’entoure. Il y a sûrement l’envie de revivre cette relation que j’ai eue avec la maison au Japon, maison lumière, pour laquelle j’avais écrit que je vivais en elle et qu’elle vivait en moi. Mais j’échoue sur Instagram à montrer les détails de cet espace dans lequel je vis aujourd’hui, peut-être parce que c’est du réchauffé, peut-être parce que j’y suis seul et que je n’ai pas besoin de mon regard comme espace d’expression d’une certaine liberté.
Je te dis que n’est pas facile d’aimer être chez soi. Tu confirmes. C’est pourtant mal exprimé. Ce n’est pas facile d’aimer être seul chez soi.
Samedi 8 juin 2019
Vendredi 7 juin 2019
La petite fille porte un tutu. Souriante, elle joue après avoir rendu à sa grande sœur le verre en carton duquel elle aspirait probablement un soda via une paille en plastique qui terminera dans un océan ou un autre qu’elle ne verra peut-être jamais. L’heure du dîner est en effet passée, il est tard, j’ai été retenu au bureau par le plaisir d’avoir été témoin du sens que l’on peut donner à mon travail. Peut-être ai-je aussi été retenu par le besoin d’inscrire ce vendredi après-midi dans un autre rythme et dans une autre direction.
La petite fille, qui ignore tout de mes journées, de mes doutes et de tout le reste puisque l’on protège les enfants du monde des adultes et du désastre écologique de sa paille et du Happy Meal, parfois me regarde. Ainsi sait-elle que moi-même je la regarde. Elle descend du siège, tend la main vers la petite poussette en plastique dans laquelle un poupon est envahi par un hochet, un petit livre de coloriage offert chez Mac Truc et plusieurs petits jouets de marque Playmobil dont ce qui ressemble à un coffre remontant de mes souvenirs – je crois qu’il appartenait au saloon. Parmi eux, un enfant blond vénitien. Il s’appelle Matéo. Il a six ans. Elle l’aime : il est trop beau.
Jeudi 6 juin 2019
Elle n’est pas assez âgée pour voler, alors vous l’avez recueillie. Ton accent ou une confusion sur le mot la rend muette, comme un oiseau silence.
Sur la photographie que tu m’envoies juste après que nous avons parlé, je découvre sa tête, joliment couverte de taches.
Trente-huit minutes plus tard tu évoques le Japon, puisque tu iras, et que tu ne sais pas, dans tes moments dits libres, ce qu’il y a de mieux à choisir. Rapidement je parcours la liste de propositions que l’on te fait et bien sûr je t’entraîne à Ohara – lire ce nom m’émeut – ou dans un village inconnu avant que nos smileys s’amusent de ta pudeur, puisque des sources chaudes tu ignores les usages.
J’aurais tant aimé t’y rejoindre, en ce septembre encore chaud, pour revoir mes amis, donner à ce pays un peu de ton visage et puis t’accompagner ; je t’aurais parlé des oiseaux.
Alors je te demande si tu lui as donné un nom. Tu me dis Nokta : un point. C’est tout.
Mercredi 5 juin 2019
Ah non, je ne supporte pas le fromage, ça me rend dingue.
Mardi 4 juin 2019
Tu viens de traverser ; sur le bateau nous ne pouvions parler. Il est bien tard, une heure de plus pour toi. Tu me racontes ta journée, côté européen, la visite à une partie de ta famille dont les valeurs ne sont pas les tiennes, puis à une amie et ses parents que tu adores.
Je n’ai rien traversé, si ce n’est l’appartement, quinze minutes plus tôt, pour m’installer et regarder ce film argentin sans rien en savoir, sauf une référence, Jarmusch, aperçue. Un troisième continent, donc, que ceux entre lesquels tu vas et viens. Je te raconte ce RV qui a proposé une oreille attentive, un autre rythme, une construction efficace et nous rions de comment le film rejoint cette connivence.
Nous avions déjà ri, ce matin, mais via quelques émoticônes donc sans entendre nos voix, de ce petit coiffeur qui, dans ta langue, n’existe pas, de ce petit Paris auquel tu ne crois pas. Car voilà que je m’y penche, sur ta langue dont les points communs avec le japonais ou l’espagnol m’offrent une familiarité bienvenue et bienveillante. Et, dévoilant soudain l’existence possible d’un petit coiffeur, tu t’étonnes de la nôtre.
Lundi 3 juin 2019
Je crois que quand on fait compliqué, on atteint moins les choses essentielles, dit Michel Serres avant un « La voilà » quand arrive la partition pour piano du Concerto 21 pour piano et orchestre de Mozart. Je décroche quand les voix se sont tues, la musique s’impose, je laisse quelques secondes, puis rapproche le téléphone de mon oreille pour entendre ta voix.
– … C’est bizarre.
– Non c’est Mozart.
La rime fuse sans prévenir : tu croyais que ça grésillait. Wolgang Amadeus Friture Mozart.
Dimanche 2 juin 2019
Samedi 1er juin 2019
Il y avait au moins une clarinette que j’assimilais, au début, à un ruban moelleux dont les spires devaient traîner sur le plancher, l’exercice terminé, à la façon du copeau terne et doux, légèrement coloré, sur le bord, et parfumé, qui sort d’un taille-crayon. De plus loin s’élevait le brame lent d’uen grand bête mélancolique qu’on aurait véritablement enfermée derrière une porte. Mais le doute, là, n’était pas permis. Le seul instrument capable de susciter un élan ou un zébu dans ces profondeurs était la contrebasse.
:: Pierre Bergounioux ; La Mort de Brune
Vendredi 31 mai 2019
Tous les livres que j’ai écrits ont été précédés d’une phase, souvent très longue, de réflexion et d’interrogations, d’incertitudes et de directions abandonnées.
:: Annie Ernaux ; L’atelier noir
Craignant du livre entamé la veille des pages travaillées dans une dentelle inadaptée à un certain repos campagnard qui préférerait la texture des draps en coton épais, je mets dans mon sac, au matin, un autre réel, celui d’Annie Ernaux.
L’atelier noir, dont j’ignorais (ou j’avais oublié ?) l’existence, est alors là pour me rassurer face aux incertitudes de l’écriture dans un train qui ne signale pas son retard, train muet comme une carpe sans signal ni panneau, muet comme un contrôleur au zèle mal placé qui descendrait du train avec indifférence. Il est donc grand temps de les assumer, ces incertitudes, vécues par d’autres, et d’avancer.
Jeudi 30 mai 2019
Il est tard. Tout est fini. La journée chômée d’anniversaire offerte par le hasard du calendrier n’est plus ; le pique-nique de l’autre côté de la Garonne est de l’autre côté du jour ; les amis sont chez eux, surtout les plus frileux et le dernier d’entre eux est rentré chez lui après une derrière accolade sur une place Fernand Lafargue encore animée. Loulou, m’appelle-t-il souvent. Ma sélection de vêtements est prête pour demain, après qu’un cri dans la nuit s’est fait entendre : un accroc sur le polo rose.
Je suis donc seul. Il est l’heure de dormir si l’on sait être raisonnable mais j’ai envie de lire. Peut-être parce que ce nouvel âge, au fond de moi, doit passer par deux ou trois pages qui m’inscriront dans autre chose que l’indispensable présence des amis, présence qui, ainsi que je l’expliquais à Toby et qu’autour on écoutait, m’offre depuis quelques temps des joies et des respirations bien plus grandes que les piles de projets les soirs venus, c’est-à-dire ces soirs qui ferment une journée dite « de travail ».
Alors voici Bergounioux, dans un récit qui regarde vers l’enfance, comme un joli hasard un jour d’anniversaire, après qu’on a reçu par email des petites images sur lesquelles, en socquettes blanches, de quelques jours âgé, je gigote.
Mercredi 29 mai 2019
Mardi 28 mai 2019
Elle nous regarde. Elle attend le bus, arrêt Victoire Marne, elle est blonde et porte un imper blanc. J’ai déjà vécu ce moment, à tant y avoir pensé, mais elle n’était pas là : il n’y avait que nous sur le trottoir de ce quartier. Je n’avais pas su imaginer les autres visages : il n’y avait que le tien.
Lundi 27 mai 2019
Dimanche 26 mai 2019
Non mais y aura pas assez à manger là…
Samedi 25 mai 2019
Toulouse est arrivée dans notre vie un jour de pique-nique sur les bords de Seine. Andréa et toi vouliez aller voir l’exposition « Picasso et l’exil », et je m’étais retrouvé embarqué dans cette aventure sans savoir vraiment si j’y prendrais part. Nous avions ri devant les photos de la chambre, où sans embarras elle avait proposé que je m’immisce. Nous avions ri devant un « même si ». Andréa n’est pas là, agrippée par la mort, retenue dans son pays. Nous ne sommes que tous les deux, ce n’est pas la même chambre, ce n’est pas le même « même si ».
Le jour est là, tu es sous le charme, tu vibres devant la ville tandis que je perçois en moi une pointe de regret, celui de ne pas avoir embrassé la ville autant qu’il aurait fallu il y a 27 ans. Nous formons ainsi ce doux équilibre qui découvre St Sernin, qui sourit aux pierres roses, qui traverse le pont, s’arrête pour un selfie lumineux, et va aux Abattoirs.
Là où autrefois on égorgeait les veaux, le taureau de Guernica hurle donc la mort. L’exposition s’étend, dense, peut-être confuse, épuise vite, on cherche l’émotion ou la surprise, petit à petit on pioche, ici une phrase, là Don Quijote, bien sûr si l’on peut on s’arrête un moment, on note et l’on apprend, on cherche chez Picasso ce qui faisait exil, puisque c’est là toute la question, qu’est-ce qui fait exil ? A l’étage, Picasso abandonné, deux statues mortuaires me regardent, et venu pour ce qu’on avait à dire du peintre et de l’Espagne, je ne repars qu’avec leur visage en tête… leur visage et tant d’autres, ceux d’espagnols sur une plage française en 1939, puisque c’est encore ça, encore ça.
Vendredi 24 mai 2019
La chambre donne sur un mur masqué par de lourds rideaux ; tu as l’air déçu face au crépis. J’ai demandé côté cour pour être au calme, j’ai demandé côté cour en imaginant ce que le mot cour laisse entendre, une respiration, un ciel, un arbre, peut-être un vis-à-vis indiscret. J’étais inquiet des travaux côté rue, qu’importe ce qu’on voit, je voulais nous réveiller sans heurts, marteaux-piqueurs, marteaux piquent heures. Je me disais que nous ne verrions pas que la nuit : je connais nos matins.
J’avais pris la chambre plutôt précipitamment, voulant te voir arriver débarrassé de tout ça, puisque l’homme au téléphone avait dit que non, plus rien, personne, le lieu était fermé, nous aurions dû être prévenus.
Dehors il fait nuit lorsque nous partons dîner, cherchant ce qui nous fera plaisir, cherchant ce qui ne semble pas déplaire à l’autre, sans chichi ni folie, avec peut-être juste ce qu’il faut de little something pour ne pas grimacer. Nous parlons de la couleur de la ville, tu lèves les yeux sur ce que tu ignores et sur ce que je ne connais pas beaucoup mieux, teinte légèrement ternie par le soir et la pluie. Alors place du Capitole nous dînons, sans folie mais avec, je crois, le plaisir pour moi d’être ici à regarder ce qui m’avait peut-être, il y a 27 ans, ébloui. Sans folie mais tu oses la saucisse locale.
Jeudi 23 mai 2019
Mercredi 22 mai 2019
Tramway. Elle est derrière moi. Elle dit qu’elle a pris un râteau, qu’elle est monté à l’échelle pour attraper des cerises. Tant d’images alors pourraient me venir à l’esprit, tant de souvenirs, mais c’est presque le présent, l’image de ma mère sur un escabeau, qui s’impose, il y a l’image et sa voix, le vent peut-être, le froissement des feuilles. Y a-t-il des fruits cette année ?
Les printemps de l’enfance était bercés, en pointillés, de branches en branches, d’arbre en arbre, de ces petits plaisirs qu’on attrapait. Parfois acides, parfois habités d’un ver, rouges, grenats, jaunes pâles, ou celles, là-bas, cœur de pigeon. On n’hésitait pas à casser quelques branches, comme autant de bouquets de feuillages et de fruits. Mes préférées étaient les plus grosses, celles du cerisier près de la cour des poules : j’aimais leur couleur sombre, leur texture, leur douceur. A la tempête de décembre 1999, presque tous les arbres sont tombés à terre. Que j’avais de si prêt tenus, et tant aimés.
Mardi 21 mai 2019
Nous venons de rire de ce que tu m’as écrit, et qui fait que nous parlons ; tu ne voulais pas utiliser tes doigts.
Mais on ne rit plus. Tu me dis ta colère. Contre lui.
Tu me dis ce qui s’empare de toi tandis que dehors E fume, appuyé sur la rambarde écaillée. Je sors, ma voix résonne dans la cour, alors je vois qu’E joue, les petites formes colorées gigotent, clignotent, disparaissent, bling bling. Et puis je vais et je viens, évidemment en écrivant cela je pense à la chanson, la vague est irrésolue. Ton problème également.
Et puis c’est comme un brouillard d’été, quand le ciel envahit la plage : soudain l’horizon devient flou.
Et on ne rit plus. Et je voudrais être. Contre toi.
Lundi 20 mai 2019
16h27, quai de la gare de St-Pierre-des-Corps, Lana del Rey chante « Cause I love you so much, I fall to pieces » pendant qu’une femme marche, accompagnant le train de gestes d’au-revoir. Elle finit par baisser la tête dans un sourire ému quand le visage qui part est trop loin, cachant ce début de larme.
L’expression employée par R le matin-même fait écho à la scène : un pincement au cœur, m’écrivait-il avant de s’envoler de là-bas. Il m’envoyait alors un prénom et une image, sans le sourire que, d’après lui, je n’imaginais même pas. Yeux noirs, cheveux noirs. R aussi, ainsi, embrasse les continents. Il y avait eu l’Amérique. À présent devant lui cette Asie qui le pince.
Dimanche 19 mai 2019
Nous marchons sous la pluie, tu regardes Paris en rêvant d’un endroit à toi, Paris est grise et toi doré sous ton habit soleil. Nous marchons sous la pluie. Encore. Sous les arbres parfois on s’abrite un peu. On pourrait donc, comme dans ces films japonais, faire comme les enfants qui se demandent mutuellement quelle est leur saison préférée. On pourrait dire qu’on aime ce printemps instable qui nous pleut sur la tête, histoire de craner un peu, histoire de montrer qu’on s’en fiche et l’on rirait : aimer le beau temps c’est pas un peu banal ? Un peu banal et plutôt risqué : la déconvenue est vite arrivée.
Viens, demande-moi quelle est ma saison préférée. Je te dirais qu’elle est ici.
Samedi 18 mai 2019
Nous marchons sous la pluie. Je n’ai jamais cette folie de marcher ainsi, tu sais. Nous marchons ensemble, encore, un peu plus longtemps que prévu, puisque nous avons pris la mauvaise direction, comme cela m’arrive parfois le long des lignes aériennes. Je crois que c’est là que tu me dis que tu ne pleures jamais.