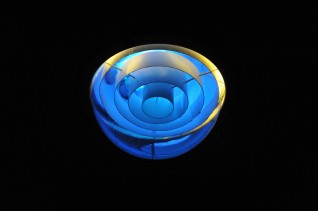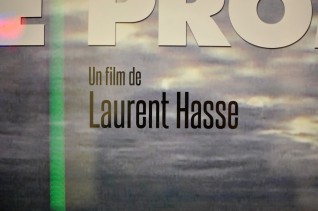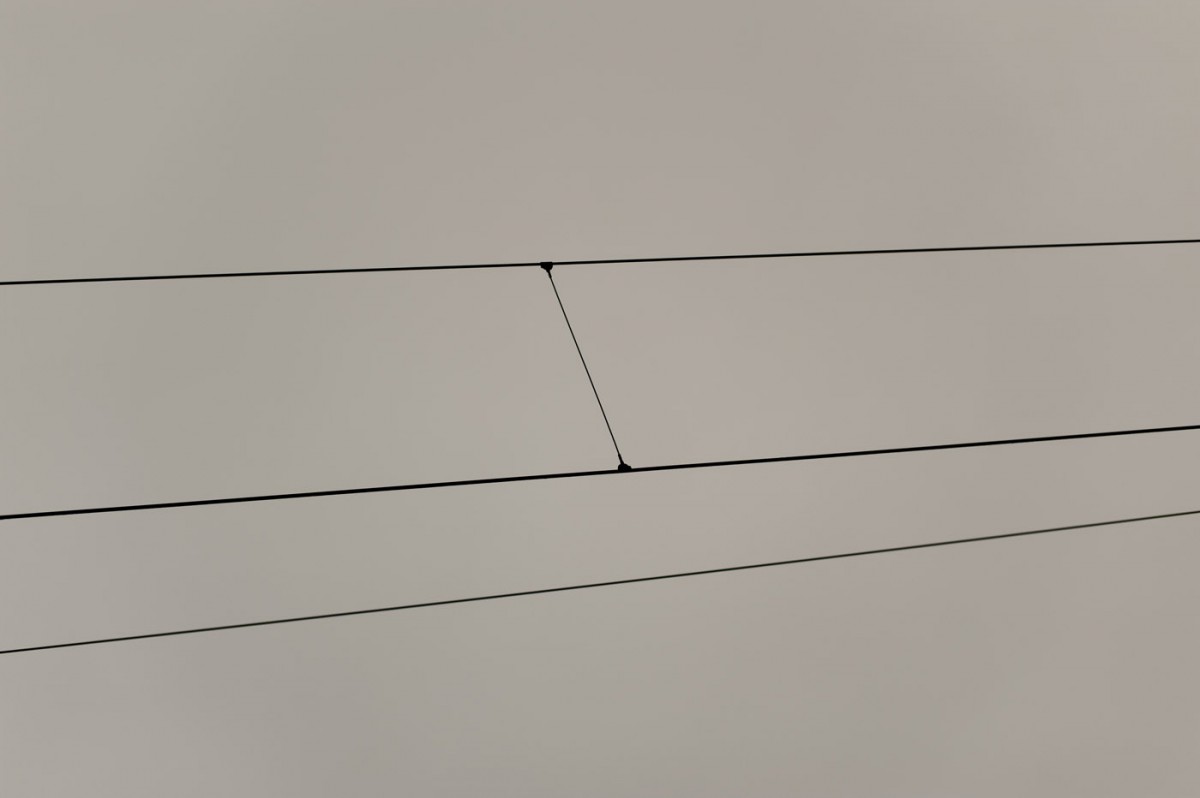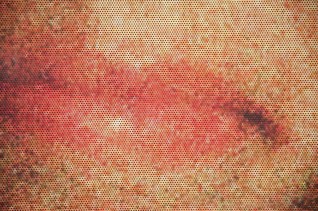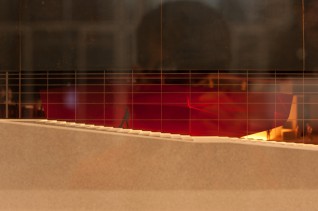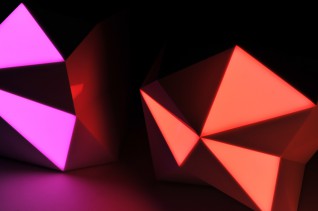De nouveau le chemin de Nogent. Ligne 7, ligne 6, RER A, bus 120. Dans le petit carnet gris, j’écris les questions que je me pose et qu’on va peut-être me poser. Et puis la journée passe, questions, réponses, surprises, oui oui je suis là. Au retour un chemin inédit, un moment improvisé, l’anniversaire de B. Les cocktails sont oranges, les bougies posés sur de petite hamburgers, les sourires aux lèvres, quelques visages très bronzés, bronzage Tanger, bronzage de nuit on pourrait leur faire dire, et déjà – enfin ! – les invitations à dîner qui reprennent. Un deuxième cocktail pour fêter ça?
Lundi 1er juillet
 Nous revenons ravis, moi peut-être encore plus car ravi de cette rencontre avec cette ville que tu connaissais déjà, ravi de mes retrouvailles avec l’Allemagne, seize ans après, peut-être même seize ans jour pour jour, il faudrait vérifier. Berlin, une respiration, une vraie, d’où l’on rapporte toi comme moi un souvenir aux pieds. Comment on dit lacet ?
Nous revenons ravis, moi peut-être encore plus car ravi de cette rencontre avec cette ville que tu connaissais déjà, ravi de mes retrouvailles avec l’Allemagne, seize ans après, peut-être même seize ans jour pour jour, il faudrait vérifier. Berlin, une respiration, une vraie, d’où l’on rapporte toi comme moi un souvenir aux pieds. Comment on dit lacet ?
Et puis c’est un autre retour, celui à la photographie. Jusqu’au 31 août je participe avec joie au projet Les Heures latentes à la Galerie Vivoequidem. Une photo par jour, prise avec mon téléphone. Une photo comment ? Je ne sais pas. Une photo comme ça, parmi les autres, une photo qui, peut-être, comme cette saison devenue grise, nous fera nous demander si c’est vraiment l’été.
Juin 2013
Jeudi 27 juin
Répéter. Répéter. Répéter. Répéter. Répéter. ad lib.
Mercredi 26 juin
J’aimerais que ce soit fini, j’aimerais passer définitivement à autre chose. Mais non. Dans deux jours la soutenance, point final à ce sujet qui se termine plutôt en points de suspension : il y aurait tant d’autres choses à dire.
Le tout balayé, revu, griffonné, répété et l’oral prend forme. Je le laisse mûrir jusqu’à demain et nous partons reprendre les habitudes d’avant, les expositions, les séances, les moments partagés. À la Maison d’art et d’histoire du Judaïsme, exposition La Valise mexicaine, avec les photos de Capa, Chim et Taro prises durant la Guerre d’Espagne. Sur les petits clichés des Asturies, de Barcelone ou de Barcarès, je me demande si je ne vais pas, par hasard, croiser un visage qui me ressemble : celui de mon grand-père. Les gueules sont coiffées de béret, tristes, combattantes, amaigries, figées, les corps sont meurtris, fatigués, enragés, morts. Ils reviendront peut-être bientôt sous une forme littéraire qui dépassera je l’espère la simple esquisse que j’ai jusque là dessinée. On quitte alors cette réalité historique pour un monde moins réel, plus délicat, celui de Romain Kronenberg, et puis pour encore autre chose entre poésie et astrophysique, le cinéma de Manuella Morgaine. Jolie retour protéiforme dans l’art…
Mardi 25 juin
Pour le dernier examen écrit on plongea chez Hermès, déclinant un nom, un slogan, des idées, un croquis. Ensuite on respira, plus tard on soupira car à la MEP il y a toujours des choix que je souligne d’interrogations. Mais à la MEP il y avait aussi de très belles choses, du noir et blanc évidemment et du Ferrante passé à la couleur.
Lundi 24 juin
Deux JL, oui deux. Le matin c’était Bourdieu (4 points) que soudain on déteste, Taylor (4 points) à propos de qui soudain on hésite, et puis le sentiment d’écrire des évidences (6 points) ou n’importe quoi (6 points).
Dimanche 23 juin
Un rayon de soleil, il est 20h04. La sociologie est un sport de combat, disait l’autre… Tu m’étonnes. Je me bats avec la sociologie depuis 48 h. Apprendre. Retenir. Surligner. Recopier. Analyser. Se passionner malgré tout, petit à petit, comprendre donc aimer.
Me revoici. Bel et bien. Les derniers examens approchent, demain c’est socio, vous l’aurez compris, sociologie des organisations, soyons précis. Après-demain marketing. Vendredi soutenance du mémoire. Vendredi c’est fini, c’est fini et on s’envole… en laissant derrière quatre mois intenses, passionnants, riches, frustrants peut-être un peu car les notes et les notions se sont entassées ; pas toutes dans mon esprit. Un virage, j’ai pris un virage, la route est joliment dégagée, le ciel aussi, le ciel qu’on prend vendredi pour Berlin. Bientôt je vous ferai lire autre chose, une nouvelle, une vingtaine de pages écrites, exercice stimulant, peut-être inachevé sous la contrainte du temps, peut-être réussi sous la contrainte du temps. Bientôt je vous montrerai d’autres images, galerie Vivoequidem, mes images parmi d’autres, presque anonyme parmi les presque anonymes.
Me revoici. Que ne vous ai-je dit depuis mon dernier passage (éclair) ? Que des belles choses : Les Apaches, L’Inconnu du lac, De l’influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites, les délicatesses au Palais de Tokyo (Elisabeth Clark, Oliver Beer, etc.) ou ailleurs (Pierre Leguillon), la Revue Gauche, magnifique Ange Leccia au Mac/Val, les 40 ans de W, Mad Men, etc.
Samedi 8 juin
On a vu passer 39 bougies qu’on a soufflé d’un trait net. On a vu Julien Perez, Tip Top ! et un mémoire presque achevé. C’est le « presque » qui fâche toujours, on espère pouvoir se relâcher mais non, il faudra encore relire. Relire et puis apprendre, réviser, revoir, retenir, reprendre son souffle.
Istanbul – mai
La première image d’Istanbul, c’est à l’aéroport, la foule de chauffeurs qui attendent à la sortie. Cacophonie, enchevêtrement de panonceaux avec des noms. Le tien au milieu de tout ça ? Ce sera à l’image de la ville, foisonnante.
Deuxième image d’Istanbul, après toutes celles attrapées à travers la vitre du taxi, c’est depuis la terrasse de l’hôtel. Il est 17h, les voix dans le ciel nous invitent, mais des petits hauts parleurs du bar sort celle de Phil Collins puis de Glenn Medeiros.
Ensuite ? Une poignée de jours et tant d’images qu’on trouve ici :
Jeudi 9 mai 2013
On aura vu passer quatre semaines en un éclair. Un ekler, comme l’écrivent les Turcs s’il est fourré d’une crème appétissante tandis qu’on regarde passer les bateau sur le Bosphore. Quatre jours à Istanbul, quatre jours ce n’est rien pour découvrir la foisonnante cité, son histoire et son visage, sa cuisine et son vin. Quatre jours c’était ailleurs et (donc) tellement beau.

Quoi d’autre avant cela ? Des respirations, des déconcentrations, un Time Based Exhibition, un Bouillon Racine, ce Guibert que tu m’offres, ce Perec que je reprends, cette nouvelle qu’il faut écrire, ces choses qu’il faut retenir et des films toujours, mais trop peu (et trop peu enthousiasmants) : Les Amants passagers, Flammes, The Land of Hope, The Libanese Rocket Society.
Et encore Duras :
Et puis une fois, vous êtes resté longtemps sans écrire. Un mois peut-être, je ne sais plus pour ce temps-là ce qu’il avait duré.
Jeudi 11 avril 2013
Un mois, un jour.
Te revoici d’un périple à l’autre bout, l’autre bout de quoi, d’un océan et d’un continent. Bronzé d’un ailleurs de terre rouge et de soleil, de cette Amérique de films qui fabrique quelques-uns de mes rêves en attendant que cela devienne des souvenirs, tu me dis, après tant de conversations, qu’au fait mon journal… Au fait ton journal ?
Mon journal, abandonné. J’ai l’esprit ailleurs, comprenez-vous, comprends-tu. Le mois est passé, vaste de lectures et de découvertes, d’apprentissages et d’un anniversaire peuplé de rares visages presque oubliés. Les feuilles mortes se seraient ramassées à la pelle si nous n’étions pas au printemps, un printemps froid que l’on éternue et que l’on voudrait voir bleuir. « Potlatchoum », pourrais-je donc résumer le mois qui vient de passer.
J’ajouterais quelques citations (« N’auraient-elles en commun, ces multiples solitudes {…} que la coïncidence non entièrement fortuite de leurs emplois du temps ? de Marc Augé, « J’suis là d’puis trois jours j’ai pas vu un seul film. » de Duras à Cannes ou « Pour moi l’Europe, c’était la neige » de Marguerite encore), Vincent Dieutre qui cherche Schubert dans l’hiver allemand, le Japon qu’on retrouvera en octobre, Camille Claudel et de la tête de veau, du sumo, et des photos, bientôt… Et puis l’homme immense, dans le matin frisquet.

Dimanche 10 mars 2013
Dix jours déjà. Jolie sonorité : dix jours déjà.
Je reviens ici, pour poser quelques mots, même si depuis hier je me dis que Twitter pourrait bien, durant ces quatre mois, prendre un peu le relais. Twitter, média facile pour noter les actes, les lectures, les liens, les moments…
Dix jours de cours, méthodo, sémio, anglo, sponso, stratégo… Échanges, paroles, découvertes, au départ on se regarde, on se tourne autour… D’un cours à l’autre, je change de place, de voisin, de voisine, de sourires, de méthode, de cahier. J’apprécie l’osmose, l’unité, la diversité, le plaisir que l’on a tous à être ici, l’énergie, la synergie, le binôme qui se forme devant la machine à café, le choix du sujet par curiosité, par envie, connaissance, projection, idées… Choisir c’est renoncer aux mille-et-un sujets auxquels j’avais pensés.
Le vocabulaire s’étoffe ou se précise – corpus, terrain -, les lectures s’étendent – Barthes, Foucault -, je te questionne, tu décryptes, je note, relis, relis, relis encore et encore pour comprendre et intégrer des notions tellement nouvelles.
Le soir et les fins de semaine offrent quelques moments plus habituels, des respirations, des partages, même si mon regard est déjà imprégné de ce que j’ai commencé à apprendre. Au Palais de Tokyo on se penche sur Roussel et on s’épanche sur Julio Le Parc, sur le petit écran on quitte Pialat et sa Maison des Bois, au Jeu de Paume on espérait (et je m’énerve face au léger flou sur le rôle de Laure Albin-Guillot durant le Régime de Vichy), à La Tourelle on tête-de-veau, au cinéma on coq-à-l’âne (Blanca Nieves, Sugar Man, 5 caméras brisées)…
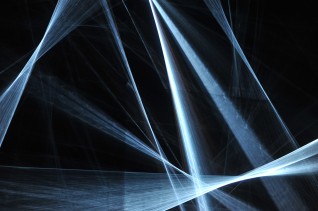



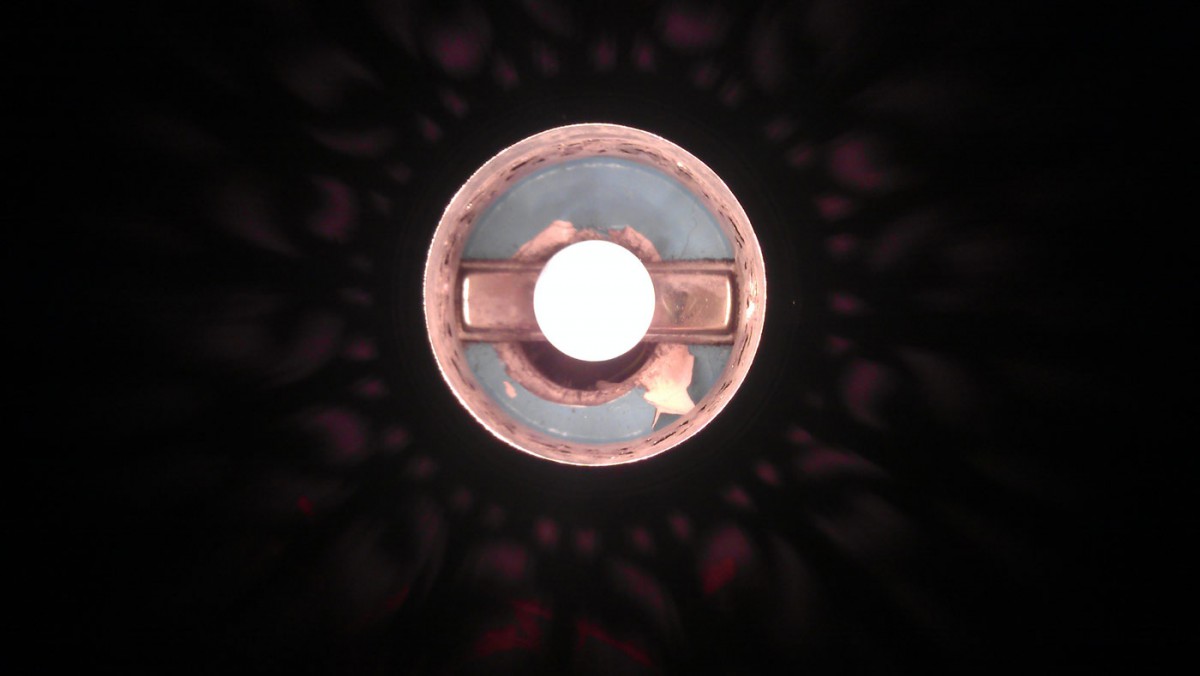
Février 2013
Jeudi 28 février
Je regarde l’heure encore, encore et encore, avec cette crainte d’être en retard, cette crainte de la panne du métro. Je me demande si ces cheveux, là, sur le côté, c’est une bonne idée, en tout cas ça me fait perdre du temps, ce n’est pas très agréable, cinq minutes perdues, les yeux dans la glace, les doigts crispés, le cheveu retenu, chauffé.
Je me demande aussi si je continuerai à tenir ce journal pendant quatre mois. L’esprit sera ailleurs, dans les lectures, les apprentissages et les révisions. L’appareil photo aussi sera ailleurs ; pas dans le sac mais sur le bureau. Quatre mois différents, n’est-ce-pas ?
Mercredi 27 février
« Dernier » jour. Je me presse, me disperse moins que d’habitude, il faut boucler ceci-cela, expliquer à C. que oui c’est le flux habituel. « Dernier » jour, demain j’entame quatre mois bien différents.
Et puis il y a Godard, accompagné de Labarthe. Enfin c’est plutôt l’inverse. Après le film (Godard, le désordre exposé) , Labarthe hausse les épaules, histoire de dire qu’il n’a rien à dire. Mais ça ne dure pas, il a un micro dans les mains, pris comme ça, et puis voilà, il parle : le silence, la façon de faire des films, le silence encore.
Mardi 26 février
…
Lundi 25 février
Je ne dors pas. Je ne lis pas ce roman dans lequel je passe du plaisir à l’ennui. J’écoute Alela Diane. Je n’entends rien autour. Il fait jour. La vitre est peut-être un peu sale, un peu abîmée. Le ciel est bas. Je regarde à travers la vitre des paysages qu’habituellement j’ignore, des infrastructures qui défilent le long des voies. Elles ont un visage que je ne connais pas car souvent il fait nuit, souvent je dors, souvent je lis. Elles sont des fantômes, des images d’ailleurs. Sur le sol une graine verte. Il fait froid.
Au Palais de Tokyo on inaugure. Visites rapides – on reviendra -, discussions plus longues – pourtant on ne entend pas. Parmi les visites, de belles surprises qui vous embarquent, des sourcils qu’on fronce ou une exclamation devant une référence : « Oh ! Le catalogue des objets introuvables. »
Dimanche 24 février
Finalement ils choisissent le champ de coton pour l’affiche, je cède, ou plutôt je m’incline et je la décline – un tract, un truc. D’un champ on passe aux prés grignotés par les moutons de l’Hiver Nomade, puis à un autre genre de solitude, bien plus triste que celle d’une berger, une solitude subie, une solitude cachée dans une cuisine trop grande pour soi, dans un canapé aux motifs passé. Mais dans ce Silence radio on aurait aimé un autre rythme, moins de ceci, plus de cela. Un Paroles radio peut-être ?
Au fait comment on dit cot cot en allemand ?
Samedi 23 février
L’Impossible, Guy de Cointet, La Maison dans les Bois.
Aucun rapport entre les trois.
Vendredi 22 février
Jeudi 21 février
 Sur le sol du tramway la double page avachie. Le sac du garçon gêne un peu le cadrage mais finalement ils partent, lui et son ami. Derrière, entre les sièges, il y a le reste du journal, au même endroit que, l’autre jour, il y avait déjà un reste de journal ; un journal entier peut-être. Il était plié, je n’y ai pas touché, je ne sais pas. Ça aurait fait une photo, ce papier fripé au milieu des sièges trop neufs et trop acidulés, mais je n’ai pas osé. Bref. Dans une semaine j’aurai pris le virage mais ne prendrai plus ce tramway et ses jingles à peine « sympa ». Tu souris en lisant l’adjectif « sympa » ? Dans une semaine j’entamerai quatre mois de formation, quatre mois d’études, de l’autre côté, là où Neuilly caresse Levallois, un ailleurs géographique qui ne me ressemble pas vraiment. Dans une semaine… déjà ?
Sur le sol du tramway la double page avachie. Le sac du garçon gêne un peu le cadrage mais finalement ils partent, lui et son ami. Derrière, entre les sièges, il y a le reste du journal, au même endroit que, l’autre jour, il y avait déjà un reste de journal ; un journal entier peut-être. Il était plié, je n’y ai pas touché, je ne sais pas. Ça aurait fait une photo, ce papier fripé au milieu des sièges trop neufs et trop acidulés, mais je n’ai pas osé. Bref. Dans une semaine j’aurai pris le virage mais ne prendrai plus ce tramway et ses jingles à peine « sympa ». Tu souris en lisant l’adjectif « sympa » ? Dans une semaine j’entamerai quatre mois de formation, quatre mois d’études, de l’autre côté, là où Neuilly caresse Levallois, un ailleurs géographique qui ne me ressemble pas vraiment. Dans une semaine… déjà ?
Mardi 19 février
Le métro n’est pas encore arrivé à Nation, il reste deux stations. J’entends dans le wagon d’à-côté un air d’accordéon : L’histoire d’un amour. Je me dis qu’ils pourraient jouer autre chose, que zut… Une correspondance plus tard, un RER, le livre à peine sorti du sac, en face elle fait des mots croisés, il monte avec son instrument. Tilalalala tilalalala tilalaaa… Le même air, tout autant écorné.
Le soir un bic. Quatre couleurs évidemment.
Lundi 18 février
Hitchcock.
(Je pense que jusqu’au 1er juillet, ce journal va ressembler à ça)
Dimanche 17 février
Habemus papam. L’habemus vidi… heu… vidimus ?
Samedi 16 février
Comme témoignage des origines – comme témoignage de la fin, il y aurait donc cette photo, prise pendant l’été 1918, que Marcel Antonetti s’est obstiné à regarder en vain toute sa vie pour y déchiffrer l’énigme de l’absence.
Le Sermon sur la chute de Rome – Jérôme Ferrari
Jeudi 14 février
Finir le livre, ne plus pleurer. Retrouver un peu de l’Ange exterminateur de Bunuel. Écrire un peu, chercher comment.
Mercredi 13 février
Tu n’es pas là. Pas envie de rentrer tôt, enfin tôt c’est relatif. Sur les affichettes du MK2 les horaires (de début ou de fin) ou les pitches ne (me) conviennent pas, je traîne mes semelles malgré le froid. Avenue Victoria, un regard à gauche. Au fond l’hôtel de ville scintille encore. Devant lui, la nappe blanche de la patinoire sévèrement éclairée et quelques individus qui y glissent. Curiosité photographique ou curiosité tout court, me voilà au bord de la piste ; on annonce la location est terminée. Une sorte de spectacle commence, un jeu bien sûr entre eux mais un spectacle pour moi. Ils se poursuivent, s’évitent, je ne sais pas trop s’il y a une règle… sorte de « chat » sur lames. Leur agilité me surprend, leurs cris m’amusent, leurs sauts me fascinent, leur vitesse m’effraie, leurs bras nus me glacent. Devant l’objectif ils passent trop vite, trop loin, c’est aussi une part du jeu : attraper leurs mouvements, leur folie.
Mardi 12 février
 J’ai encore oublié le nom mais devant le cinéma, essoufflé, l’affiche m’aide à m’adresser au guichetier. C’est salle 3, dans la petite rue, il fait signe avec la main. Tu m’attends devant je le savais, je vous passe les détails, nos échanges de sms, tes paroles qui me disant que si, ce sera dans la petite rue pour le ticket aussi. Mais c’était quoi le nom du nom ? Patatrac ? Ca irait bien Patatrac, l’idée d’une chute, celle d’un film qui commence de manière presque enthousiasmante mais qui…
J’ai encore oublié le nom mais devant le cinéma, essoufflé, l’affiche m’aide à m’adresser au guichetier. C’est salle 3, dans la petite rue, il fait signe avec la main. Tu m’attends devant je le savais, je vous passe les détails, nos échanges de sms, tes paroles qui me disant que si, ce sera dans la petite rue pour le ticket aussi. Mais c’était quoi le nom du nom ? Patatrac ? Ca irait bien Patatrac, l’idée d’une chute, celle d’un film qui commence de manière presque enthousiasmante mais qui…
Samedi 9, dimanche 10, lundi 11 février
Le hasard est divin. Il s’est glissé en même temps que le vieux cédérom dans mon lecteur, le vendredi soir, comme ça, au pif. Un parmi des dizaines, avec un léger indice écrit d’une autre main que la mienne. Sur le disque, des photographies, des fichiers qu’il faudra décrypter, le début de quelque chose. Au milieu de ces trois jours, grâce à ces quelques éléments fragiles, je commence à écrire autre chose que ce journal, autre chose que ma vie, une autre vie que la mienne comme dirait l’autre – vous savez, celui qui est écrivain. Je ne sais pas quelle forme cela prendra, il va falloir creuser, peut-être poser des questions, avancer doucement, essayer que ça ne ressemble pas trop à ce qu’on lit ici, peut-être accepter que cela ressemble à ce qu’on lit ici, des formes légères, des petits riens, même si j’espère autre chose… mais quoi exactement ?
Jeudi 7 février
 Lire le manifeste de XXI, essayer d’en retenir quelque chose pour les dîners, les discussions entre collègues, les mois qui viennent, etc.
Lire le manifeste de XXI, essayer d’en retenir quelque chose pour les dîners, les discussions entre collègues, les mois qui viennent, etc.
Sentir le parfum de Philippe M dans le métro.
Profiter des soldes, c’est à dire aller acheter deux chemises. Payées, je me retourne. Le mouvement de trop, le regard qui se pose sur les vestes juste derrière, le coup de cœur, l’envie, l’hésitation, le regard de la banquière, la penderie déjà pleine, la pensée pour cette veste demi-saison qui n’est plus portée, l’essayage, une taille puis une autre, à nouveau la première, à nouveau la plus grande, les détails – les boutons, la doublure -, une pensée pour cette veste non achetée chez M&FG, et puis la patronne qui attaque sec : les grands mots, les superlatifs, les comparaisons, les 50%, la coupe parfaite, les compliments, rendez-vous compte.
Mardi 5 février
Le premier film se promène dans les rues du 13ème, moment doux et étrange, bancal, surprenant. J’aime cet improbable, pas cette robe, nous sommes d’accord. Puis ils dansent. Comme hier ? Non, pas comme hier. Pourtant A était déjà là, ou plutôt on y était pour lui. Le deuxième film déjà vu, pas le même pourtant, plus radical à l’époque, bien plus long, qu’est-ce qu’on y gagne ? qu’est-ce qu’on y perd ? qu’est-ce qu’on en pense ? Et si sur le moment on n’en pensait rien ? D’ailleurs voilà O&A, passons donc à table.
Lundi 4 février
 « Ce n’est pas une expo photo ? » Non ce n’est pas une expo photo. Les invitations Facebook génèrent quelques surprises pour l’invité qui n’a pas vraiment fait attention. Non ce n’est pas une expo photo, ce sont des films, des courts métrages, parmi lesquels je retiendrai celui de… quel est son nom ? oui c’est ça, ce film sur Marseille, avec ses gens qui dansent dans la rue, j’aime cet élan de liberté des gens qui dansent dans la rue, en pull rouge de surcroît.
« Ce n’est pas une expo photo ? » Non ce n’est pas une expo photo. Les invitations Facebook génèrent quelques surprises pour l’invité qui n’a pas vraiment fait attention. Non ce n’est pas une expo photo, ce sont des films, des courts métrages, parmi lesquels je retiendrai celui de… quel est son nom ? oui c’est ça, ce film sur Marseille, avec ses gens qui dansent dans la rue, j’aime cet élan de liberté des gens qui dansent dans la rue, en pull rouge de surcroît.
Non, l’expo photo c’était à midi, pause-déjeuner qui s’étire pour la visite commentée de l’exposition Undercover. J’avais déjà vu les images, j’avais même écouté le photographe. Mais j’en voulais plus. Je voulais le regard de Giulia sur tout cela, son approche, sa vision des faits et du geste. J’avais aussi envie que les images me racontent autre chose, quelque chose que je n’avais pas encore vu, pas compris, pas absorbé. Mes yeux et ses paroles, duo, donc. Mes paroles aussi, un peu, j’ai envie de décortiquer, de partager, peut-être parce que je les comprends, que c’est donc plus simple d’aller plus loin dans la lecture de ces images. J’analyse, je réfléchis, je propose, je propose de sortir l’image du contexte, je m’étonne de cette photo gigantesque qui trompe nos habitudes – nous voici soudain plus petit que la photographie, plus petits que ceux qui sont photographiés. Photographiés et en guerre. En sang. En proie.
Dimanche 3 février
MEP. 10 ans d’Images, certains connues voire adorées – Tournaboeuf évidemment, encore, encore – et puis Loretta Lux et ce The Walk que je fixe, fixe encore, encore. Aux étages supérieurs Meyerowitz m’entraîne follement dans ces premières années colorées… les années suivantes et le reste vite oubliés.
Puis la pintade. Puis la peinture. Enfin l’Appât (ni tade, ni ture, un peu tatarte ?)
Samedi 2 février 2013
Ma séance est élaguée, la tienne rallongée. Je les rejoins, ils me demandent où. Tu nous rejoins, ils me demandent quand.
Janvier 2013
Jeudi 31 janvier
Un regard sur Paris, la Seine a une couleur de purée de châtaigne. À ma gauche elle lit la Bible. Elle face d’elle, quelque chose dans le visage… un air de Lou Doillon. Soudain en face de moi, elle s’assied, brusquement, elle qui vient de monter. Elle se contrefiche de Lou Doillon, de la gêne, de son sac-à-dos, elle penche la tête, ferme les yeux que je devine derrière ses cheveux. J’échange un regard et un sourire avec Lou, fatalité des transports. Je replonge dans les Tropismes de Sarraute. Plus tard elles parleront des morts et des fantômes. Plus tard encore de la Danse ou d’autres courts.
Mercredi 30 janvier
C’est à la gare de Noisy-le-Sec que j’ai refermé le livre. L’adjectif sec pouvait effectivement convenir. Dans le roman il y était question d’un livre lu par la sœur ; la mère insistait sur ce perroquet multicolore imprimé sur la couverture.
 Je remontais la rue Custine, la projection de Babylon m’attendait, j’avais les doigts encore un peu gras de cette part de quiche avalée rapidement. Sur le trottoir, le bouquiniste avait sorti quelques tréteaux : des livres d’occasion. La jeune femme qui descendait la rue et qui s’arrêta devant les ouvrages en choisit un, au hasard. Sur la couverture : un perroquet multicolore. Merveilleuse coïncidence, je jetais un oeil rapidement : Cent ans de solitude de Garcia-Marquez. La lycéenne du roman d’Yves Ravey était devant moi, elle ne savait pas encore ce qu’il allait lui arriver.
Je remontais la rue Custine, la projection de Babylon m’attendait, j’avais les doigts encore un peu gras de cette part de quiche avalée rapidement. Sur le trottoir, le bouquiniste avait sorti quelques tréteaux : des livres d’occasion. La jeune femme qui descendait la rue et qui s’arrêta devant les ouvrages en choisit un, au hasard. Sur la couverture : un perroquet multicolore. Merveilleuse coïncidence, je jetais un oeil rapidement : Cent ans de solitude de Garcia-Marquez. La lycéenne du roman d’Yves Ravey était devant moi, elle ne savait pas encore ce qu’il allait lui arriver.
Mardi 29 janvier
Et ma mère, qui s’était mise, dès le décès, à chercher du travail, s’était d’abord demandé s’il ne l’avait pas invitée pour qu’elle fasse le ménage de l’étude après dix-huit heures. Mais elle aspirait à un emploi plus stable.
Un notaire peu ordinaire ; Yves Ravey
(Le titre n’est pas bon, le livre excellent)
Ne pas oublier les shorts si courts sur les lycéennes à l’esprit rebelle et au corps étonnamment réchauffé. Je réalise le lien avec le titre du film vu le soir, Les Herbes folles, un Resnais peut-être un peu tiède. Dis Alain, tu veux pas monter le chauffage ? les lycéennes vont s’enrhumer…
Lundi 28 janvier
La foule, la foule et la chaleur, une forêt de gens, de jambes. Et de radiateurs vraisemblablement. Je te cherche, aucun visage connu, puis un seul, brouhaha, vos lèvres bougent mais que disent-elles ? Je tourne entre les gens qui ont un verre à la main et les œuvres qui n’ont pas de cartels, je n’ai pas d’information, je ne sais rien, presque rien puisque j’ai les noms des auteurs sur une double-page de biographies, je pourrais jouer au jeu de piste, deviner qui fait quoi mais non, je m’arrête simplement devant les plus belles pièces et leur sombre ou brillant mystère mais dans la petite salle sombre comment voulez-vous que je suive ? (brouhaha, paroles en anglais, pas de sous-titre, appelez-moi le commissaire).
En sortant (de la Fondation Ricard, faut-il le préciser ?), on décide de marcher un peu, c’est une bonne idée, mais prenons la rue St Honoré, on évitera la circulation rivolienne. Sur une vitrine quelques kanji, quelques plats factices, il suffit d’un demi-instant pour cesser d’hésiter. On pourrait parler ensuite de l’arrivée de Patrice C dans la gargote japonaise tandis que je me brûle la langue en lorgnant sur ton plat de ramen au boeuf, mais je ne suis pas sûr que le mot gargote convienne.
Dimanche 27 janvier
Il y a eu ce déjeuner avec J, D et C puis un autre type d’effervescence ; nous voilà alors si nombreux dans les rues de Paris, revêtus de couleurs ne se limitant pas à ce bleu et ce rose layette qu’on veut nous faire avaler au milieu d’autres clichés, d’autres discours aveugles ou sombres. Sur le bitume on manifeste le ras-le-bol de les entendre, la peine qu’on a à les écouter et surtout la fierté d’être entiers, d’être nous-mêmes, d’être heureux comme le sont ces enfants qui naissent déjà en dehors de leurs sentiers. Nous voilà unis dans la certitude que la famille est un mouvement, un ensemble indéfini et complexe qui brandit des pancartes contre les simples et les sourds. Unis, mais on n’y croise pas de visage connu avant de quitter le cortège, avant cette boisson chaude dans l’ambiance remuée du Bûcheron. Et puis deux arrondissements plus loin, les saveurs japonaises et les rires de B et J, effervescence vous dis-je…
Et Kurt Russell ? Ben il est à New York, il fait du planeur…
Samedi 26 jnvier
 Un plateau, une colline, une rue, des Pyrénées, géographie parisienne… Au Plateau tout d’abord, c’est un peu confus, mais tant que ça creuse (dans le temps, dans l’esprit) on prend. Puis à travers la vitrine c’est le hasard d’un F qui justement ne répondait pas (au téléphone, au téléphone) mais les petites assiettes sont déjà vendues. Enfin La Colline, Tristesse Animal Noir, titre splendide et pièce tout autant, pièce dont on parlera(it) des heures et dont je vous offrirai(s) une image, une seule image, la cendre qui tombe en rideau ; elle scintille malgré tout, malgré les mots sur lesquels elle se pose.
Un plateau, une colline, une rue, des Pyrénées, géographie parisienne… Au Plateau tout d’abord, c’est un peu confus, mais tant que ça creuse (dans le temps, dans l’esprit) on prend. Puis à travers la vitrine c’est le hasard d’un F qui justement ne répondait pas (au téléphone, au téléphone) mais les petites assiettes sont déjà vendues. Enfin La Colline, Tristesse Animal Noir, titre splendide et pièce tout autant, pièce dont on parlera(it) des heures et dont je vous offrirai(s) une image, une seule image, la cendre qui tombe en rideau ; elle scintille malgré tout, malgré les mots sur lesquels elle se pose.
Mercredi 23 janvier
 Dans le Forum de Beaubourg on passe assez vite, enfin vous je ne sais pas… Depuis quand êtes-vous là ? Un oeil sur ces miniatures ; j’en ne cherche pas le sens. Un oeil sur ces imprimantes 3D ; j’y trouve quelque chose de fascinant.
Dans le Forum de Beaubourg on passe assez vite, enfin vous je ne sais pas… Depuis quand êtes-vous là ? Un oeil sur ces miniatures ; j’en ne cherche pas le sens. Un oeil sur ces imprimantes 3D ; j’y trouve quelque chose de fascinant.
Au cinéma La Clef, dont je n’avais jamais poussé la porte, quelques jours de pêches en Patagonie nous entraînent à l’autre bout du monde. À la fin du générique je suis surpris et dodeline : Bill Callahan chante…
Lundi 21 janvier
La page marquant le chapitre XIV a le coin plié. Déplié, un triangle rectangle de 3,8 sur 5 centimètres marque le coin en haut (et évidemment à droite) de la page 85. Ton nom est écrit en haut à droite de la première feuille, marquée d’un 4 en petit caractère, en bas. L’ouvrage a été achevé d’imprimer le 10 juillet 1980. La première édition chez Minuit date de 1957. La première édition date de 1939. Je lis :
Ils semblaient sourdre de partout, éclos dans la tiédeur un peu moite de l’air, ils s’écoulaient doucement comme s’ils suintaient des murs, des arbres grillagés, des bans, des trottoirs sales, des squares.
Ils s’étiraient en longues grappes sombres entre les façades mortes des maisons. De loin en lin, devant les devantures des magasins, ils formaient des noyaux plus compacts, immobiles, occasionnant quelques remous, comme de légers engorgements.
Le reste du court chapitre est du même ordre, les mots glissent au milieu du brouhaha du métro et de mes pensées, ces pensées qui m’entraînent ailleurs malgré la beauté du texte. Récemment tu m’avais demandé qu si j’avais lu Tropismes ; à la radio on parlait de Sarraute. Tu avais ajouté que c’était magnifique.
Dimanche 20 janvier
Je crois que c’est avant de partir que je suis allé voir… G.A. m’avait parlé de son travail parce que je lui avais parlé de ma recherche, de mon envie de petits livres, d’objets, petites choses simples, mais en écrivant cela je pense à d’autres choses, peut-être plus fragiles. Je pense à ces jours photographiés qui restent là, dans l’état où vous les voyez, j’imagine une sélection d’images, peut-être des mots ici ou là ; n’oublions pas les voyages. Bref : je suis allé voir le beau travail de Laurent Champoussin avant de partir. Partir où ? Aux Tuileries, blanches, tachées de vert – personne pour s’asseoir – et de silhouettes noires – les arbres, les autres, toi tu étais assorti aux accoudoirs.
Au Jeu de Paume, là-bas à l’autre bout, on glissait sans s’arrêter vraiment devant Manuel Alvarez Bravo, juste histoire de mettre des images sur le nom, d’en parler une autre fois. Pour Muntadas c’est autre chose, je m’arrête et je m’interroge, ça m’attrape, même si c’est simpliste, même si c’est un peu évident comme message, comme critique, comme dénonciation, j’apprécie certains dispositifs et puis il y a Alphaville, quelques secondes la voix d’Anna Karina, comment se plaindre ?
Plus tard, C, et l’inattendu : Pierre La Police. Voici que je feuillette et que je ris.
Vendredi 18 janvier
Première image. Il parle du lieu, de la position, du choix, de la perspective, il fait référence à Capa, Ristelhueber, Anthony Hernandez parce qu’un homme court penché, parce que la guerre a laissé un trou dans la route, parce que le poteau est au milieu. Deux photos plus tard, je suis surpris pas les ombres que je n’avais pas vues malgré les longues secondes devant l’image. Mais ensuite ? Trop d’anecdotes, je crois que j’attends autre chose, quelque chose qui ne viendra pas ; il ne faut rien attendre, écouter simplement, accepter ce que le photographe a à nous dire. Par exemple il dit que les gens de dos, sur la photo, ça permet au spectateur de se projeter. Je souris. La neige a commencé à tomber, je vois les minutes qui passent, je ne pose pas toutes les questions qui me viennent à l’esprit, juste une remarque sur cette image fascinante dont je t’avais parlée, cette impression d’immensité, de distance, ces pierres qui semblent ne devoir jamais atteindre leur but.
Je quitte ce moment avant les autres, je presse un peu le pas, je m’arrête pour profiter du moment, ces flocons qui transforme le paysage urbain. Dans le RER celui-là qui tremble, les mains bleutées qu’il regarde, les doigts qu’il fait bouger lentement, le froid ou pas ? Paris, métro Couronnes, trottoir blanchi… S & P. Est-ce épais ? Oui, quelques bons centimètres de neige. Et puis ce ciel orange.
Jeudi 17 janvier
Le fond de l’air est frais, et encore un peu rouge.
Mercredi 16 janvier
Nous nous voyons tous les jours, D. et moi. Nous parlons de Rabier. Je lui raconte ce qu’il dit. J’ai beaucoup de mal à lui décrire son imbecillité essentielle. Celle-ci l’enveloppe tout entier, sans marge d’accès. Tout relève d’elle chez Rabier, les sentiments, l’imagination et le pire de l’optimisme.
Monsieur X., dit ici Pierre Rabier, Marguerite Duras
Et tandis qu’au matin, un jeune blond avachi devait virer son pied du fauteuil sur lequel j’allais m’asseoir en grommelant quelque chose à son encontre, quelque chose qui l’indifférait, tout comme m’indiffère soudain la concordance des temps, voici qu’au soir j’abandonnai à son triste sort la femme en bonnet et bottines rouges qui m’avait accompagné jusqu’au RER mais qui venait de passer sous le portillon sans avoir vu, le croirez-vous ?, la horde de contrôleurs qui patientaient avec leur veste vert bouteille et leur air satisfait. Les freins du train se faisaient entendre en gare, il me fallait filer puisque il était bien tard. Elle et moi revenions du même endroit, mais je crois que nous n’avons pas parlé des photographies de Matthias Bruggmann sur le chemin glissant. Tant d’autres choses à se dire.
Mardi 15 janvier
 On revint au musée sur l’histoire de l’industrie locale, locale mais étendue, étendue dans le temps jusqu’à ce que la haute cheminée de Kodak s’effondre. Je te retrouvai ensuite chez J, le tarama était à l’oursin, au fond du vase on voyait le visage ; mais ce n’était qu’une impression, une belle impression de biscuit sur papier, une belle collection d’objets insolites, délicats, de ceux qu’on poserait rêveur ici ou là, non plutôt là.
On revint au musée sur l’histoire de l’industrie locale, locale mais étendue, étendue dans le temps jusqu’à ce que la haute cheminée de Kodak s’effondre. Je te retrouvai ensuite chez J, le tarama était à l’oursin, au fond du vase on voyait le visage ; mais ce n’était qu’une impression, une belle impression de biscuit sur papier, une belle collection d’objets insolites, délicats, de ceux qu’on poserait rêveur ici ou là, non plutôt là.
Lundi 14 janvier
Face à la cheminée, le téléphone, il est à côté de moi. A droite, la porte du salon et le couloir. Au fond du couloir, la porte d’entrée. Il pourrait revenir directement, il sonnerait à la porte d’entrée : « Qui est là. – C’est moi. »
La Douleur, Marguerite Duras
On me demande « Alors ? » et je parle du calme, des soirs, etc. Je suis encore un peu là-bas, ça se voit il parait. Dans le placard le paquet est improbable (scotch camouflage, guirlande de timbres), l’intérieur rouge et… marron. Ah oui marron.
Dimanche 13 janvier
On laisse tomber le Plateau, notez la majuscule. On reste ici, par exemple pour retourner à Venise, écrire deux jours qui flotte encore sur la lagune. Il faudrait peut-être en dire plus et sûrement le dire mieux. Mais ce sera pour plus tard. Sur le petit écran, Road One, deuxième partie, un voyage si beau, simple en apparence, des rencontres et même des pélicans.
Et puis.
Et puis tout ceux-là. Après avoir marché en vain, brandissant leur petit slogan au-dessus de leur petit esprit, ils ont allumé leur téléviseur en espérant que leur voisin les verrait dans le poste. Ils ont alors vaguement découvert que la France est plus ou moins en guerre. Mais il s’en foutent, c’est l’Afrique.
Samedi 12 janvier
Elle se souvenait qu’il y avait un parapluie en fourrure. On ne s’est pas vraiment demandé si c’était vrai ou faux. C’était vrai. Dans ce Robinson Crusoé de Luis Buñuel, l’homme seul sur la plage tient un parapluie de fourrure, qu’on qualifiera de parasol, d’ombrelle plutôt, en tout cas il ne pleut pas.
En revanche chez certains il y a quelques nuages, alors on invite P.
Dimanche 6 janvier 2013
Et la reine embrassa le crapaud en plastique…
Samedi 5 janvier 2013
À la MEP c’est toujours un peu pareil, toujours un peu de tout, de quoi faire plaisir à tout le monde, ne pas faire trop de vague sur des cimaises qui se veulent un regard généraliste sur la photo. On s’embourbe dans des vignettes décoratives, on part dans une petite ville américaine pour un joli regard, et surtout on s’embarque dans cinquante ans de photographies françaises, il y a de très belles choses, les incontournables, mais on lit soudain cela pour accompagner la photographie des années 90 :
Pourtant, chacun sent qu’une page se tourne, qu’un âge d’or de la photographie est en train de se clore. L’intrusion de la technologie numérique remet en question les fondements du reportage, modifie la perception de la photographie traditionnelle et pose la question de sa pérennité.
On tique. On décortique le mot « intrusion ». On déplore. Est-ce une manière maladroite d’exprimer une simple nostalgie ou est-ce purement passéiste ? Est-ce écrit sur un autre mur que la photographie numérique ouvre encore plus le champ de cette pratique, surtout avec les progrès technologiques en cours ? Nous explique-t-on ensuite en quoi les fondements du reportage ont été remis en question ? Bref, allons donc prendre l’air…
Le soir, l’air pris, et les transports aussi, on parlera (par exemple) de la brioche.
Vendredi 4 janvier 2013
L’addition nous fut apportée, écrite sur le fond d’une assiette. Elle montait assez haut, mais nous avions fait un dîner délicat et curieux, et en qualité d’étranger nous devions payer un tiers de plus qu’un naturel du pays – pour les fais de traduction – ; il n’y avait rien à dire, aussi ne fîmes-nous pas la moindre observation et le pêcheur nous reconduisit jusqu’au traguet où nos gondoles nous attendaient.
Voyage en Italie (Venise) ; Théophile Gautier
 Je n’ai pas en bouche le goût du café, et pourtant la tasse est vide. Je l’ai belle est bien lavée, mais comment l’ai-je vidée ? C’est encore le matin, je suis ailleurs, somnambule, fatigué, que sais-je… Le nous de Théophile Gautier n’est ni un singulier ni un pluriel, ou un singulier ET un pluriel. Et moi, que vais-je raconter sur Venise ? Et comment ? Avec un nous, évidemment. En attendant Venise on s’embarque le soir au Japon avec les saveurs de chez Miki : œufs de poisson, gingembre, yuzu… J’ai aux pieds cette nouvelle paire de chaussures mais qu’en dire ici ?
Je n’ai pas en bouche le goût du café, et pourtant la tasse est vide. Je l’ai belle est bien lavée, mais comment l’ai-je vidée ? C’est encore le matin, je suis ailleurs, somnambule, fatigué, que sais-je… Le nous de Théophile Gautier n’est ni un singulier ni un pluriel, ou un singulier ET un pluriel. Et moi, que vais-je raconter sur Venise ? Et comment ? Avec un nous, évidemment. En attendant Venise on s’embarque le soir au Japon avec les saveurs de chez Miki : œufs de poisson, gingembre, yuzu… J’ai aux pieds cette nouvelle paire de chaussures mais qu’en dire ici ?
Jeudi 3 janvier 2013
On choisit le bar en face du petit train illuminé pour parler d’Hector. L’un a toujours des découvertes à raconter, il connait le lieu, me dit que « Là, c’est rien » à propos du serveur que je regarde surpris, à croire que j’ai encore des a priori sur les bars un peu désuets.
Mercredi 2 janvier 2013
J’ai beau dormir, je ne dors pas. L’air du saxophoniste à sourdine est agréable et j’ouvre donc un oeil, plutôt vers la gauche où j’aperçois la une du Canard Enchaîné entre les mains d’un autre voyageur. Je ris. Et rirai aussi un peu devant Les Habitants, fable absurde où la sauce (hollandaise) prend plutôt bien.
Mardi 1er janvier 2013
Il faudra trouver un cahier neuf pour ce nouveau janvier, pour l’instant c’est à décembre que les mots restent collés. Les premiers mots de l’an y sont sous forme de liste, peut-être pour se donner le sentiment de ne rien oublier :
– Trouver un nouveau cahier
– Film (dvd) : Le fond de l’air est rouge. Un peu confus, autant que la situation de l’époque ?
– J –> clés
– Bûche chez S et L
Sachant que les photos serviront aussi de pense-bête, je n’ajoute pas cette promenade au Jardin tropical, jamais visité malgré sa proximité – voire sa fusion – avec Nogent. Le lieu n’est pas oublié : des panneaux flambant neufs nous informe clairement de son histoire. Mais l’aspect délabré de certains éléments offre un visage plutôt triste de cet ailleurs longtemps abandonné et de cet autrefois qu’on ne doit pas oublier.
Vendredi 11 janvier 2013 – Venise
Le gardien de San Marco est rude, rustre, incohérent et désagréable. Celui de ce matin en tout cas : je dois laisser mon sac au vestiaire pour une raison que même les garçons du-dit vestiaire ignorent. Je laisse aussi dans les casiers mes impressions et ne me glisse pas ici dans les descriptions de la sombre et lumineuse San Marco… nous voici au balcon. En contrebas, les lots de touristes, les flaques qui s’étendent, les femmes en fourrure et le café Florian où l’on se rend évidemment. Oserait-on manquer une telle institution ?
 Ensuite, de ci de là, on retiendra surtout l’horreur de clowns en verre de Murano avant de visiter la Fondazione Querini Stampalia. Promenade dans des intérieurs vénitiens des 18e et 19e siècles pour laquelle je paye presque inutilement une somme légère pour pouvoir prendre quelques photos.
Ensuite, de ci de là, on retiendra surtout l’horreur de clowns en verre de Murano avant de visiter la Fondazione Querini Stampalia. Promenade dans des intérieurs vénitiens des 18e et 19e siècles pour laquelle je paye presque inutilement une somme légère pour pouvoir prendre quelques photos.
 Presque évidemment le petit bonheur du matin vient d’un détail gustatif dans cette petite pâtisserie à la façade attirante repérée la veille. On y entre au moins pour un café, on y craque pour un petit gâteau au sabayon servi par une vieille dame très apprêtée.
Presque évidemment le petit bonheur du matin vient d’un détail gustatif dans cette petite pâtisserie à la façade attirante repérée la veille. On y entre au moins pour un café, on y craque pour un petit gâteau au sabayon servi par une vieille dame très apprêtée.
À deux pas, ce petit restaurant à la carte attirante, repéré lui aussi la veille. Le lieu accueille de nombreux ouvriers, et avec un primo (du risotto) et un secondo (de la friture), au bout du conto on est totalo pieno avant de partir pour le Lido.
La première impression en débarquant au Lido, c’est la surprise. On avait oublié l’existence des voitures et des bus. Les voici qui toussent, ronronnent, vrombissent, klaxonnent…
Ah le Lido, on s’imagine que le fantôme de Gustav von Aschenbach erre sur la plage. Et ce n’est pas loin de la vérité. La plage offre un visage assez triste, que je dirais “très italien” si je prenais le risque de la caricature de ces plages privées. Sur d’improbables longueurs, les villages de cabines s’étalent, mais n’imaginez pas le charme désuet des cabines de Deauville. Vous voulez voir la mer de près ? marcher dans le sable ? Il faut faire un détour ou bien oser traverser ces constructions sans nom. Le fantôme est sûrement là, sortant du Grand Hôtel des Bains qui n’offre plus qu’une carcasse malade en restauration. Qui sont-ils, ceux-là qui comme nous s’aventurent sur le sable et les coquillages ? Là-bas les cris dans un téléphone : un pauvre type qui s’occupe, faute de touristes à qui vendre une écharpe multicolore ou je ne sais quelle babiole inutile…
Un café au milieu du Lido d’aujourd’hui, quelques petits gâteaux, nous repartons. Le soleil frappe les manèges des Giardini.
On cherche alors de quoi rapporter un souvenir qui se boirait, se mangerait. La petite épicerie nous accueille. La meilleure tomate séchée du monde dit-il. On rit. Idem pour le jambon. Les souvenirs s’entassent dans les sacs : vin, parmesan, tomates, jambon et même le pain.
La nuit est tombée, les valises ont roulé, un dernier bateau nous emmène à l’aéroport. Les gondoliers ne sont plus que des ombres que l’on s’étonne de trouver encore sur l’eau. Là quelques loupiotes sur une façade mais combien sur le casino ? Les lueurs viennent aussi de quelques réverbères, d’un arrêt de vaporetto, d’un néon sous un passage, puis d’enseignes et de vitrines – on en serait presque éblouis si on ne fermait pas les paupières en repensant à ces quatre jours.
Mardi 8 janvier – Mercredi 9 janvier – Jeudi 10 janvier – Vendredi 11 janvier
Jeudi 10 janvier 2013 – Venise
La journée commence par la visite de l’Accademia. Comme à la Ca’doro, la gardienne est bavarde, mais ne nous arrêtons pas à ce détail sonore et ne blâmons pas la dame de s’occuper comme elle peut en surveillant d’un oeil les touristes parsemés. Dans les salles – dont certaines sont fermées pour travaux – on s’arrêtera ici ou là, ici un peu plus, là longtemps, pour griffonner (parfois un peu vite donc un peu mal) sur le carnet quelques noms, quelques mots, précédés du numéro de la salle, dans l’espoir dans faire peut-être autre chose qu’une liste, c’est à dire un texte travaillé offrant au lecteur une plongée incomparable dans ce lieu (fissuré) :
I – Lorenzo Veneziano – Plafond
II – Carpaccio – Bellini… début 16e
III – Granito – Plafond bleuté / grotesques – Hans Memling –> portrait – Madonna col Bambino tra Santa Caterina e Maria Maddalena – Combien de décollations de Baptiste ?
– Et les gardiennes… blablabla
X – Odeur de peinture (vernis ?) –> Grande fresque en restauration – Tintoret –> Il sogno di San Marco (presque des aplats de couleurs)
Salle 20 – Processione Piazza S.M Gentile Bellini – Miracolo della reliquia
Salle 21 – Une pintade observée par un singe (habillé) –> Ritorno degli ambasciatori de Vittore Carpaccio
Toilettes clinquantes au sous-sol
Salle 24 : salla dell’albergo – Plafond, granito, marbre, boiserie.
 Le vaporetto nous dépose ensuite au Danieli. Là encore, ça sent le vernis : derrière un paravent, des ouvriers, des artisans peut-être plutôt, restaurent les piliers de marbre. La musique est jazz, l’attente très longue, étonnamment.
Le vaporetto nous dépose ensuite au Danieli. Là encore, ça sent le vernis : derrière un paravent, des ouvriers, des artisans peut-être plutôt, restaurent les piliers de marbre. La musique est jazz, l’attente très longue, étonnamment.
Par les petites rues nous rejoignons le nord, le Fondamenta Nuove.
On comble l’attente en regardant les gens sur cette charmante petite place à côté : un homme étrange sur un banc qui fait peur à une jeune touriste, une autre avec trois chiens, trois ragazzi en vêtements d’ouvriers et au regard si bleu…
Sur le bateau qui mène à Murano, une scène que je devrais décrire longuement, un grand-père à béret et son petit-fils (des baisers sur la bouche, l’étonnement du type en face, de la musique, un très fort accent…). La lagune est d’un calme fascinant. D’huile. Quelques îles, quelques bâtisses la ponctuent.
 À Murano ils sont un certain nombre à descendre. On poursuit. Voilà Burano, escale obligée avant Torcello. Burano, escale multicolore qu’on imagine envahie par les touristes à une autre saison. Le premier restaurant devant lequel on passe est notre choix, mais pas un bon choix : “Ils sont gentils mais rien n’est bon ici” sera ta conclusion.
À Murano ils sont un certain nombre à descendre. On poursuit. Voilà Burano, escale obligée avant Torcello. Burano, escale multicolore qu’on imagine envahie par les touristes à une autre saison. Le premier restaurant devant lequel on passe est notre choix, mais pas un bon choix : “Ils sont gentils mais rien n’est bon ici” sera ta conclusion.
Torcello enfin, qu’on apercevait depuis Burano. Étrange impression… Malgré le chemin tout tracé, chemin unique qui ne laisse aucune liberté d’errance, il règne un sentiment d’abandon. Ce recoin de lagune, sous l’horizon d’hiver qui n’offre que des arbres nus, nous semble bien triste ; les chalets trop colorés où se vendent des souvenirs et de la restauration très légère ont un côté anachronique ; ceux qui sont emballés ont plus un air de saison.
On décide de visiter la basilique (fin du 11e siècle, n’est-ce-pas…), histoire de dire qu’on ne sera pas venu pour rien. On ne sera pas venu pour rien : c’est un endroit assez magique (d’autant plus magique que je n’ai pas encore visité San Marco qui révèlera des similitudes). Photos interdites : sur le carnet j’esquisse, je trace quelques croisillons légendés, je sais qu’il m’aideront à me rappeler cette incroyable multitude de couleurs et de motifs. Je sais aussi maintenant que les souvenirs s’effacent déjà (un mois déjà que nous sommes revenus), que sur les mots “paons, lions, oiseaux, lapins” je n’appose aucune image nette.
Torcello reprend un visage un peu moins triste dès que le soleil apparait… L’envie d’un café nous entraîne dans un bar où l’on ne laisse tenter par le tiramisù : un peu moins triste ainsi aussi.
Que dire du retour que les images ne montrent pas ?
 Nous voici le soir, nous voici au restaurant, chez Vinovino (baccalà mantecato et prosecco en apéritif, fegato ou polpettine ensuite, panna cotta splendide pour terminer). Voyager dans l’assiette…
Nous voici le soir, nous voici au restaurant, chez Vinovino (baccalà mantecato et prosecco en apéritif, fegato ou polpettine ensuite, panna cotta splendide pour terminer). Voyager dans l’assiette…
Mardi 8 janvier – Mercredi 9 janvier – Jeudi 10 janvier – Vendredi 11 janvier
Mercredi 9 janvier 2013 – Venise
 Cette deuxième journée commence par un changement de programme, puisque l’Accademia est fermée ce matin pour cause de réunion syndicale.
Cette deuxième journée commence par un changement de programme, puisque l’Accademia est fermée ce matin pour cause de réunion syndicale.
On choisit donc d’aller à la Ca’doro, après un passage à la Salute, et en particulier le plafond de sa sacristie qui offre aux regards trois toiles de Titien contre un torticolis.
Un coup de vaporetto, le Rialto, les yeux rivés sur les couleurs des palais, les lignes de leurs ouvertures et la Ca’doro… s’avère fermée cette même matinée pour les mêmes raisons. On n’en admire que la façade qui donne sur le grand canal et on prend le chemin du quartier juif, d’une délicieuse tranquillité.
Deux églises (Ste Alvise, Madonna dell’Orto), un café… et le bateau nous emmène… au cimetière.
Dans le cloître je m’incline devant la règle de ne pas faire de photographies… par respect disent-ils. Mais j’applique un peu ensuite ma définition du mot. Les fleurs de plastique accrochées à ces murs de stèles, décolorées par les années, pourraient apparaître sur ma série photographique (vaguement entamée) des Oubliés… Quoi d’autres ? Quelques caveaux monumentaux, certains tristement effondrés, des “quartiers” recouverts d’herbe, la tombe de Stravinski… que dire…
De retour à Venise, nous descendons à Sant’Elena. Un petit resto qui doit probablement accueillir plutôt les travailleurs et les habitants du quartier, un plat de pasta al salmone comme à la maison, avec une mamie en cuisine… et nous pouvons reprendre le vaporetto pour aller au Ca’doro.
Un Saint Sébastien de Mantegna, des bronzes du 15ème, des toiles de Carpaccio et tant d’autres beautés avant d’aller du côté de la Fenice pour un concert gratuit des Tableaux d’une exposition de Moussorgski.
Un escalier, un couloir, je te suis, une voix, un peu de confusion probablement, on nous fait entrer sans rien nous demander, et nous voici dans la loge qui fait face à la scène de l’opéra. Quelques personnes sont là, ils ont probablement payé pour une visite guidée, eux… Sur scène une répétition, un Verdi avec décor qu’on qualifiera de moderne, tranchant avec les éclaboussantes dorures de la salle. Quelques minutes à observer ce moment dans ce lieu magique et clinquant et nous retrouvons l’autre salle, celle pour le concert. un autre style, des dorures tout de même. Au fond, sur cette banquette blanche, on écoute la petite conférence qui précède la musique (“Il cognac fue la sua unica consolazione”). Cent-cinquante personnes devant moi pour enfin écouter Moussorgski ; j’aperçois de temps en temps les épaules rouges de la pianiste qui bissera avec Chopin.
 Sur le chemin du retour, on profite encore du calme, rompu avec entrain par deux amusantes petites filles. Elles crient qu’il faut se dépêcher, qu’il va pleuvoir, un rire m’échappe. Leurs petites silhouettes (manteau, bonnet) glissent devant une façade encore jaune dans la pénombre.
Sur le chemin du retour, on profite encore du calme, rompu avec entrain par deux amusantes petites filles. Elles crient qu’il faut se dépêcher, qu’il va pleuvoir, un rire m’échappe. Leurs petites silhouettes (manteau, bonnet) glissent devant une façade encore jaune dans la pénombre.
Une pause à l’hôtel, accompagnés par une bouteille de prosecco. Il est 19h30, des cloches à proximité, les chips du mini-bar à deux euros…
 Où dîner ? Tu me dis qu’en été, San Polo est noire de monde. Mais ce soir, qu’y voit-on ? Un chalet encore habité par deux vendeurs de sucreries, une patinoire vide sur laquelle sont braqués des projecteurs et, heureusement, une pizzeria. Repus, on repart sans trop faire confiance au hasard.
Où dîner ? Tu me dis qu’en été, San Polo est noire de monde. Mais ce soir, qu’y voit-on ? Un chalet encore habité par deux vendeurs de sucreries, une patinoire vide sur laquelle sont braqués des projecteurs et, heureusement, une pizzeria. Repus, on repart sans trop faire confiance au hasard.
Mardi 8 janvier – Mercredi 9 janvier – Jeudi 10 janvier – Vendredi 11 janvier
Mardi 8 janvier 2013 – Venise
Venise. Nous voilà. J’ai aperçu tes toits et tes canaux depuis l’avion mais cette fois nous sommes sur la terre ferme, la lagune nous sépare. En arrivant sur le tarmac un coup d’œil à gauche, l’horizon est doré, tu as vu ? Quelle heure peut-il donc être pour que la lumière soit ainsi ? 13h à peine passées, vous êtes sûrs ?
Devant les distributeurs de tickets on s’interroge un peu et sur le tapis roulant la valise enfin arrive. Quelques minutes à pied jusqu’au bateau, on grimpe, ça démarre.
 Nous sommes seize, ça parle anglais, français, se prend en photo, regarde encore une fois le plan tandis qu’à travers les petites fenêtres défilent les piquets. À travers cette vitre que je n’ose pas baisser par peur de voir ma voisine grimacer sous l’air trop frais, la vue est légèrement trouble.
Nous sommes seize, ça parle anglais, français, se prend en photo, regarde encore une fois le plan tandis qu’à travers les petites fenêtres défilent les piquets. À travers cette vitre que je n’ose pas baisser par peur de voir ma voisine grimacer sous l’air trop frais, la vue est légèrement trouble.
Au loin, quelques silhouettes d’îles, et droit devant l’ombre de Venise qui s’approche lentement, se faisant désirer. Ici les murs sont ocres, là les panneaux annoncent des contrôles de vitesse et enfin nous y sommes, on tourne à droite, on entre sur un canal. Sur les visages des passagers qui se redressent les sourires se font plus francs, le barbu sort son caméscope et sa femme est ravie quand je baisse la vitre.
Une fois sur le grand canal, il n’y a plus rien à dire… juste regarder… devant… ou à côté…
Ca’Rezzonico, on descend. Je te regarde en souriant : “ça y est, on y est !”. La penzione est tout près… mais il faut tout de même se repérer dans le dédale des rues.
Une halte rapide, la joie d’avoir vue sur les canaux, et l’on repart dans ce petit resto repéré sur le chemin. Polenta et morue pour toi, assortiment de petites choses pour moi. Derrière le comptoir la femme a un visage de poupée, teint de porcelaine, lèvres rouge vif, tandis que le Russe sort un billet de 500 euros ; ils étaient si nombreux à table.
Et puis nous voilà au hasard des rues, hasard relatif, tu connais la ville et tu m’entraines vers la piazza San Marco, indispensable lors un premier regard sur la ville. Sur le chemin, l’église San Vidal, placettes, ruelles, ocres, jaunes, le gris de la façade du conservatoire teinté d’orange au soleil couchant, et puis San Marco, merveilleuse à cette heure, cette heure bleue. Les vendeurs à la sauvette lancent de petits objets qui laissent dans le ciel photographique des lueurs étranges.
 Une pause pour un chocolat – joliment accompagné de petits gâteaux délicats. J’ignore durant quelques minutes où on est réellement – à savoir le Danieli, le plus beau palace de la ville – mais ce granito, ces velours, les lustres, ces vitraux, ces dorures au plafond… quelque chose me disait qu’on n’était pas n’importe où. En face de nous c’est d’abord un homme blond, rougeaud, probablement saoul, qui boit un thé après avoir bu du vin. Puis un couple, dont la femme veut des glaces au lieu de ce gâteau au chocolat. Elle prend un air triste à l’écoute des parfums proposés, elle hésite sur la pistache mais il n’y a pas de sorbets. Elle renonce. Le mari s’amuse des caprices, hier il lui a acheté cette robe rouge, assortie à son manteau, qu’elle porte avec simplicité. Dans cette banquette confortable je m’imagine lire Proust durant des heures. Je n’attendrai pas d’avoir 40 ans pour cela ; 2013 sera l’année idéale puisque l’année du centenaire de l’œuvre.
Une pause pour un chocolat – joliment accompagné de petits gâteaux délicats. J’ignore durant quelques minutes où on est réellement – à savoir le Danieli, le plus beau palace de la ville – mais ce granito, ces velours, les lustres, ces vitraux, ces dorures au plafond… quelque chose me disait qu’on n’était pas n’importe où. En face de nous c’est d’abord un homme blond, rougeaud, probablement saoul, qui boit un thé après avoir bu du vin. Puis un couple, dont la femme veut des glaces au lieu de ce gâteau au chocolat. Elle prend un air triste à l’écoute des parfums proposés, elle hésite sur la pistache mais il n’y a pas de sorbets. Elle renonce. Le mari s’amuse des caprices, hier il lui a acheté cette robe rouge, assortie à son manteau, qu’elle porte avec simplicité. Dans cette banquette confortable je m’imagine lire Proust durant des heures. Je n’attendrai pas d’avoir 40 ans pour cela ; 2013 sera l’année idéale puisque l’année du centenaire de l’œuvre.
Nous sortons, “salve!” La nuit est tombée. Les ruelles sont calmes. G m’a dit que c’est à cette période que Venise est elle-même, cela semble indéniable – malgré le Florian fermé, puis-je ajouter en souriant. Quartier de l’arsenal, qui sont-ils donc ceux qui errent à cette heure peu avancée, franchissent les ponts, hésitent sur quelques pavés humides. Ailleurs on s’inquiéterait d’un éclairage aussi faible, provenant d’un ou deux réverbères, de quelques échoppes encore ouvertes ou fenêtres d’hôtels. Ici la nuit nous enveloppe, et l’on peine à trouver la silhouette d’un arbre dans ce dédale minéral.
Nous prenons le vaporetto… voici les quais. L’air frais me fouette le visage, je respire, m’assied, profite. Un bateau passe, torche éclatante et carrée se reflétant dans l’eau.
Sur les Zattere, on ignore d’où nous vient si tôt cet appétit, mais l’on choisit ce petit restaurant dont on parlerait du sabayon pendant des heures. En face de nous la jeune femme, déjà d’humeur joyeuse et amoureuse, s’amuse de nos exclamations retenues, interroge le garçon, veut le même dessert. Le vin était rond, l’hôtel est tout près, rentrons.
Mardi 8 janvier – Mercredi 9 janvier – Jeudi 10 janvier – Vendredi 11 janvier
Décembre 2012
Lundi 31 décembre
Arriver de nuit à la ville que l’on rêve depuis de longues années, est un accident de voyage très simple, mais qui parait combiné pour pousser la curiosité au denier degré d’exaspération. Entrer dans la demeure de sa chimère les yeux bandés est tout ce qu’il y a de plus irritant au monde. Nous l’avions déjà éprouvé pour Grenade, où la diligence nous jeta à deux heures du matin, par des ténèbres d’un opacité désespérante.
Voyage en Italie (Venise) ; Théophile Gautier

 Et puis Gene Kelly sourit ; celle qu’il aime remonte les escaliers. The End. En haut de nos marches, sortie du cinéma, on sourit moins : il pleut. Pas grand chose, juste de quoi rendre moins agréable ce qui était prévu. C’est donc à la maison qu’on débouche les bulles, tout aussi heureux. Tiens, et si on y mettait aussi un peu de ça ?
Et puis Gene Kelly sourit ; celle qu’il aime remonte les escaliers. The End. En haut de nos marches, sortie du cinéma, on sourit moins : il pleut. Pas grand chose, juste de quoi rendre moins agréable ce qui était prévu. C’est donc à la maison qu’on débouche les bulles, tout aussi heureux. Tiens, et si on y mettait aussi un peu de ça ?
Dimanche 30 décembre
Découvrir que cet air tant entendu s’appelle Take Five. Se souvenir des dimanches matins. Marcher. Pour nous c’est une longue et agréable promenade rive gauche, le nez en l’air sur les façades inconnues, jusqu’à un chocolat à la Coupole. Pour Laurent Hasse ce sont des rencontres sur 1500 km et un film sur le bonheur. Et pour vous, c’est quoi le bonheur ? Un Lifshitz le soir au fond du lit par exemple ?
Samedi 29 décembre
 Italie pourquoi pas. Mais non. Le long couloir qui mène aux quatre lettres du magasin a quelque chose de… de quoi… de rien, c’est comme ça, je n’aime pas cet endroit. St Germain, sentiment un peu curieux de penser que je vais y trouver un vendeur plus compétent, je veux dire plus à même de répondre à la seule question qui me taraude, genre « mais pour la photo c’est pareil ? ». Il n’a pas vraiment la réponse, il me sort quelques mots et chiffres suffisants pour mon choix et je repars avec l’objet sous le bras… 23 pouces sous le bras, quelque chose entre la pieuvre, le freak et le geek. Je repars et me pose dans ce petit jardin le long du boulevard. Vingt-neuf minutes et vingt-sept secondes de JB plus tard, j’y lis un peu ce qu’on veut bien m’y raconter, l’hommage à la Vierge, tout ça tout ça… Le jardin a l’aspect que vous imaginez, c’est l’hiver, mais même la rose de Noël n’est présente que par un cartel un peu éteint.
Italie pourquoi pas. Mais non. Le long couloir qui mène aux quatre lettres du magasin a quelque chose de… de quoi… de rien, c’est comme ça, je n’aime pas cet endroit. St Germain, sentiment un peu curieux de penser que je vais y trouver un vendeur plus compétent, je veux dire plus à même de répondre à la seule question qui me taraude, genre « mais pour la photo c’est pareil ? ». Il n’a pas vraiment la réponse, il me sort quelques mots et chiffres suffisants pour mon choix et je repars avec l’objet sous le bras… 23 pouces sous le bras, quelque chose entre la pieuvre, le freak et le geek. Je repars et me pose dans ce petit jardin le long du boulevard. Vingt-neuf minutes et vingt-sept secondes de JB plus tard, j’y lis un peu ce qu’on veut bien m’y raconter, l’hommage à la Vierge, tout ça tout ça… Le jardin a l’aspect que vous imaginez, c’est l’hiver, mais même la rose de Noël n’est présente que par un cartel un peu éteint.
Le soir, parmi les multiples raisons de se réjouir, des photographies de Wim Wenders. Berlin, Palerme, Onomichi… coïncidence d’y lire des noms qu’on aimerait voir, qu’on a évoqués, qu’on attend. Quoi qu’il en soit je suis touché par ce cadeau si juste.
Jeudi 27 décembre
« Faut faire attention à la date de périmation« , dit-il. La dame tique en s’asseyant près de lui, mais c’est peut-être parce qu’elle souffre du dos. Place Monge, c’est soirée Maroc – Japon. Mince, on a oublié de piquer un vase…
Mercredi 26 décembre
 Dans le RER ça sent le VVF, souvenir de Seignosse que je n’explique pas vraiment, cette odeur particulière déjà rencontrée ailleurs, peut-être quelque chose entre le pin et le sable, sûrement quelque chose provenant d’un produit d’entretien. Je plonge la main dans mon sac, reprends une habitude abandonnée depuis quelques semaines : les leçons de japonais. Je ne rêve pas de le parler, j’aime cette espèce de défi, cette idée d’apprendre, ce jeu de puzzle qu’est cette langue. J’aime moins cette difficulté à retenir, ce mur que ma mémoire rencontre malgré le nombre de fois considérable où j’ai lu cette liste d’adjectifs, ce tableau de verbes.
Dans le RER ça sent le VVF, souvenir de Seignosse que je n’explique pas vraiment, cette odeur particulière déjà rencontrée ailleurs, peut-être quelque chose entre le pin et le sable, sûrement quelque chose provenant d’un produit d’entretien. Je plonge la main dans mon sac, reprends une habitude abandonnée depuis quelques semaines : les leçons de japonais. Je ne rêve pas de le parler, j’aime cette espèce de défi, cette idée d’apprendre, ce jeu de puzzle qu’est cette langue. J’aime moins cette difficulté à retenir, ce mur que ma mémoire rencontre malgré le nombre de fois considérable où j’ai lu cette liste d’adjectifs, ce tableau de verbes.
Le film du soir, toujours du coffret Lifshitz, c’est La Traversée, belle aventure sur laquelle je ne trouve pas les mots (est-ce cette odeur de bûche ou cette musique jazzy qui me détourne ou me dérange ?).
Mardi 25 décembre
Je fais glisser, au feutre japonais, le prénoms sur les cartons, puis j’ajoute deux ou trois étoiles rouges. Un, puis deux, huit prénoms pour un plan de table, table aux couleurs du moment, vert houx, rouge baie, mais la couleur vive provient aussi de ces petites pommes qui étonnent tout le monde. Les échanges de cadeaux feront éclater quelques rires, le menu quelques exclamations. L’après-midi s’allonge, se termine assis dans des fauteuils assortis ; a-t-on déjà vu des fauteuils verts au cinéma ? Le Donzelli convient parfaitement pour une séance familiale en ce jour de Noël, mais tout le monde n’est pas d’accord. Plus tard, plus seuls, on extrait du coffret Lifshitz que tu m’as offert hier ce Wild Wide moins farfelu, moins sage, et sans conteste plus beau, plus simple… plus parfait en ce jour de Noël ?
Lundi 24 décembre
 Quelle heure est-il ? Nous sommes seuls et je danse un mambo aux pas approximatifs. Yma Sumac vocalise, auparavant il y avait eu ce Divine Comedy de 1996 et ce Rufus Wainwright si peu écouté. Je porte peut-être ce cadeau clair et doux que tu m’as offert au moment du premier verre, peut-être, parce qu’il fait si chaud.
Quelle heure est-il ? Nous sommes seuls et je danse un mambo aux pas approximatifs. Yma Sumac vocalise, auparavant il y avait eu ce Divine Comedy de 1996 et ce Rufus Wainwright si peu écouté. Je porte peut-être ce cadeau clair et doux que tu m’as offert au moment du premier verre, peut-être, parce qu’il fait si chaud.
Dimanche 23 décembre
Le soleil enfin, presque top tard puisque hier… mais qu’importe.
 Après-midi. Le train nous embarque, à travers la vitre je réalise que le fleuve, vu hier pourtant, a largement dépassé ses limites convenues. Les arbres nus y sont plongés, s’y reflètent, passent. Dommage, il est trop tard pour la moindre image triste ou belle, celles des arbres hier sous la bruine si nous étions allés plus loin, image un peu facile mais probablement efficace.
Après-midi. Le train nous embarque, à travers la vitre je réalise que le fleuve, vu hier pourtant, a largement dépassé ses limites convenues. Les arbres nus y sont plongés, s’y reflètent, passent. Dommage, il est trop tard pour la moindre image triste ou belle, celles des arbres hier sous la bruine si nous étions allés plus loin, image un peu facile mais probablement efficace.
Samedi 22 décembre
Les rues de Saintes sous une pluie très légère, une bruine qui va et vient, ce parapluie à quoi bon… Je connais la ville par cœur (presque par cœur tu vois, puisque j’hésiterai sur le chemin qui mène à la pâtisserie), c’est le petit jeu des comparaisons – avant c’était comme-ci, avant c’était déjà comme ça – et sur les trottoirs humides on en fait encore plus vite le tour. Dans certaines boutiques, sous-sols ou étages, les visages sont toujours les mêmes depuis mes plus lointains souvenirs. On s’exclame éventuellement en confirmant que oui, je suis bien le fils de, que ça se voit (avec un geste de la main tournant autour du visage). Un café du Costa-Rica là où, il n’y a pas si longtemps, un antiquaire m’offrait d’autres rêves. Dans Le Monde posé sur la table je lis que « chez les Romains ou en Allemagne, à une époque, avec le culte des Jeux olympiques, on encourageait le sport au détriment de l’éducation pour contrôler le peuple et le détourner d’une connaissance profonde des choses« . Je souris. Tu es plongé dans les premières pages du Yoshimura trouvé à cet étage où ce visage est toujours le même depuis…
Jeudi 20 décembre
Bosser. Marcher. Chercher. Regarder. Toujours un peu les mêmes alentours, mais je ne m’y aventure pas trop : le temps est incertain. Parler de la météo justement. T’attendre. À la lumière du plafonnier, tandis que j’imagine plus nettement la fin, je lis encore L’Incognito, ce Guibert qui ne m’enthousiasme guère : j’y vois trop de misanthropie, une pointe de condescendance, quelque chose comme le temps, incertain…
Mercredi 19 décembre
Être curieusement éveillé si tôt alors que nul ne m’attend, si ce n’est un peu plus tard quelques vendeurs nippo-noëlisés, un épicier italien, Gloria Lasso, adios tristeza (hasta domingo Paris), deux contrôleurs, deux parents. Plonger, dans le train, dans ces Images malgré tout de Georges Didi-Huberman. Sans rien en dire de plus ici. Juste imaginer, imaginer l’inimaginable.
Mardi 18 décembre
Le PDF met un peu de temps à s’ouvrir. Et puis il faut cliquer pour faire apparaître le bas du document. Des secondes qui semblent interminables… Il est 12h32. Un cri de joie intérieur, MS est au téléphone, je fonce au bureau de MF : « Je suis accepté ! ». Elle me répond par un grand sourire, ravie pour moi. Voilà. C’est le grand saut vers… vers quoi ? vers un printemps de 4 mois, 4 mois de travail autrement : apprendre, s’ouvrir, analyser, réfléchir, comprendre, retenir, argumenter… et devenir.
Devenir, c’est aussi un des verbes en filigrane du film « Pièce Montée« . Se marier, vaste question en ce moment : pourquoi se marier ? Comme ça… Pourquoi pas… Parce que. En même temps qu’un regard (amusé ? moqueur ou tendre ?) au salon du mariage, voici trois bouts de lecture et surtout un très court moment où la famille commente une phrase d’Annie Ernaux. Je regrette que le film n’aille pas plus creuser de ce côté-là, une sorte d’analyse de texte, un parallèle, des croisements. Alors c’est en famille qu’on nous raconte des petites histoires, ces grands moments de rien du tout. Finalement le film aurait pu s’appeler « Les gens normaux n’ont rien d’exceptionnel » mais c’était déjà pris…
 NB. Avoir aussi couru pour une deux photos, revoir la superbe exposition de Corinne Mercadier et évoquer Venise en janvier.
NB. Avoir aussi couru pour une deux photos, revoir la superbe exposition de Corinne Mercadier et évoquer Venise en janvier.
Lundi 17 décembre
C’est dans le tramway cette fois qu’une femme tricote. Loisir de saison ? Soudain la voix d’Édith Scob qui annonce la première station de ce premier trajet : « Alexandra David-Néel« . C’est presque un choc, c’est en tout cas une surprise. Est-ce vraiment la sienne ? Un jingle étrange et presque désagréable, une autre voix, puis à chaque station deux voix autour d’une petite musique… Non, ne me dites pas que c’est Jeanne Moreau qui annonce la Porte Dorée !? Bref, voilà un des sujets du soir autour du lapin, et à propos de lapin j’ai gagné douze minutes grâce au T3a…
Dimanche 16 décembre
Le même aller-retour qu’hier. Je regarde un peu plus par la fenêtre du train. Un squelette industriel disparait trop vite du champ, mais j’ai le temps de voir la silhouette étêtée de ce qui pourrait être le fantôme d’une photographie des Becher. Vous imaginez bien que je rêve de descendre du train pour une image. Ensuite ce sont d’autres résidus de l’industrie d’autrefois qui apparaissent ; et la chicorée, tu en bois toi ?
Cette deuxième journée nous entraîne d’abord vers Roubaix et sa Piscine, avec un grand P. Galerie de portraits, statues réalistes, scènes de vie locales, au-delà de la beauté de lieu, on tombe sous le charme de ses œuvres. Quelques noms connus ne valent presque rien au milieu de ces noms qui ont tant produit, tant montré, tant vécu.
À peine plus loin, nous passons à Tourcoing. Au Fresnoy, Georges Didi-Hubermann nous parle de fantômes, mais pas de ceux auxquels vous pensez. Ils ne sont ni transparents ni recouverts d’un draps. Ils sont les images qui ont envahi un univers, très peu le mien, un peu le tien, surtout le sien. Il faut rester un peu, insister, regarder, pour s’imprégner de ces images fixes ou en mouvement que je n’avais pas forcément reliées d’un sens commun, d’une représentation commune – la lamentation -, pas consciemment en tout cas. Au milieu de tout cela, l’assurance qu’il faudra voir un jour ce cuirassé Potemkine ou ces Pasolini… Pasolini qui, le temps de quelques phrases sur la beauté et la richesse, m’emporte. Puis le visage de Marylin. C’est La Rabbia. Comment ai-je pu manquer tout cela ?
Et puis, sans s’y attendre, les retrouver.
Samedi 15 décembre
Elle s’assied brusquement, comme si enfin elle s’asseyait – j’appuie sur l’adverbe « enfin » -, épuisée par cette journée à Lille. L’indice ce sont ces trois grands sacs, pleins de cadeaux, encombrants ; tu lui proposes de les monter. De son sac à motifs léopard elle sort un livre de Catherine Pancol, un livre de poche. Le rouge de ses ongles est orangé, et toi assez vite tu t’endors. On revient nous aussi de Lille, Lille animée, illuminée, lumineuse, chaleureuse.
Nous avions commencé dès le matin par le musée des Beaux-Arts de Valenciennes, grand-écart stylistique et temporel entre Jérôme Bosch et Marie-Thérèse Vacossin (un des noms de l’expo temporaire sur l’art construit, un courant de l’abstraction géométrique… Je crois qu’il y a dans l’abstraction géométrique quelque chose de radical qui me plait beaucoup mais on en débattra plus tard).
À Lille, ensuite, encore les Beaux Arts, cette femme qui tricote devant un triptyque, allitération et jolie scène, la laine assortie aux murs, et à côté il y a Rubens, plus tard Rodin, Redon, au milieu d’autres noms, parfois inconnus, j’oublie de noter qui a peint cette toile ou cette autre, j’accroche dans mes clichés quelques visages crispés ou doux, une posture, le contraste d’un corps à la pâle complétion dans une ambiance noir corbeau. Et puis les fables du paysage flamand et se rêver seul devant la tour de Babel. Un peu d’air, quelques boutiques, chez Meerts évidemment, je dis évidemment comme si je connaissais, je te suis, tu me guides et on intègre par un heureux hasard le rassemblement pour le mariage pour tous (OUI !). Je ne connais cette ville que par un court week-end d’il y a exactement 10 ans et 1 mois, je n’en ai gardé que le souvenir d’un bar et du Rocky horror picture show sur un petit écran de téléviseur, je n’en ai gardé que quelques phrases d’un autre genre qu’aujourd’hui. Au Tri Postal c’est un autre type d’horrors : par endroits ça dégouline, reste à savoir s’il y a un quelconque deuxième, troisième ou xième degré. Reste à faire le tri, donc, et même devant les films d’Apichatpong je suis un peu ailleurs, la tête pleine de tout.
Vendredi 14 décembre
Finalement, tout le monde s’accordait à dire que c’était trop long derrière, mais que sinon c’est pas mal, voire bien. Je me dis tout de même que cette version « plaqué tant bien que mal en arrière » n’est peut-être pas la meilleure solution. Le jury capillaire, venu de Montréal, d’Agen et d’une cantine scolaire du 5ème arrondissement (avec brandade au menu du jour), s’était réuni rue Keller, au 36, dans LA boutique de LA rue que même Télérama adorera quelques jours plus tard. Mais J avait à peine eu le temps de rougir qu’il me fallait partir, Valenciennes m’attendait.
Jeudi 13 décembre
De notre Académie espagnole, je ne connaissais personne, j’étais arrivé le premier, j’avais fait deux scènes au secrétaire général, et j’étais reparti le soir même sur mon île, je pris froid sur le bateau, une sale guigne d’automne.
L’Incognito ; Hervé Guibert
Ce livre acheté il y a quelques mois, je crois que je l’ai même emporté au Japon, traîne enfin dans mon sac. Je ne suis pas sûr que tout cela m’intéresse, mais j’aime l’idée de lire un journal de plus, de décortiquer un peu la manière que l’on a de raconter sa vie, des mois, un épisode, un moment.
À Beaubourg ça n’a rien à voir, ce sont des idées, une affiche années 30 qui se profile. Et puis je presse un peu le pas, car me revient à l’esprit cette séance de 22 h au Reflet Medicis, ce train qui sifflera trois fois.
Mercredi 12 décembre
C’est le plaisir de cette saison, dès que le RER a quitté Vincennes, ce léger givre dehors, blancheur, jolie lumière. Et puis elle pose son livre, Thérèse Desqueyroux ; elle éternue.
C’est le plaisir de cette soirée, les amis sur scène, et ce léger froid dehors dès que j’ai quitté la salle. Bastille, lumières colorées, attractions vides, les forains patientent.
Sur le quai de Sully-Morland, la scène est triste, puisque la saison froide n’est pas celle du plaisir pour tout le monde. Deux hommes parlent, l’un d’eux a une allure qui frappe, trop peu de vêtements, une tignasse et une barbe blanche à la Gandalf.
– Et vous avez quel âge ?
– 60 ans, répond l’homme à l’air perdu.
La moue dubitative sur le visage de l’homme qui questionne.
– 60 ans ?
– Oui, je suis né en 1925.
Il tremble, l’autre s’inquiète, on échange des regards. Dans le métro l’échange se poursuit :
– Vous savez où vous allez ?
– Ah oui, je vais retrouver… Je connais Paris, je suis allé à l’école rue Madame.
Il a le regard triste qu’ont parfois les hommes très vieux.
Mardi 11 décembre
Sur l’écran mouais, c’est pas mal, mais ça se cherche, ça traînasse, ça chichite un peu du côté du cadre avec des plans pris du plafond, la tête à l’envers, et puis des plans orteils, des plans-plans cucul, des plans galères… C’est le film Hors les murs, un film de plus pour distiller petit à petit, une certaine idée du mot normalité, quoi qu’on raconte.
Lundi 10 décembre
Le jeune couple d’amoureux ne se parle même pas. Elle a posé sa main sur sa cuisse mais il l’ignore, il regarde ailleurs, il me regarde, je les regarde. Elle est triste, elle ne dit rien non plus. La musique approximative qui sort de cet accordéon ne change rien, sinon ma concentration pour lire. Il y a quelque chose qui décline en eux, en lui, ce jeune homme, c’est un peu à l’image de la Culture, puisque on en parle aujourd’hui, mais lui, c’est bien plus de 4% de son énergie amoureuse qu’il semble avoir perdu.
Dimanche 9 décembre
Au début de l’été, Serge July m’a demandé si j’envisageais dans les choses possibles d’écrire pour Libération une chronique régulière.
(…)
J’ai hésité à passer à ce stade de la publication de ces textes en livre, c’était difficile de résister à l’attrait de leur perte, de ne pas les laisser là où ils étaient édités, sur du papier d’un jour, éparpillés dans des numéros de journaux voués à être jetés. Et puis j’ai décidé que non, que de les laisser dans cet état de textes introuvables aurait accusé davantage encore – mais alors avec une ostentation douteuse – le caractère même de L’été 80, à savoir, m’a-t-il semblé, celui d’un égarement dans le réel. Je me suis dis que ça suffisait comme ça avec mes films en loques, dispersés, dans contrat, perdus, que ce n’était pas la peine de faire carrière de négligence à ce point-là.
L’Été 80 – préface ; Marguerite Duras.
Et la tourte au lapin, hein ? elle était comment la tourte au lapin ?
Vendredi 7 décembre
L’homme monte, ligne 9 : « (…) qu’il y a un chien sur les voies… J’ai une information très parcellaire, ils ne précisent pas si c’est un labrador vivant ou un chihuahua m… oui voilà c’est ça ».
À l’arrière plan ces monts qu’on connait tant, surtout toi, mais je les ai tant fixés du regard. Devant, diagonale cinématographique, Kentaro tire un charriot. Devant moi le couple s’enlace ; ils ont froid. Plus tard, bien sûr les brumes s’élèvent. Bien sûr. Lentement. Lentement. Elles prennent leur temps comme tu prends le tien, comme tu montres le leur, comme tu nous l’offre à voir, je cherche le mot qui décrirait cela, j’ai l’impression que tu inventes un verbe, on aurait à l’idée quelque chose qui s’écoule simplement, un rythme contre lequel on ne lutterait pas, une évidence qui s’égrène.
Jeudi 6 décembre
Il y aurait ici par exemple un passage de Naufrages, en italique, qui proviendrait de la page 13, avant que j’abdique, avant que j’aie envie d’autre chose.
Puis j’évoquerais Pialat et ce Passe ton bac d’abord. La jeunesse de Lens, 1979. La jeunesse, la même qu’ailleurs, plus ou moins la même disons (l’accent en plus, la thune en moins, on ne dit pas thune à l’époque je crois, on dit quoi ?), les clopes, les bars, les couples d’amoureux (ou pas), la gouaille, l’insouciance, le foot, les franges, les boîtes. À l’époque j’ai cinq ans, et à part quelques tribunes de terrains de foot, à part peut-être une frange…
Mercredi 5 décembre
Il est midi passé. En vain, quelques pages de Naufrages, de Yoshimura. Je suis le dernier des 4 et j’attends, sur cette chaise, dans ce petit couloir. Je ne sais pas vraiment à quoi je dois penser, si je dois penser. Je réalise en écrivant ces lignes que d’autres auraient vu un signe dans le titre du livre, qu’ils l’auraient reposé. Je n’ai pas vraiment peur, pas vraiment faim, je ne suis ni inquiet ni vraiment sûr de moi, j’avais oublié combien je pouvais être fataliste.
Il est vingt heures passées. J’ai dû m’assoupir un peu ; cette nouvelle installation pour les conférences de Pascal Rousseau est vraisemblablement trop douillette, confortable. Et puis vous me connaissez, à cette heure-ci, il suffit que… Pour me tenir éveillé je note quelques mots sur le petit carnet : « Louis Favre » et « La peinture est mortelle car elle est corporelle« .
Mardi 4 décembre
Elle lit La Vie matérielle de Duras, édition P.O.L. Je relis ma vie professionnelle ; je ne pense pas que ça pourrait faire un roman.
Lundi 3 décembre
Pffff…
Dimanche 2 décembre
Je crois que je ne suis pas très concentré sur les paroles des autres. J’ai l’esprit ailleurs, sur celles que moi je devrai prononcer dans quelques jours, que je répète pendant que les autres parlent, de toute façon je fais quelques photos, comment voulez-vous que j’écoute ? Il faut être très attentif pour capter l’essence de ce qui se dit, beaucoup moins quand rien ne se dit. Le film silencieux d’Alain Fleischer tombe donc à pic. Le Règlement m’entraîne pendant quarante minutes dans un autre monde, celui d’un homme dont les actes sont, comment dire, farfelus, étonnants, inhabituels, amusants… et légaux. Ouf. C’est là, la morale de l’histoire, la liberté existe – et je ne parle pas de celle du film (de 1969, et l’on se demandera une fois de plus où est passé la liberté cinématographique d’antan).
Samedi 1er décembre
 Il n’y a plus de gilet ; je me contente d’un pull. Il n’y a pas le livre que je cherche ; je me satisfait pleinement d’un autre. Il n’y a que l’embarras du choix ; je me penche sur la Typographie. Il n’y a toujours pas de rendez-vous chez le coiffeur ; je me dis qu’après tout, ça peut continuer à pousser.
Il n’y a plus de gilet ; je me contente d’un pull. Il n’y a pas le livre que je cherche ; je me satisfait pleinement d’un autre. Il n’y a que l’embarras du choix ; je me penche sur la Typographie. Il n’y a toujours pas de rendez-vous chez le coiffeur ; je me dis qu’après tout, ça peut continuer à pousser.
Novembre 2012
Vendredi 30 novembre
L’image avance lentement. Cela m’amuse, je me dis que c’est typique du Festival, qu’il y a tout le temps des mouvements lents de caméra. C’est faux, mais c’est une idée, comme ça, peut-être parce que l’un des films qui m’a le plus marqué était ainsi. Ce n’était qu’un extrait d’ailleurs, c’était l’ouverture, c’était quand ? Il y a deux ans ou trois ? C’était quoi ? Où, ça je sais, à Châtelet. Bref, la contemplation se retrouve brusquée par un nuage de fumée rose, une fois, puis deux, trois, trop, c’est dommage, le début était splendide, ce pont par exemple, et puis les bâtiments vides ensuite, vides et abandonnés, comme il y a presque deux ans…
Jeudi 29 novembre
Voici qu’on leur donne la parole, qu’on les écoute, qu’on revient vers eux, ces vieux-là, trop vieux maintenant vous croyez ? mais trop vieux pour quoi ? Pour avoir oublié ce désir ? pour ne plus en avoir ? pour ne plus sourire du coin des lèvres ou avoir les yeux qui brillent, tandis qu’on regarde les images de leurs anciens amours, de leurs autrefois caressés et qu’on écoute ? De leur désir présent on ne dit presque rien, on devine encore quelques mains. Parfois, souvent même, dans leurs paroles c’est une émotion rare qui se dégage, qui va au-delà de ce qu’ils racontent, au-delà de cette homosexualité qui est leur particularité commune, on touche au plus profond de l’humain, ce peut être la rage, ce peut être la candeur ou l’évidence, l’évidence oui c’est cela, que c’est beau l’évidence, c’est simple, ça vous épargne les questionnements. Eux, elles, ils ont combattu quand on cachait les mots, les faits. Pas la peine de remonter si loin d’ailleurs, mais qu’importe. Les Invisibles ne voulaient pas forcément l’être, certains criaient, manifestaient, se battaient. Les Invisibles l’étaient parfois malgré eux, déni, lutte intérieure, terreur. Aujourd’hui ils le sont peut-être redevenus, parce qu’avec les rides et les cheveux c’est comme si on s’imaginait que… que non… que l’amour ce n’est pas pour eux. Quelle drôle d’idée, l’amour c’est encore là, regardez-les.
Mercredi 28 novembre
Et ce n’est qu’une semaine plus tard que je découvrirais qu’il était inutile de rester là, que j’aurais pu t’accompagner, voir ce film dont tu m’as dit du bien.
Mardi 27 novembre
Alors on pourrait dire qu’il y avait peu de monde dans la salle pour écouter parler d’addictions, que dans le bus ça sentait la pizza, que le livre « Penser le design web » n’était pas forcément si vieux que ça, qu’il fallait juste faire le tri, séparer le bon pixel de l’ivraie, et puis on parlerait du film « The Brown Bunny« , vu d’un oeil ou de deux, révisant tout en visant.
Lundi 26 novembre
Rien ?
Dimanche 25 novembre
 Dans le bois de Vincennes, derrière les petits chemins que l’on prend, où les coureurs habitués ignorent tout, les tentes sont plantées. Le mot bidonville intervient, on se demande si c’est mieux, si c’est pire, on se retrouve à comparer l’incomparable, l’insupportable, l’inadmissible, le faire avec qui nous entourent. Le mot solidarité s’effritent sous les feuilles mortes, et l’on rentre, sans rien faire, sinon avec.
Dans le bois de Vincennes, derrière les petits chemins que l’on prend, où les coureurs habitués ignorent tout, les tentes sont plantées. Le mot bidonville intervient, on se demande si c’est mieux, si c’est pire, on se retrouve à comparer l’incomparable, l’insupportable, l’inadmissible, le faire avec qui nous entourent. Le mot solidarité s’effritent sous les feuilles mortes, et l’on rentre, sans rien faire, sinon avec.
Samedi 24 novembre
Sur la voiture, des nœuds colorés, brillant sous le soleil qui subsiste en cette après-midi, un soleil qui plus tard sera d’un rouge vif et improbable, à peine visible sous un trait sans nuage. Sur la voiture, trois enfants amusés, contents de cette occasion d’être là, les vingt ans de L, cet espace sans nuages. Autrefois – certains disent que dix-neuf ans ont passé – ils ou elles étaient déjà là, célébrant déjà la plus belle définition du mot famille, celle qui n’a pas de modèle, ni vraiment de définition.
Vendredi 23 novembre
Ah…
… Ils m’attendent.
(Cri de joie intériorisé)
Jeudi 22 novembre
Ceux qui savaient nager se noyaient aussi. Ils retardaient seulement leur mort.
Tu dors probablement déjà. Je te regarde et pourtant tu n’es pas là. Je regarde ton regard, celui sur les marins qu’on évoquaient dimanche, les vagues, les naufrages, les femmes parfois en noir et les plans fixes sur leur visage, ces plans fixes auxquels on n’échappe pas dans ton œuvre. Ni dans ton œuvre ni dans notre vie. Tu les regardes avec amour, ces femmes, tu sembles y chercher la vérité, celle de leur douleur, quelque chose qu’elles ne diront peut-être jamais, quelque chose qu’elles ne savent peut-être pas mais que d’autres ont raconté lors du naufrage. La plus émouvante a le visage penché. Pleure-t-elle ?
Mardi 20 novembre
Les cartes de géographie Vidal-Lablache éveillaient le désir des voyages lointains, mais entretenaient surtout leur illusion, au sein même de nos paysages pauvres.
… Je revois L’Amour existe de Pialat, et la triste phrase ci-dessus est un étrange contrepoint à celle de François Mitterrand citée quelques jours plus tôt. Les dix-neuf minutes du film sont féroces, belles, belles comme un combat qu’on saurait vain, comme une colère. Pialat montre du doigt cette banlieue des années 1950, celle qu’il a connue bombardée, celle que voilà terne – je vous passe la phrase sur les guinguettes -, malade, pauvre, malaimée, où les objets précieux sont cachés dans les buffets de salles à manger où l’on ne mange pas.
Douze heures plus tôt (car il est déjà bien tard), j’ai mis d’autres regards dans les photographies de Corinne Mercadier exposées à la MaBA. La visite était guidée, très bien guidée, avec plaisir et clarté, d’une voix ferme joliment froissée d’un trait d’espagnol.
Et puis il y avait eu le formica coloré d’un bar bruyant où la conversation fait oublier le bruit.
Lundi 19 novembre
J’en ai suivi des yeux l’étendue. Une étendue de pierres tombales absolument inimaginable. Dans un coin au nord de la vallée se dressait isolée une construction au toit de chaume qui ressemblait à un temple.
Akira Yoshimura – Le Convoi de l’eau
Parce qu’il avait suffi qu’hier vous parliez de cet auteur, de ce livre.
Dimanche 18 novembre.
 Ce sont des noms à la plume. L’écriture est minuscule, précise mais souvent illisible. Ici on devine, là on s’interroge. Plus loin tout est clair : le caractère est plus gros. Je guette quelques détails de ma région d’origine, puisque ce sont ici des ports, des côtes, des mers que l’on voit, des océans traversés il y a des siècles, 520 ans par exemple. Les cartes nous montrent l’inconnu, l’inimaginable (ou parfois l’imaginé), il ne manque plus qu’une odeur de houle puisque même le craquement des navires vous accueille. L’exposition L’âge d’or des cartes marines – quand l’Europe découvrait le monde, à la BNF, est une invitation au voyage dans l’ailleurs et dans le temps, dans la beauté courageuse, intrépide, téméraire de ces vies au long cours.
Ce sont des noms à la plume. L’écriture est minuscule, précise mais souvent illisible. Ici on devine, là on s’interroge. Plus loin tout est clair : le caractère est plus gros. Je guette quelques détails de ma région d’origine, puisque ce sont ici des ports, des côtes, des mers que l’on voit, des océans traversés il y a des siècles, 520 ans par exemple. Les cartes nous montrent l’inconnu, l’inimaginable (ou parfois l’imaginé), il ne manque plus qu’une odeur de houle puisque même le craquement des navires vous accueille. L’exposition L’âge d’or des cartes marines – quand l’Europe découvrait le monde, à la BNF, est une invitation au voyage dans l’ailleurs et dans le temps, dans la beauté courageuse, intrépide, téméraire de ces vies au long cours.
À la sortie, la librairie, lieu exigu au milieu d’un grand espace presque vide, la littérature me tend les bras, mais c’est dans ceux de l’image que je plonge, dans ceux de l’image photographique influencée par les images cinématographiques. « L’Image d’après », splendide catalogue d’une ancienne exposition de la cinémathèque, me fait penser à ce souvenir que j’avais eu soudain en parlant de ma série de photos « Vous suivre ». Car en effet, le 27 février 2007, j’écrivais :
« Pas de printemps pour Marnie » commence par un plan magnifique : un sac à main, une valise, une brune qui marche en nous tournant le dos sur un quai de gare, une perspective.
Et quoi d’autre ? J. The New Yorker. Un film (Augustine). D. P & C.
Samedi 17 novembre
Finalement j’avais terminé, j’allais partir à La Poste parce qu’être Parisien a de fichus avantages, et puis voilà qu’il est venu. Sa mère se plaignait du bruit de ceux qui squattent les terrasses ; vraiment c’était pas bien que la mairie ait enlevé les trucs là-bas ; non mais si je voulais faire des travaux je paierais pas cher ; non mais vraiment il fallait que je sente ce qu’il y avait dans son sac… ben oui de la menthe ; il avait des petits bacs chez lui ; malheureusement il lui manquait du persil frisé ; le soir en rentrant il fumait parce qu’après quinze heures de boulot pffff ; je voulais pas son numéro au cas où, pour des travaux ? Scène improbable et drôle qu’il m’a bien sûr fallu imiter, recomposer, le soir au dîner. C’était avant la quiche aux légumes je pense ; j’avais alors posté la chose, j’avais enfin l’esprit tranquille.
Il y avait eu aussi cette photo que je n’avais pas prise, pas osé. L’homme dans le PMU, tête en arrière au milieu des murs verts, regardant un écran que je ne voyais pas dans ce lieu éclairé de néons et dont la lumière m’émerveille à chaque fois. Les clichés osés, pris en marchant, flous mais laids, ont été effacés.
Vendredi 16 novembre
Et le voici qui arriva.
Des berlingots, donc, on mangea.
Jeudi 15 novembre
Bon, OK, mais ces deux films de Vecchiali, tu es sûr que c’était vraiment utile ?
Mercredi 14 novembre
 Les murs sont éphémères et blancs, le pass était jaune vif, la foule plutôt habillée de manière sombre et dans la salle qu’on ne connait pas, tout là-haut, le plafond gris. Sur les murs les images sont multiples, couleur ou pas, contemporaines ou pas, et ce moment à Paris Photo nous offre une immense satisfaction, entre surprises et splendeurs, même si, vous savez bien, au bout d’un moment c’est trop, une sorte d’écœurement, d’épuisement. Alors on part à pied, à Alma on grignote et s’attriste des déchets générés par une simple petite faim, et puis enfin le Palais pour la deuxième conférence de Pascal Rousseau. L’abstraction se loge cette fois dans la danse, et c’est Loïe Fuller qui s’y colle, avec brio, encore, et l’on retrouve Chéret, le miroir aux alouettes, Koloman Moser, l’hypnose, Picabia, l’hystérie, l’étagement des corps, les fantômes, la danseuse Lina qui était modèle pour Mucha, le corps astral et les psychicones. Hein ? Non non j’vous promets, j’ai arrêté l’alcool.
Les murs sont éphémères et blancs, le pass était jaune vif, la foule plutôt habillée de manière sombre et dans la salle qu’on ne connait pas, tout là-haut, le plafond gris. Sur les murs les images sont multiples, couleur ou pas, contemporaines ou pas, et ce moment à Paris Photo nous offre une immense satisfaction, entre surprises et splendeurs, même si, vous savez bien, au bout d’un moment c’est trop, une sorte d’écœurement, d’épuisement. Alors on part à pied, à Alma on grignote et s’attriste des déchets générés par une simple petite faim, et puis enfin le Palais pour la deuxième conférence de Pascal Rousseau. L’abstraction se loge cette fois dans la danse, et c’est Loïe Fuller qui s’y colle, avec brio, encore, et l’on retrouve Chéret, le miroir aux alouettes, Koloman Moser, l’hypnose, Picabia, l’hystérie, l’étagement des corps, les fantômes, la danseuse Lina qui était modèle pour Mucha, le corps astral et les psychicones. Hein ? Non non j’vous promets, j’ai arrêté l’alcool.
Mardi 13 novembre
F.M. — Le monde immense de l’Amérique latine est aussi passionnant. Vous le connaissez un peu ?
M.D. — Je n’y suis jamais allée. Il me semblait que ça faisait partie d’un acquis que j’avais eu à l’école. Que ce n’était pas la peine. Que, du fait aussi de mon enfance en Indochine, je pouvais ne pas aller voir de ce côté-là de la terre.
F.M. — Puisque vous parlez de l’enfance, moi, j’avais l’impression de connaître le monde, par les cartes sur les atlas, les planisphères, quelquefois les mappemondes. Et, selon la couleur choisie par l’éditeur, je fixais mes sympathies et mes antipathies. Il y avait un certain vieux rose, je me souviens, qui marquait l’Inde, et un autre, profond, pour Bornéo. Et l’Égypte, ocre-jaune. J’ai toujours rêvé d’aller dans ces pays. J’y suis allé et j’ai reçu en pleine figure l’éblouissement premier. Pour quelques bistres douteux, des pays sont morts dans mon esprit. Avec ce bagage-là, pas facile d’entrer dans la réalité ! J’y suis entré pourtant, j’ai voyagé, corrigé mes préjugés exagérément subjectifs. Mais les simples cartes coloriées de mon enfance ont quand même déterminé ma connaissance du monde.
Lundi 12 novembre
L’homme est assis devant un parterre de gens. Derrière lui sont accrochées sept photographies qu’il a prises, leurs teintes sont d’automne, de soir d’été, jaunes, rouges, oranges. Il a tremblé avant de s’asseoir, puis a assommé la foule pour que tout le monde se taise, mais ça n’a pas complètement marché : « it comes from downstairs », quelqu’un a dit. Parce qu’en face de lui, oh oui, ils sont silencieux, enfin ! il est là, ça fait une heure qu’ils l’attendent, Lou. Moi aussi ça fait une heure que je l’attends le vieux Lou. Il y a vingt ans je découvrais le Velvet Underground, alors une heure de plus…
Et comme je n’écrirais pas ici ce qu’il a lu puis dit, permettez-moi de reporter quelques phrases lues le matin-même dans ce petit ouvrage que j’avais tristement abandonné il y a quelques semaines, au bout d’un chapitre, quelques phrases qui ne sont peut-être pas les plus belles des échanges entre Marguerite Duras et François Mitterrand, mais vous allez comprendre :
M.D. — Que c’est beau, la Charente, Saintes, c’est une ville secrète, une des plus belles de la France. Et Aulnay-de-Saintonge, une des plus belles églises.
F.M. — Vous connaissez Aulnay ? Ah ! Elle vaut les temples grecs. L’église d’Aulnay, c’est un des chefs d’œuvre du monde.
Jeudi 8 novembre
Le Cercle est autour de la table rectangulaire, ça papote lignes courbes et savonnettes. Bientôt il y aura des articles, déjà j’ai un nouveau livre, superbe cadeau avec la délicieuse touche d’humour de l’auteur.
Mercredi 7 novembre
Je cherche d’abord à te retrouver. Je traverse donc les salles rapidement, je jette un oeil ici, un autre là, ce que je vois est magnifique, nébuleux, étrange, j’aime. Je pense immédiatement aux travaux de Jean-Michel Fauquet à cause de cette frontière invisible entre le réel et l’irréel, entre le noir et blanc et la couleur, entre le possible et l’impossible. Je serre une main puis deux, une troisième à chignon, tu es là, Corinne Mercadier est devant toi, elle vous explique sa méthode mais j’arrive trop tard, tu me résumes mais je suis un peu ailleurs, je pense à ce que je viens de voir. Puis quelques pas vers cette image que je regarde intrigué depuis des jours, des semaines, celle du carton. Elle explique encore, heureuse et souriante, et la magie est encore là, intacte, dans cet objet qui flotte.
Mardi 6 novembre
Finalement : rien.
Lundi 5 novembre
Dans une main, le sac, toujours, assez lourd, plus que d’habitude : un parapluie de plus car on prévoit de la grêle, un miroir car cela peut servir, un livre pour réviser quelques notions. Dans l’autre main, parfois sur l’épaule le long du trajet, un sac de sport contenant trois pièces de sous-vêtements – pardon, cinq, puisque deux paires – et deux dossiers retraçant une part de mon passé et dont dépend mon avenir. On peut y trouver des diplômes et des relevés de notes, dont celui auquel j’ai fait allusion hier soir, tu sais, ces 15,25 obtenus au brevet des collèges, en 1989, juste avant le bicentenaire, tandis que Juliette faisait du ski nautique sur la Seine pour Carax et que tu m’as demandé ce que je faisais, alors, à la mi-juillet. Que faisais-je ?
Bref, revenons à aujourd’hui et allons à l’Atelier 40 où Nicolas Emmanuel expose, carrés et pochoirs, sombres ou vifs. Tu t’interroges et il te répond, l’art prend du sens derrière les formes et les couleurs, comment ne pas aimer ?
Dimanche 4 novembre
« Oh oui, je suis venue… deux ou trois fois« . Sa mémoire qui flanche, comme dans la chanson ; en face un sourire complice, un peu gêné. Et puis le soir Carax : Les Amants font briller le Pont Neuf.
Octobre 2012
Samedi 27 octobre – jeudi 1er novembre 2012
« J’ai habité là », nous dit Suzanne. C’est en effet près de la meule que nous logeons pendant ces belles journées d’automne, accueillis à l’arrivée, comme au départ, par une fraîche coïncidence de grêle.
C’est au Moulin d’Andé que nous sommes, au Moulin d’Andé que l’on s’abandonne, lieu propice aux divagations et au travail, pas de trouble, pas de tâches. Ces jours sont l’occasion d’un autre genre de travail, un travail de construction, de réflexion, l’idée d’un livre de photos du Japon, les images du premier été, l’an passé, le regard neuf, ébloui, ravi, aux aguets, un peu perdu sûrement, ni repère ni habitudes, vingt-trois jours de photographies entre des parenthèses d’avion. Au milieu des photos qu’il faut sélectionner je cherche les mots dans mes carnets (le grand avec les souvenirs encore frais et les collages, le petit avec les croquis et les regards en direct), dans mes souvenirs, dans ce qu’évoquent toutes mes images ou encore dans les écrits de Kawabata. Dans Les quatre saisons de Kyôto, où l’auteur accompagne croquis et peintures de Kaii Higashima, j’apprends les noms des objets (sudare, mushiko, noren…), je découvre l’idée merveilleuse des paysages empruntés, je revois les camphriers majestueux du Shôren-in.
Bref… au Moulin le temps passe aussi dans les promenades. Autour de ce lieu de vie où je parlais d’abandon, l’abandon d’un certain soi-même pour autre chose, autour de ce lieu on utilisera le même mot, des signes d’abandon, l’abandon d’un autrefois pas si ancien, d’une industrie dont il reste des fantômes et quelques activités fragiles au loin. Les feuilles sont roussies, les falaises dominent, le bar-tabac-épicerie est presque le centre de tout, en face c’est Porte-Joie et nous voici, imaginez donc un peu, qui pédalons sur cette Seine au calme apparent. Et les cimetières, évidemment, que, le 1er novembre, d’autres aussi visitent un balai à la main, comme on brosserait un peu les cheveux d’un ancêtre.
Et puis on partage, les repas ou la musique, on fait connaissance, on sourit des tasses disparues, réapparues dans un film puis un autre, on évoque encore ce champignon géant, et l’ombre d’un certain Butterfly virevolte, improbable.
Le soir on se promène, les ombres sont vert-de-gris sous la pleine lune, le chemin plongé dans le noir si celle-ci est nuageuse et puis on regarde un film : Road One de Robert Kramer, Liberté Oléron de Bruno Podalydès, L’Argent de Bresson (Bresson qui dit que « l’art trop préparé ce n’est pas de l’art », Bresson qui me subjugue par des cadrages splendides où des portes s’ouvrent et se ferment comme jamais), L’enfance Nue de Pialat et l’Amour existe du même Pialat, fulgurant court-métrage que j’attends de revoir, et brièvement je note un bout de phrase :
…la fin du travail à l’heure où ferment les musées…
Le dernier jour, juste avant le départ, le fauteuil respire, les ombres vont et viennent sur le tissu rouge, ce rouge qu’on retrouve dans le coin de la pièce sur les livres anciens ou les reliures des Illustration, années 19, 22, d’autres années sûrement encore mais je n’y prête pas attention, trop tard : il est l’heure.
Vendredi 26 octobre 2012
Je ne crois pas que mes années 80 aient été fluos, en dehors d’un énorme machin jaune accroché à la ceinture — mais comment appelait-on cela ? —, d’un porte-clés en forme de skate-board acheté je crois à Seignosse et de quelques scoubidous. Sur scène, ce soir, chez Pompidou, c’était flash-black à la fois dervicho-fascinant (le début) et fesso-barbant (la fin). Les années 80 reviennent et la chenille redémarre ?
Jeudi 25 octobre 2012
Mercredi 24 octobre 2012
Fémis. Déchirés / Grave, film de Vincent Dieutre. Ils miment, imitent, raniment quelques fantômes télé-réels dont j’ignore tout, caricatures, personnages hybrides, enfants inventés de figures emblématiques décortiquées lors d’un workshop. Quelques-uns, deux en fait, sont insupportables, la dernière surtout, je ne crois pas en elle, je ne crois pas à ça, et pourtant elle a existé, des morceaux ont existé, les mots ont vraiment été prononcé, elle est un collage, et ce collage cristallise un sentiment d’exaspération. Dans le taxi qui à la maison nous ramènera, c’est à la raison que tu me ramèneras.
Mardi 23 octobre 2012
Lundi 22 octobre 2012
L’homme très grand, très très grand s’assied en ignorant complètement celui qui, de longues minutes, va être son voisin de banquette. Le vieux monsieur jette un regard ou deux, un vers moi et je lui souris avec un mélange de compassion et de moquerie envers l’autre, là…
Dimanche 21 octobre 2012
J’avais fini l’affiche, j’avais trouvé le truc, un peu gonflé, un peu décalé, un peu hypnotique, ça évoquait le temps et une radicalité graphique vers laquelle j’ai envie de tendre, dans laquelle je me sens plus à l’aise évidemment. Alors on est allés au Bal, enfin, depuis le temps qu’on en parlait. Sur les murs : Paul Graham, entre photographie sociale regardant les années Thatcher avec force et street photography regardant les secondes passer, avec facilité peut-être. Comme il faisait beau ensuite on a marché. Comme il faisait drôle le soir, dans le Podalydès.
Samedi 20 octobre 2012
C’était plutôt pas mal que le film ne soit pas bien. Enfin, je ne sais pas s’il n’était pas bien, c’est peut-être un jugement de valeur un peu hâtif (quoi que 30 minutes, c’est une hâte de tortue nous dirait La Fontaine), mais je sais qu’on en est partis, c’est rare qu’on parte, mais qu’importe, donc c’était plutôt pas mal car on a improvisé une séance de cinéma Ozonienne. Ozon je l’avais un peu laissé de côté depuis quelques films, mais qu’importe, j’avais le pied gauche humide, je ne savais pas pourquoi, ou plutôt par où était entrée l’humidité, par les coutures peut-être. Et l’Ozon donc c’était agréable, un film de samedi après-midi, ni un chef d’œuvre ni l’opposé, un film simple, souriant malgré les apparences et les caricatures, rien de plus. Le soir on a regardé Loulou, un autre genre d’apparence ; du genre tout le temps à poil…
Vendredi 19 octobre 2012
 M.G. est à l’entrée, surprise. Moi, poser ? Il sait bien que j’aime ça, ça m’amuse, je suis presque prêt à presque tout, alors si ça peut rendre service… et puis ça ne sera pas la première fois, hein ?…
M.G. est à l’entrée, surprise. Moi, poser ? Il sait bien que j’aime ça, ça m’amuse, je suis presque prêt à presque tout, alors si ça peut rendre service… et puis ça ne sera pas la première fois, hein ?…
Au Mac/Val, Fabrice Hyber a installé son magasin, son bric-à-brac, ses objets à regarder, à toucher, à enfiler, à utiliser… Et l’objet banal (ou pas) devient quelque chose d’autre (ou pas).
Un tour ensuite dans le nouvel accrochage du lieu, on passe de Cécile Paris à Sarkis (ci-contre, superbe), et le temps d’un verre on retrouve les visages de Nogent, d’Ivry ou d’ailleurs. On dîne à la maison ?
Jeudi 18 octobre 2012
Délicieux est un adjectif ravissant qui prend ses sources dans la délicatesse et se termine en ciel, en rêve… C’est ça, tout à fait ça, c’est tout ça Elisabeth Clark, délicieux, délicat, onirique. Cette fois c’est coloré et ça flotte au plafond d’un sous-sol, c’est fragile, c’est un détail qu’on n’ose pas regarder, quelques mots sur un mur, un joli moment bercé de ce joli accent, moment bref car il faut y aller. Et on a bien fait d’y aller, d’y aller tôt je veux dire, on était si bien placés.
Mercredi 17 octobre 2012
Il me traverse alors l’esprit, dans cette salle sombre du PdT, que je pourrais rédiger un billet sur ce que je suis en train d’entendre. Pascal Rousseau revient, ou plutôt va et vient sur les origines de l’abstraction. Les origines, les prémisses, les balbutiements, la procréation… On passe de Kupka aux toiles futuristes d’une peintre suédoise vers 1860, de Newton à Mondrian en passant par le spiritisme, trois figures style Sécession (hop, je divague un peu et repense à Liège), la représentation du son ou la photographie de la pensée. L’Art nouveau est alors cité en exemple, ses arabesques, ses motifs géométriques, Klimt ou Van de Velde. Évidemment Van de Velde ! … Et c’est là que ça me traverse l’esprti, un billet sur les Chardons mais un vrai billet ne verra probablement pas le jour, une allusion sera peut-être suffisante, voire un simple copier-coller de ce que vous êtes en train de lire, vous avez bien compris que j’étais passé à autre chose, d’autres choses et je n’arrive à étirer le temps. Pascal Rousseau, donc, entamait ce mercredi son cycle de conférences au Palais de Tokyo (http://www.palaisdetokyo.com/fr/conference/attractions-0).
Et alors ?
Passionnant. D’abord que je suis curieux et que sur le sujet j’ai presque tout à apprendre. Ensuite parce que Pascal Rousseau est brillant, captivant, un orateur sans le moindre de ces « heu » qui rognent un discours. La voix est nette, le regard présent, on se demande à quoi servent ces feuilles posées là devant lui. Vivement le 14 novembre pour la suite…
Pour le moment, la suite, c’est ceci et cela, le travail de Damir Očko surtout, oh oui surtout, entre fragilités, envols et graphisme Rodtchenko-esques. On dîne ici ?
Mardi 16 octobre 2012
« Et vous, vous êtes qui ? », me dit-il. Il ne sait pas. Je ne savais pas qu’il ne savait pas, je ne pouvais même pas m’en douter. Alors il me dit « On m’a dit que ». Je lui dis qu’on ne m’a jamais dit ça, que je ne peux pas deviner si on ne me dit pas qu’on dit que. En même temps on n’a pas besoin de me le dire, j’en suis conscient… Bref.
Dimanche 14 octobre 2012
Vendredi 12 octobre 2012
Gare Montparnasse. Applaudissements. Je devine que ça provient des alentours de ce piano posé dans le hall depuis… depuis quand en fait ? Quelques mois ? Je m’approche, on joue à présent une sorte de musique répétitive ; l’acoustique du lieu génère un peu de confusion. Au clavier, ils sont deux, l’un est assis, l’autre est à sa droite. À quatre mains, les regards sont rivés sur eux, une majorité de sourires, sourires heureux ou surpris, surpris parce qu’évidemment ces deux jeunes on ne les imaginerait pas à un piano, avec leurs baskets, leur survêt, leur capuche qui dépasse du blouson en cuir. Celui qui est debout s’éloigne. Sur le tabouret, le pianiste passe à autre chose, une musique qu’on dira pop jusqu’à ce que je la reconnaisse et c’est alors moi qui sourit : Barbie Girl.
Et sinon : toi à Italie, le courrier des lecteurs du Monde où le mariage pour tous montre l’aveuglement de notre société hétérocentrée, la campagne, l’automne, les cèpes.
Jeudi 11 octobre 2012
Clac clac clac clac. Rafale. La photographe n’entend donc pas le bruit qu’elle fait ? Sur scène ils l’entendent, ça les dérange, forcément ça les dérange, toi aussi j’imagine, moi aussi, je m’énerve sur mon fauteuil, je ne comprends pas, puisque sur scène aucun mouvement, un battement de paupière peut-être.
Lumière revenue, on en parle, d’autres lui disent, elle tombe des nues : elle n’a donc pas entendu le bruit qu’elle faisait.
Et aussi : colloque à Fontenay, épaule d’agneau…
Mercredi 10 octobre 2012
En arrivant je n’avais rien senti. Il est probable que ça ne sentait rien. Quelle heure était-il quand on a fait la première remarque ? Moins de 10 h. Ensuite ce fut l’emphase, l’hyperbole : « ça sentait la merde », disait-elle.
Non. Ça sentait l’enfance, les week-ends de vendange ou plutôt les jours d’après, l’odeur provenant du chai quand on passait dans la souillarde, bref : le moût. Les vendanges, ah les vendanges… Je vous ai déjà parlé de la rédaction dans le petit carnet bleu ? Ah oui : le 7 décembre 2009…
NB. Hep toi le grand redskin avec ton total look, c’est pour nous offrir un peu de tendresse en supplément de ta tête de grand gentil que tu fais dépasser de ta manche le grand coeur rose accroché à un bracelet ?
Mardi 9 octobre 2012
 Trois carcasses en survêt’ rappent devant une foule nippée bien autrement. On ne distingue même pas une casquette sur la tête d’un spectateur, mais on a l’habitude de se décoiffer en tel lieu. Un argot américain distille un flot de syllabes que je capte à peine. Lorsque ce petit show qui terminait le court métrage s’achève, le réalisateur du dit court se lève, pointe le doigt en l’air, vainqueur d’on ne sait quoi. La modestie est piétinée par ce doigt, cette moue, cette attitude. Pourtant c’était plutôt beau, ce bleu, la voix de Charlotte R…
Trois carcasses en survêt’ rappent devant une foule nippée bien autrement. On ne distingue même pas une casquette sur la tête d’un spectateur, mais on a l’habitude de se décoiffer en tel lieu. Un argot américain distille un flot de syllabes que je capte à peine. Lorsque ce petit show qui terminait le court métrage s’achève, le réalisateur du dit court se lève, pointe le doigt en l’air, vainqueur d’on ne sait quoi. La modestie est piétinée par ce doigt, cette moue, cette attitude. Pourtant c’était plutôt beau, ce bleu, la voix de Charlotte R…
Lundi 8 octobre 2012
Elle se dit que c’est encore un peu l’été. Elle porte donc une robe très courte à l’imprimé improbable, un mélange de panthère et de camouflage aux couleurs d’automne. Des talons hauts bien sûr. Elle vérifie dans la vitre, sombre sous le tunnel, que sa permanente tient bien ; elle y passe un peu ses doigts avant d’arriver à Nation. Alors elle se lève, tenant d’une main ferme son petit sac noir et un sac plastique multicolore de chez Pylones. J’en suis à la page 25, il fait beau, Blanche a donc saisi une ombrelle en cretonne imprimée à carreaux. On vient de déclarer la guerre dans ce 14 d’Echenoz. La veille aussi, la même déclaration de guerre, dans Downton Abbey, avait suscité l’émotion ou l’enthousiasme, c’est selon. Après le Riboulet ou le Bozon, cette fichue guerre était décidément au coeur de notre rentrée culturelle.
Dimanche 7 octobre 2012
– Il n’est pas assez cuit le riz.
– Oui mais j’aime le risotto un peu croquant.
Samedi 6 octobre 2012
Il y a 18 mois, nous avions déjeuné dans un bouiboui du Marais, ce n’étais pas fameux je crois, mais c’était sans importance puisque alors on se retrouvait après des années sans se voir, peut-être douze. On avait évoqué nos vies, toutes les années passées, loin, pas si loin : c’est un mouchoir l’Europe. Ce samedi Virginie terminait une laborieuse semaine parisienne, et j’avais mieux choisi le lieu, La Fresque, service amusé et cuisine simple et efficace. Je crois que moi-même j’étais plus rieur que la fois précédente, durant ces deux heures conclues par une évidence : au printemps on verrait Munich.
Après le déjeuner, prévoyant que le soir on trinquerait encore, je partais à la recherche de verres à vin dignes de ce nom ; ils nous offriraient plus de parfums que le pourtant joli service étoilé qu’on aime tant. Autre parfum, celui de l’encre, me voici dans les rayons, les tranchées par Echenoz, le Mexique par Plossu, Venise par Gautier, le japonais aussi puisque je ne lâche pas le morceau, courageux dites-vous…
Le soir, un peu grisé, je repasse au présent, ils sont là, soudain on rêve de Venise en janvier, j’imagine la brume, le froid, sorte de folie romantique et photogénique ; as-tu des bottes, toi ?
La nuit enfin, Fanny Adler et Vincent Madame illuminent un recoin de Nuit Blanche de leurs voix que j’aime tant, de leurs textes qui frappent, tout droit venus de petites annonces amoureuses, perdues, éperdues, attendues, tendues, arquées, osées, claires, nettes, précises. Photo du spécimen contre un timbre.
Vendredi 5 octobre 2012
Cave à vin, chéri ; Kawase, Chiri.
Jeudi 4 octobre 2012
Et si on passait au salon ?
Mercredi 3 octobre 2012
 Parfois, derrière l’un d’eux, une feuille passe. Il y a celui qui hésite, fébrile. Il y a celle qui lit, presque froidement. Ceux qui décrivent. Celles qui racontent. Celui qui impose. Celui qui a la même couleur de veste que toi. Celui qui me fait éclater de rire. Toi que j’aimerais écouter encore. Parfois on a envie de lever la main, d’interpeler, faire remarquer. Mais ils ne sont pas là, ils sont sur l’écran, et je les écoute, même si évidemment parfois je divague. D’ailleurs qui a dit « Le son est une dimension de l’image » ? J’ai noté la phrase mais…
Parfois, derrière l’un d’eux, une feuille passe. Il y a celui qui hésite, fébrile. Il y a celle qui lit, presque froidement. Ceux qui décrivent. Celles qui racontent. Celui qui impose. Celui qui a la même couleur de veste que toi. Celui qui me fait éclater de rire. Toi que j’aimerais écouter encore. Parfois on a envie de lever la main, d’interpeler, faire remarquer. Mais ils ne sont pas là, ils sont sur l’écran, et je les écoute, même si évidemment parfois je divague. D’ailleurs qui a dit « Le son est une dimension de l’image » ? J’ai noté la phrase mais…
Sinon Labarthe a dit qu’avec les jumelles de théâtre, le spectateur est devenu acteur de ce qu’il voyait. C’est pas mal cette idée, faudra que je la replace. À la cantine ça va faire son petit effet.
Mardi 2 octobre 2012
En partant, le matin, je ne prends pas mon appareil photo. Trop lourd, ça suffit pour une fois… De toute façon à quoi ça sert ? Avec moi, Le Seul Visage, d’Hervé Guibert, recueil photographique qui rend presque vaine toute autre image.
Lundi 1er octobre 2012
Two Gates of Sleep.
Regarder un film avec un titre pareil à une heure tardive est évidemment la porte ouverte à quelques évidences… Néanmoins je n’ai pas compris le rapport entre le film et son titre, même à la fin (vue le lendemain, vous pensez bien…)
Septembre 2012
Dimanche 30 septembre
Ce sont de la dentelle et des formes inédites, des couleurs, des ombres puisque il fait soleil : je n’étais jamais entré dans la Mosquée de Paris.
Quant au Jardin des Plantes, je n’en avais que peu d’expérience de plus , une promenade ou deux : ça n’a jamais été mon quartier.
Et la fashion week, je vous ai parlé de la fashion week ?
Et puis Jeanne, Mireille, des crêpes et ça :
À l’instar des romans de Michel Houellebecq, le livre est sadique, pornographique et morbide.
Un crime parfait, David Grann
Samedi 29 septembre
Il y avait du soleil, c’était l’heure d’un café, on avait fait quelques courses dans ce quartier qu’on aime tant, on pensait au soir, aux fruits ou aux légumes, à la rascasse, que sais-je, à pas grand chose, respiration délicieuse mais brève. Plus tard on allait à Bastille, sur les murs il avait accroché des couleurs dorées ou acidulées, mais on a choisi les couleurs des étagères, un vert asperge, un or rhum…
Et le dîner donc. Le Japon, encore, infiniment.
Vendredi 28 septembre
Je me suis dit dans ce RER du matin que je tenais quelque chose à écrire dans ce journal : quelque chose à dire sur les chaussures. LA chaussure, l’image qu’elle renvoie. Le jeune blondinet n’est qu’un jeune blondinet entassé dans le RER comme vous et moi, jusqu’à ce que votre regard se pose sur ses santiags : le blondinet se retrouve alors enveloppé d’une certaine carcasse… qu’il n’aurait pas avec des ballerines. Qu’il n’aurait pas non plus avec une jupette et des tiags, je vous le concède. Bref.
Je me suis dit dans ce métro du retour, retour tardif après quelques photographies d’un concierto de la Légioune éstrangère, parce que j’ai un métier, mine de rien, oui donc je me suis dit dans ce métro du retour que je tenais quelque chose à écrire dans ce journal : quelque chose à écrire sur cette jeune femme, une description comme je les aime, brève, simple, une image furtive mais la plus précise possible. Elle ressemblait à Sarah Jessica Parker, les yeux bleus. Surpris par la ressemblance, je l’ai fixée, oh, un rien de temps, le temps que ça la dérange et que ça me gêne. Ses cheveux étaient plutôt sombres. Elle écoutait de la musique dans un casque couleur bordeaux. Elle portait un blouson Hermès en matière synthétique, fond sombre et motifs dorés. Ostentatoire est l’adjectif. Ses ongles étaient bicolores, verts et… dorés ? J’ai oublié. Elle s’est remis du rouge à lèvres, je l’ai regardée dans le reflet qui l’abritait de l’autre côté, et au bout d’une station elle se levait déjà pour descendre, quoi qu’avec ses nouvelles rames accessibles on ne descend plus vraiment : on glisse, on translate. Elle est en tout cas partie trop vite : je n’ai pas eu le temps de voir ses chaussures. Des tiags ? Pourquoi pas…
C’était sans compter sur la suite. On devait se retrouver à St Paul, toi et moi. Et puis non. La voix légère, tu m’as parlé d’un dîner, tu n’étais pas sûr, tu m’as rappelé alors je t’ai rejoint, ailleurs, plus haut. La fin de soirée qui a alors suivi fut presque insolente de drôlerie et de légèreté. De bon goût aussi : on y confirma que le flacon était autant important que l’ivresse. Whatever… How do you say « spontaneous » ?
Jeudi 27 septembre
Ils m’ont appelé, une voix masculine, elles sont prêtes, alors j’y vais. Personne dans la boutique. Au premier étage, ils m’attendent, il tient déjà ma péniche : ils m’ont vu dans la caméra. Ils s’y mettent même à deux : « on s’emmmm (elle hésite) mmmmerde… », dit-elle en terminant sa phrase par un rire. Des sommes et des ajustements, le temps qu’il fait pour tester les solaires, mon sourire satisfait, ses yeux bleus si près pour une dernière vérification…
Au PdT, il y a moins de monde dans les espaces d’exposition qu’au bar. J’exagère peut-être un peu mais vous voyez l’idée. En bas, des oiseaux ou une fontaine mais nos poches sont vides. Ailleurs mexican Moz fans, autisme, laissez-moi réfléchir, j’ai oublié le reste. D’en haut, Fabrice Hyber. Vous auriez du medium 12 ? C’est pour un escalier. Finalement on repart avant la foule sans carton, bonjour Jeanne S et tentations de librairie.
Mercredi 26 septembre
RTT. Trois lettres que j’emporte en général avec moi, à la campagne ou plus loin. Cette fois c’est ici que ça se passe, le temps pris, le temps de… un déjeuner avec D… les photos de la MEP. À la MEP, Alice Springs est encore accrochée sur les murs du deuxième étage et je m’interroge encore… jetant sur les photos un regard indifférent. Je préfère la légèreté des vacances de Claude Nori, mais la préférence n’est qu’une notion très relative.
C’est donc le soir qu’on retiendra, le film évidemment, éloge du temps, éloge du rythme d’une journée comme aujourd’hui. Malgré la pluie.
Mardi 25 septembre
Non mais vraiment, Johann, tu es sûr que c’est raisonnable ?
Lundi 24 septembre
Je l’avais surnommé « Tonton-clown » parce qu’invariablement il me faisait pleurer, tout comme les clowns dès qu’ils apparaissaient sur la piste.
Suzanne et Louise, Hervé Guibert
« Je viens de t’envoyer un SMS », me dis-tu. Il vibre. Tu es, en effet, dans la salle du fond du bar de l’hôtel dont on aime le calme et le sens de l’accueil à l’heure de l’apéritif : olives, graines, chips à la betterave. J’espère qu’un soda au cola fera disparaître quelques aigreurs, tandis que dans ton verre c’est aussi l’effervescence. On s’est donné rendez-vous là en attendant d’y aller, juste à-côté, mais si enfin, vous savez bien.
Et donc. Sur le trottoir qui borde le grand magasin, la queue ; une queue d’ombres, silhouettes qui s’éclaircissent comme on s’approche. Mais pas trop : on s’engouffre dans le métro. Quelqu’un peut prévenir Catherine Deneuve que l’on ne viendra pas ?
Dimanche 23 septembre
En sortant, il pleut, et nous traversons donc la cour du Palais Royal en hâte. Une fuite ?
Samedi 22 septembre
Parce que bon, parfois, je me dévoue. Là par exemple, ça me coûtait pas grand chose, et puis ça m’a poussé à sortir. Pas longtemps, j’avais un peu traîné, mais c’était bien tout de même pas mal, ce petit tour au Parc de Bercy. Il faisait beau, il y avait du monde : c’était la Fête des Jardins. Mais il n’a pas pu manger de framboises.
Ensuite je t’ai retrouvé, c’était l’architecture qu’on célébrait, celle des FRAC, à Beaubourg. Une plongée simple, claire, évidemment intéressante dans l’architecture contemporaine, entre gothique pas flamboyant et excroissances de circulation.
 Quelques étages plus haut, un regard sur…
Quelques étages plus haut, un regard sur…
Quelques heures plus tard, un regard sur La France. Le film.
Vendredi 21 septembre
 J’ai un souvenir très net de Belle de jour. Je suis dans la banlieue de Chicago, et je zappe, parce que globalement je n’ai que ça à faire – je sais ça peut paraître étrange. Soudain, au détour d’une des nombreuses chaînes de télévision, Catherine Deneuve apparaît attachée. Le reste du souvenir devient flou, je sais c’est un peu maigre, mais je crois que je n’ai pas regardé le film : à côté dans la cuisine il y avait la mère de L, j’étais sûrement un peu gêné, et pas encore assez cinéphile pour insister. Avais-je déjà vu le film ? L’ai-je vu depuis ? Je ne sais pas, je crois que oui, j’ai trop de souvenirs clairs de ce film, c’était peut-être au ciné-club de FR3, c’était le vendredi soir, non ? Je regardais peut-être plutôt MTV alors, non ?
J’ai un souvenir très net de Belle de jour. Je suis dans la banlieue de Chicago, et je zappe, parce que globalement je n’ai que ça à faire – je sais ça peut paraître étrange. Soudain, au détour d’une des nombreuses chaînes de télévision, Catherine Deneuve apparaît attachée. Le reste du souvenir devient flou, je sais c’est un peu maigre, mais je crois que je n’ai pas regardé le film : à côté dans la cuisine il y avait la mère de L, j’étais sûrement un peu gêné, et pas encore assez cinéphile pour insister. Avais-je déjà vu le film ? L’ai-je vu depuis ? Je ne sais pas, je crois que oui, j’ai trop de souvenirs clairs de ce film, c’était peut-être au ciné-club de FR3, c’était le vendredi soir, non ? Je regardais peut-être plutôt MTV alors, non ?
Bref, ce soir, à la Cinémathèque, c’était Belle de Jour, précédé d’un film de Dominique Gonzales-Forster et Tristan Bera, un court-métrage dans lequel l’un des deux a dû dire à l’actrice : alors voilà, imagine, tu es Catherine Deneuve (puisque tu lui ressembles) dans… Vertigo.
Bref, Belle de Jour. Ah Belle de Jour. Aaaaah !
Oui je sais, c’est un peu court comme argumentaire.
Jeudi 20 septembre
– Allôôôô, tu fais quoi ?
– Des cakes.
– Des cakes ?
– Oui des cakes, je m’entraîne…
Un peu plus tard c’était un autre film de Robert Kramer, Doc’s Kingdom. My doc’s kingdom for a bed ?
Mercredi 19 septembre
Autour du marché d’Aligre, j’erre vaguement ; le souvenir de l’adresse me semblait plus précis, je croyais un coin de rue, mais lequel ? Dans la rue d’autres s’activent à nettoyer la farine étalée sur un bitume qui prend des airs de piste enneigée. Finalement le voici au bout de la rue, moqueur, forcément moqueur sur mon hésitation géographique. Une anisette en terrasse, peut-être la dernière terrasse, peut-être la dernière anisette, c’est bientôt l’automne. Pourtant les amours renaissent.
Le film du jour : Camille redouble.
Mardi 18 septembre
« J’ai découvert qu’on n’avait pas de chausse-pieds dans cette maison ; j’ai pris une cuiller. »
Le film du jour : « Walk the Walk« , de Robert Kramer… qui s’est contre moi transformé vers la fin en « Sleep the Sleep« .
Lundi 17 septembre
Je trouve d’abord qu’à Gare du Nord, en montant dans la ligne 4, il y a une curieuse odeur, une odeur de jambon purée. Oui, c’est exactement ça, jambon purée. Lors de mes premiers séjours à Paris, je trouvais que ça sentait la saucisse de Strasbourg industrielle. Je m’y suis semble-t-il habitué. Quand j’arrive au Select l’odeur du cuir ne m’atteint pas, tu discutes de 2013 avec S. Ce n’est qu’un peu plus tard que mon regard se penche sur tes chaussures. Et puis on traverse la rue ; aux 7 Parnassiens le couvent nous attend. Une jeune femme va épouser Jésus et devenir Teodora Pécheresse après tant de rituels, de cérémoniaux, de simagrées, sortis jadis de quelques esprits imposant en symboles quelques détails capillaires et trinitaires. Ma foi…
Vendredi 14 septembre
Je me lève du siège blanc, me dirige vers le RER qui est entré en gare ; ses portes s’ouvrent et je me retourne pour vérifier que je n’ai rien oublié. Monté dans la rame ils sont deux à se marrer, me regarder et se marrer, mais sûrement rient-ils d’autre chose que de cette carte qui est tombée sur le sol depuis le carnet rose. Je l’aperçois à travers la vitre, les portes se referment. Ce n’est qu’une carte publicitaire, j’avais dit à Nicolas qu’elle était bien, qu’il était bien dessus. À présent son visage est à terre, du mauvais côté, personne ne le verra, personne ne la ramassera.
C’est à Nation que je descends. On s’est donné rendez-vous sur la place, mais elle est grande la place, on pourrait tourner longtemps autour, sans se comprendre vraiment, sans aller dans la même direction. Finalement te voici, et nous voilà dans l’allée fermée d’une lourde grille, attendus par G&P ; déjà leur fils tourbillonne, souriant.
Jeudi 13 septembre
 Il y a deux voix et combien de personnes autour de la table ? On a connu les salons de conversations, voici la salle à manger de lecture. Olivier Steiner et Camille Laurens sont en tête à tête pour un page à page ; du premier j’ai tant aimé son Bohème, de la deuxième je n’ai jamais rien lu, il serait peut-être grand temps.
Il y a deux voix et combien de personnes autour de la table ? On a connu les salons de conversations, voici la salle à manger de lecture. Olivier Steiner et Camille Laurens sont en tête à tête pour un page à page ; du premier j’ai tant aimé son Bohème, de la deuxième je n’ai jamais rien lu, il serait peut-être grand temps.
Les pages passées et les voix refermées, on tourne autour des œuvres puis du buffet. Lui à ma gauche tente de toucher l’épaule de J qui s’éloigne. C’est ainsi qu’on lance un échange de prénoms ; plus tard on évoquera Angot, ce qu’on fait ici, il ne sait pas encore qui tu es, il ne sait pas qu’il te connait, l’alcool pétille et moi aussi un peu.
Mercredi 12 septembre
Fin de Wanda.
Mardi 11 septembre
 Sur la table les multiples gourmandises salées achetées chez le traiteur. J’ai oublié les noms, pas les goûts. Sur la table également ce sac blanc, un peu plié, sur lequel on peut lire un prénom qui n’est pas le tien et une initiale, la sienne. Dans le sac un paquet blanc au dessin noir, froissé parce que caché dans mon propre sac une semaine plus tôt. Dans le paquet une chemise blanche.
Sur la table les multiples gourmandises salées achetées chez le traiteur. J’ai oublié les noms, pas les goûts. Sur la table également ce sac blanc, un peu plié, sur lequel on peut lire un prénom qui n’est pas le tien et une initiale, la sienne. Dans le sac un paquet blanc au dessin noir, froissé parce que caché dans mon propre sac une semaine plus tôt. Dans le paquet une chemise blanche.
C’est un peu plus tard qu’Edina tombe dans les platebandes.
Lundi 10 septembre
Début de Wanda.
Dimanche 9 septembre
 À Orsay on découvre enfin les nouvelles salles. Les impressionnistes attirent la foule dans leurs espaces rouges et gris ; les chefs d’œuvres ne se comptent plus, se succèdent ; on rêve de tranquillité, d’une sélection pointue, rien que pour soi. Ah, certes, dans les nouveaux espaces réservés à l’Art nouveau on est bien plus tranquilles : les pièces exposées sont magnifiques et indispensables, le lieu est aéré, mais… mais… mais est-ce vraiment mis en valeur ? C’est pas un peu triste tout ça ? Et ce pauvre Charpentier qui voit sa salle à manger envahie de bibelots… Et sans pouvoir faire officiellement la moindre photo, reste-t-il encore un peu de plaisir ? Tout de même, Odilon Redon nous illumine et l’on va finalement chercher le jour au café, surveillés depuis le plafond par quelques donzelles en frou-frou, cheveux fleuris, poitrines rondes, ici ou là quelques paons, références bleutées et élégantes de cette époque.
À Orsay on découvre enfin les nouvelles salles. Les impressionnistes attirent la foule dans leurs espaces rouges et gris ; les chefs d’œuvres ne se comptent plus, se succèdent ; on rêve de tranquillité, d’une sélection pointue, rien que pour soi. Ah, certes, dans les nouveaux espaces réservés à l’Art nouveau on est bien plus tranquilles : les pièces exposées sont magnifiques et indispensables, le lieu est aéré, mais… mais… mais est-ce vraiment mis en valeur ? C’est pas un peu triste tout ça ? Et ce pauvre Charpentier qui voit sa salle à manger envahie de bibelots… Et sans pouvoir faire officiellement la moindre photo, reste-t-il encore un peu de plaisir ? Tout de même, Odilon Redon nous illumine et l’on va finalement chercher le jour au café, surveillés depuis le plafond par quelques donzelles en frou-frou, cheveux fleuris, poitrines rondes, ici ou là quelques paons, références bleutées et élégantes de cette époque.
Un tour dans le Marais. L’opticien est ouvert mais ses vitrines fermées et pas très alléchantes, les chemises sont jolies mais les rires trop distants ; ton parfum est boisé, le Japon, encore.
Le soir : Fassbinder, Lili Marleen. Les chemises sont brunes et les rires presque absents. Allez, tous en choeur :
Vor der Kaserne
Vor dem großen Tor
Steht eine Laterne
Und steht sie noch davor
Dort woll’n wir uns wiederseh’n B
ei der Laterne wollen wir steh’n
Wie einst Lili Marlen. (bis)
Samedi 8 septembre
Faire les courses, cuisiner, aller chez le coiffeur, oser, oublier ma montre, prendre un café à une terrasse ensoleillée, faire les courses, acheter une mini-pièce montée, avoir les doigts qui collent, cuisiner. À 23h45 voir passer une tête par la fenêtre et dans les yeux de Nicolas un signe d’étonnement.
Vendredi 7 septembre
Le film du jour s’appelle « L’homme qui dort« . C’est un film japonais. Et comme je ne comprends pas encore très bien le japonais, je l’ai pris pour moi, ce titre. Mais après ces 90 minutes de somnolence, le hasard a bien fait les choses : yakiniku wa totemo oishii desu !
Et puis Angot. Angot, donc. Angot, là. Angot lue dès le matin. Angot ass me glisse-t-on à l’oreille. Sur les premières pages, je ne sais pas si ça m’indiffère ou si ça me dépasse. Le sentiment évoluera, à la fin mon avis ne sera pas plus tranché, mais différent, hors du plaisir en tout cas, autre chose, un objet dans lequel, lecteur, je me sens absent.
Jeudi 6 septembre
 Would you have sex with an Arab ?
Would you have sex with an Arab ?
Non, ce n’est pas une question que je vous pose, c’est le titre d’un film tourné en Israël. La question est parfois inversée (… with a Jew ?), ce qui ne change pas grand chose aux réponses, entre « évidemment non » et « évidemment oui ». Les moments les plus intéressants sont lorsque les personnes questionnées réalisent au bout de quelques instants que… ben leur réponse est finalement étrange, que pourquoi, oui pourquoi ou pourquoi pas… Finalement, un film plus troublant au sens propre (on peut avoir des plans fixes qui ne tremblent pas ?) qu’au sens figuré.
Mercredi 5 septembre
Non ce n’était pas Andréa Ferreol.
Oui, c’était José Levy.
… Et que c’est beau, José Levy.
Et puis – j’ai d’abord écrit « pluie », dyslexie poétique – il y avait les autres, ceux qu’on connait comme ça, celle qu’on n’attendait pas là, celle dont on a cherché le nom – puisque je vous dis que ce n’était pas Andréa Ferreol -, ceux qui avaient les pantalons remontés, ceux qui ne suivent pas cette mode, ceux qu’on embrasse : Yves, qui a ravivé les souvenirs émus des vagues sonores des cigales ; Blaise, à qui on demande des nouvelles des tristes falaises…
Dois-je mentionner la salade de rosbif ?
Mardi 4 septembre
Ils montent alors dans le bus :
– En seconde 6
– Moi en seconde 2. Y a des intellos dans ta classe ?
– Mouais y a plein d’filles.
– Ah c’est cool !
– Y a qu’des thons…
Et c’est donc en ce jour de rentrée scolaire que je me rends chez le docteur E. Ma vue n’a pas vraiment baissé, mais au bout de presque quatre ans, c’est le moment d’être coquet du côté des montures…
Après avoir lu quelques lettres capitales plus ou moins floues, je cherche d’autres lectures. Aux Cahiers, Nicolas me conseille ceci et cela. J’ai déjà dévoré ceci, mais n’ai jamais lu Angot, alors tentons le dernier. Afin de glisser dans mon sac des valeurs sûres, je choisis également deux Guibert, dont le magnifique Suzanne et Louise : je sais déjà que c’est magnifique.
Et puis Catherine, évidemment.
Et puis Arnold, apéritivement.
Lundi 3 septembre
Finalement, avec cette nouvelle carte d’identité, je n’ai plus une tête : j’ai un front. On ne voit que ça, un front, vaguement recouverts d’un bout de chevelure, un front sous lequel s’efface un regard perdu sans lunettes et s’extirpent une moue et une moustache, bref, un autre, dix ans plus âgé que le précédent.
Dimanche 2 septembre
– Mobil home.
– Meurtre d’un bookmaker chinois.
Samedi 1er septembre
On prend le temps, le temps qu’il faut, et puis on part comme prévu, mais bien plus tard que prévu : il est 17h passé. Au fait, ça ferme à quelle heure Orsay ?
18h, ça ferme à 18h Orsay, alors on choisit le soleil qui respire encore et le Parc de Bercy, pour marcher au milieu des allées, s’arrêter un moment, glaner encore un peu de bonheur sur l’herbe.
Et lire.
Ma mère m’a raconté qu’en sortant du tribunal où la séparation d’avec mon père venait d’être prononcée, elle m’a raconté ce jour-là, le jour où nous regardions Wanda sur le petit canapé de son salon, qu’elle avait, quittant le tribunal de Grasse, alors qu’elle venait de perdre, sous la violence de ce qui lui avait été infligé, toute coïncidence avec elle-même, ne désirant, pensait-elle, c’est ce qu’elle m’a dit, ne désirant qu’une seule chose : rentrer à la maison, retrouver ses enfatns, elle m’a appris ce jour-là qu’elle avait erré des heures durant à Cap 3000 puis, la nuit tombée, sur le bord de mer jusqu’à Nice où elle avait vécu enfant, ne pensant à rien, n’éprouvant rien, tombant, le temps passant dans une tristesse mortelle.
À la Cinémathèque, un soda, une chaise longue, la lumière qui décline, on prend encore le temps, juste celui qu’il faut pour ne pas être en retard à Pont Marie. On y retrouve le professeur et sa femme, konban wa, hajimemashite, non non je ne parle pas japonais. Elle, elle parle plusieurs langues, un peu de français joliment articulé. Vous avez du Chardonnay ?
Mercredi 5 septembre 2012
Non ce n’était pas Andréa Ferreol.
Oui, c’était José Levy.
… Et que c’est beau, José Levy.
Et puis – j’ai d’abord écrit “pluie”, dyslexie poétique – il y avait les autres, ceux qu’on connait comme ça, celle qu’on n’attendait pas là, celle dont on a cherché le nom – puisque je vous dis que ce n’était pas Andréa Ferreol -, ceux qui avaient les pantalons remontés, ceux qui ne suivent pas cette mode, ceux qu’on embrasse : Yves, qui a ravivé les souvenirs émus des vagues sonores des cigales ; Blaise, à qui on demande des nouvelles des tristes falaises…
Dois-je mentionner la salade de rosbif ?
Vendredi 31 août
La sœur de Lana del Rey est dans le métro du matin : lèvres carmin, gilet vert bouteille sur une improbable nippe à écailles dorées. Je jette sur elle un oeil amusé, pourtant plongé consciencieusement dans ceci :
Vue de loin, une femme se détache de l’obscurité. Sait-on d’ailleurs que c’est une femme, on est si loin.
Supplément à la vie de Barbara Loden.
Le soir, chez Julien L, on (Florence, Fanny, toi et les autres) évoque des voyages pas si loin ou pas si vieux, des trains qui traversent les continents, des terrines qu’on pourrait faire ensemble ; on se retrouverait dans un maison de campagne, on hacherait la viande en buvant du vin, trop de vin peut-être, on n’est jamais raisonnables quand on cuisine entre amis, emportés par l’énergie, la légèreté, la gourmandise et l’odeur qui vient du four… encore elle, décidément.
Jeudi 30 août 2012
 Quand on franchit la porte, une odeur se jette à nos narines. Elle vient du four dont la minuterie frise le zéro. Un peu plus tôt Charlotte Gainsbourg ronronnait à Pete Doherty qu’il devait s’abandonner à l’amour (froissement de jupons et soupirs).
Quand on franchit la porte, une odeur se jette à nos narines. Elle vient du four dont la minuterie frise le zéro. Un peu plus tôt Charlotte Gainsbourg ronronnait à Pete Doherty qu’il devait s’abandonner à l’amour (froissement de jupons et soupirs).
Permettez qu’on s’abandonne d’abord à la gourmandise et à la faim ? Le vélo dans l’air frais de fin août, ça creuse.
Mercredi 29 août 2012
Vu : Angels in America, premier épisode.
Mardi 28 août 2012
Profiter du soleil, comme la veille ; profiter de nous deux, comme rarement ; profiter des affaires, comme souvent, pourquoi pas, chercher un objet, une carte, une image, un sourire devant les souvenirs décatis ou devant la surprise en bon état…
Et partir.
Dans le train je suis collé à la vitre. Et ce n’est pas qu’une image. À côté de moi, il n’a même pas vingt ans, dégage une odeur mélangeant la crasse et la lessive, le cheveu est gras mais les ongles très bien taillés, un loup bleuté décore son sweet-shirt noir, il lit Tolkien et boira trois soda durant le trajet. Que peut-il bien écouter comme musique ? Parfois il tourne la tête, je sens son souffle sur mon bras, je n’aime pas ça. Lorsque le contrôleur passe, il ne sait pas qu’il doit lui présenter son titre de transport : “C’est pour quoi ?“. “Ben c’est pas pour un tennis“, répond le grand employé à casquette violette. Je reprends ma lecture après cette pause : Riboulet, Mathieu Riboulet, que tu m’as offert jeudi. Ah oui je me suis trompé je crois, ce n’était pas le Walter Benjamin, oh je ne sais plus, je ne l’ai pas noté dans le carnet rose, bref.
Le roman de Mathieu Riboulet est splendide, mais j’y mets quelques bémols, il y a des passages splendides, mais il joue avec le feu, il se brûle, c’est un peu grandiloquent, un peu trop “tordu” dirait-on… un peu trop magnifique ?
(Trouver un passage et le reporter ici en italique pour montrer combien, par endroits, c’est magnifique)
Lundi 27 août 2012
Agen a toujours quelques ressources pour le visiteur de passage, en particulier les expositions de l’église des Jacobins. Cette fois-ci, c’était design, une exposition agréable, avec de très belles pièces, des choses intéressantes, étonnantes, recherchées, gonflées, criardes, ah-non-ça-non-faut-pas-pousser-mémé-dans-les-ortiesques, etc.
… Mais comme Fred et moi sommes curieux, nous sommes ensuite aussi allés voir… hum… une expo de peintures et sculptures… comment dire… moins intéressante.
(Rhoo non sérieux c’était ignoble)
Non vraiment vous voulez voir les photos ?
Ah on me signale en régie que les photos sont inutilisables.
(Dans une autre vie je serai critique d’art, promis)
Dimanche 26 août 2012
Gameraaaaaa !
(Bon ben voilà, ils sont partis…)
Samedi 25 août 2012
Vendredi 24 août 2012
Il n’y a, dans les photographies ci-dessus, pour ainsi dire rien. Parce que presque personne, or ce vendredi c’était surtout des gens, eux, ces amis, revus, enfin, entre trois photos, deux grains de folie et un aller-retour en brasse.
Quoi que, en insistant un peu, juste un peu :
(Une autre fois, écrire sur les photographies vues à Lectoure cette année)
Jeudi 23 août 2012
Sur le fauteuil rouge tu me tends le petit paquet ; le petit livre de Walter Benjamin est emballé, j’ai oublié la couleur du papier. On attend que la lumière s’éteigne sur le joli film Keep the Lights on.
Mais le fauteuil était-il rouge ? Rallumez !
Mercredi 22 août 2012
Mardi 21 août 2012
Dîner chez M&O, une invitée surprise. Une autre, dans la conversation : sa grand-mère.
Lundi 20 août 2012
Carax : Boy meets Girl.
Forcément.
Dimanche 19 août 2012
On s’étonne d’un temps gris, de l’opacité de l’ouest. La boulangerie comme hier, plaisir étonnant pour un moment banal, sortir comme ça pour un bonjour et des viennoiseries, tu parles d’une fantaisie…. et pourtant…
Une promenade là-haut pour nous deux, de l’autre côté de la nationale. L’homme dans sa Peugeot grise s’arrête : “Vous connaissez le coin ?“. Il nous aiguille, nous rassure : ce sera joli. Quelques gouttes, des mûres portées dans une chaussette avant de finir dans un chausson, presque rien, le bonheur d’un paysage vallonné. Au retour un fond de café, et nous retournons à Sainte Suzanne, cette fois tous les quatre, pour le chemin des moulins et même une visite de maison, moment étrange, gênant, la veuve traîne, dans sa voix et au milieu des travaux qu’il n’a pas eu le temps de finir, la fatalité de cette mort qui a frappé. Bref, pensons aux plaisirs et retournons en cuisine : le poulet à la Marguerite nous attend… le poulet, le rougail, le chausson donc aussi, la voix, le tonnerre, la lecture, Duras et Mitterrand qui parlent et racontent la peur…
Je me souviens d’un jour, rue Guynemer où j’habitais à ce moment-là, en rentrant chez moi, je vois un garçon qui était dans ma voiture.
François Mitterrand, Le bureau de poste de la rue Dupin.
Et partir. À Évron attendre encore.