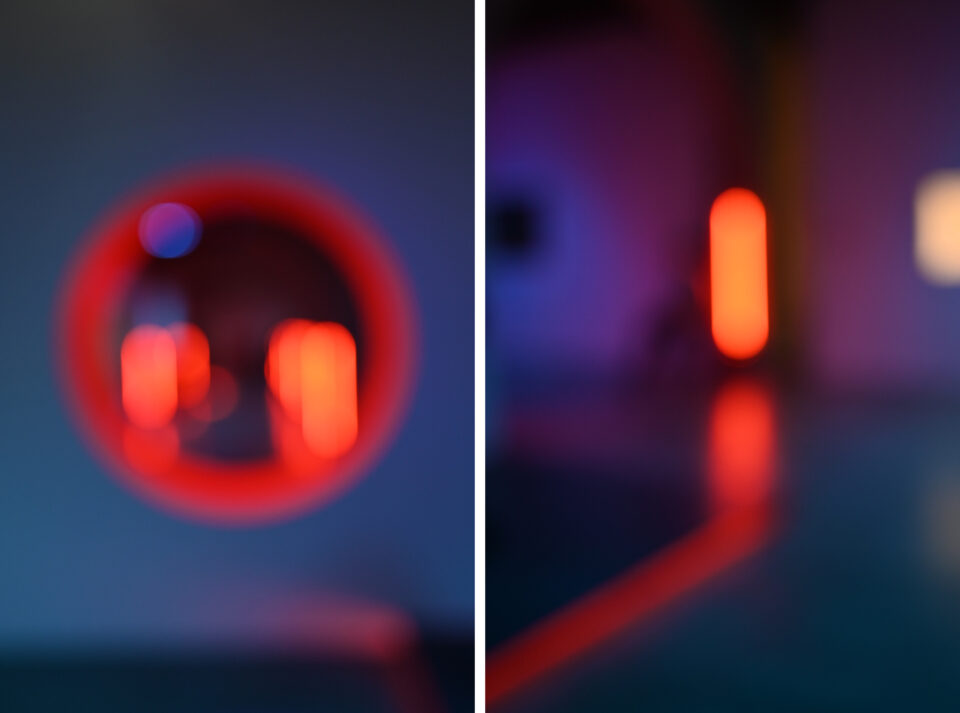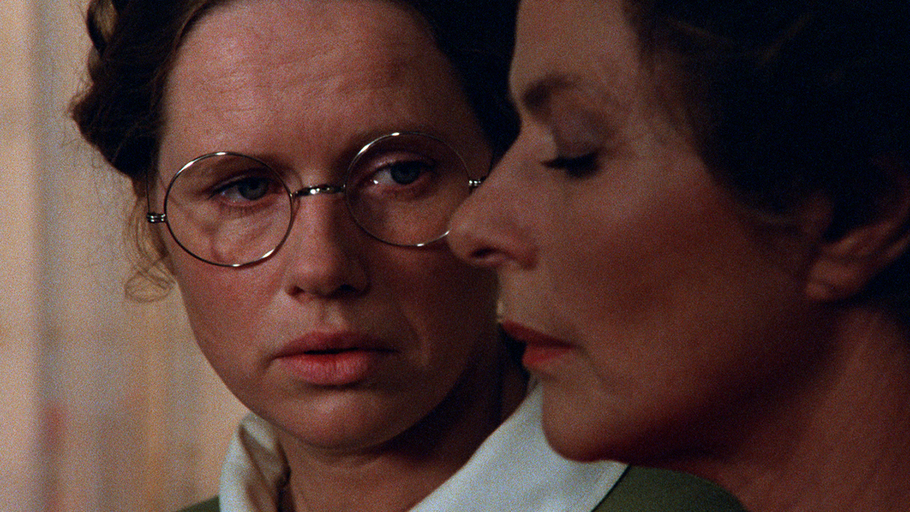Le film du soir : Pillion
Catégorie : Films
Lundi 9 février 2026
Je reviens vers autrefois : un film de Valérie Donzelli que je n’avais jamais vu. Parce que Donzelli, ça a ce petit goût d’autrefois. Et puis il y a cette chanson de Dominique A et Françoise Breut dont je n’ai quasiment pas oublié et que je chante alors. 1995.
Surtout j’ai atteint le point où le désordre de mon bureau est devenu insupportable. Je fais place nette, autant que faire se peut. Sur le plateau de bois l’encre noire d’un feutre japonais s’est vidée discrètement. Et puis il y a ces petits machins qu’on ne sait pas où ranger.
Mercredi 4 février 2026
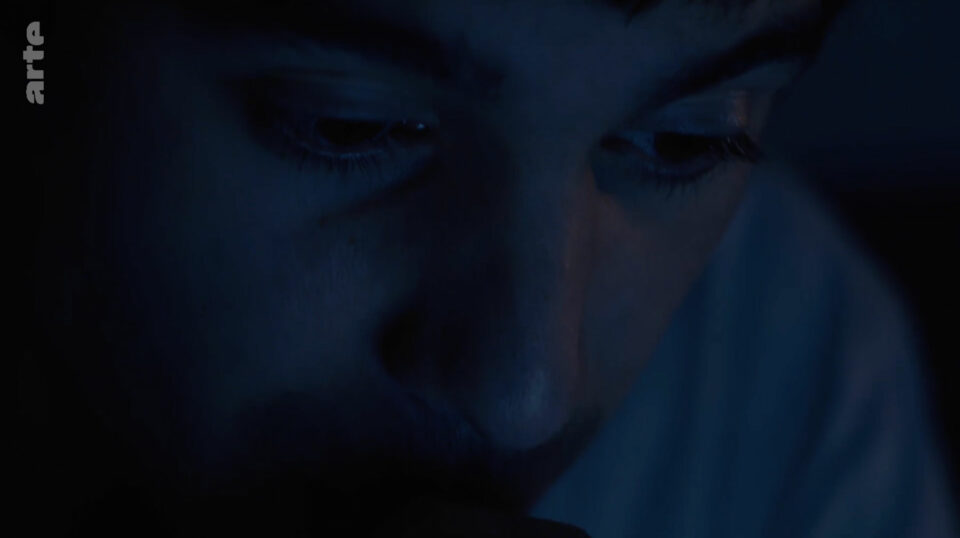
Mardi 27 janvier 2026

Je ne sais pas qui tu peux être
Je ne sais pas qui tu espères
Je cherche toujours à te connaître
Et ton silence trouble mon silence
Je ne sais pas d’où vient le mensonge
Est-ce de ta voix qui se tait?
Les mondes où malgré moi je plonge
Sont comme un tunnel qui m’effraie
De ta distance à la mienne
On se perd bien trop souvent
Et chercher à te comprendre
C’est courir après le vent
Je ne sais pas pourquoi je reste
Dans une mer où je me noie
Je ne sais pas pourquoi je reste
Dans un air qui m’étouffera
Tu es le sang de ma blessure
Tu es le feu de ma brûlure
Tu es ma question sans réponse
Mon cri muet et mon silence
::: Françoise Hardy, La Question.
Mon journal est parfois comme cette chanson, en tant qu’il est un texte à plusieurs sens, tout dépend qui le lit. Et puis il y a des phrases qui, simplement – ou pas simplement – sont là parce qu’elles sont belles.
Cette chanson, c’est une autre histoire qui n’a pas existé.
Si je dis que cette chanson je pourrais la chanter pour parler de nous, là, en ce moment, je dis la vérité et je ne la dis pas.
Cette chanson c’est une de celles qu’on entendra à mes funérailles mais tu es le seul à qui j’en ai parlé. Je dis que la mort, il faut y penser quand c’est impensable, c’est beaucoup moins inquiétant. Il y aura une autre chanson qui remercie la vie, une autre chanson qui dit que demain est un autre jour, une autre qui parle d’amour. Un extrait du Requiem de Fauré, ce serait bien aussi. Il sera OK le DJ ?
Mais revenons au sens des mots, dans les chansons ou ici.
Qu’est-ce que tu as lu dans mes mots ? Qu’est-ce que as compris ? Est-ce que tu crois que j’ai menti en parlant de nous ? Est-ce que tu aurais aimé que je ne parle pas du tout de nous ? Est-ce que tu crois que je ne veux pas garder le plus joli de nous ? Est-ce que c’est un mensonge de ne pas tout dire ici ? Est-ce que tu crois que j’ai envie que celles et ceux qui lisent sachent précisément ce qui nous traverse et pourquoi ? Est-ce que c’est si simple que ça peut s’écrire ? Non. Sauf sur des dizaines voire des centaines de pages, un jour peut-être, ça pourrait même porter le nom d’une équation, mais à la fin on ne saurait pas forcément ce que pense l’auteur.
Mon journal est rempli de silences qu’il dit et ne dit pas. Mon journal est un peut-être. Ça ferait un joli épitaphe, ça : Peut-être.
Je suis myope, astigmate et presbyte. Mon écriture aussi. Je suis maladroit, j’ai des problèmes d’attention, d’organisation et de mémoire. Mon écriture aussi.
Dimanche 14 décembre 2025
Lundi 17 novembre 2025

Dimanche 16 novembre 2025
– Papa… Tu… tu es gay ?
– Pardon ?
– Est-ce que tu es homosexuel ?
– Drôle de question. Non, je n’suis pas homosexuel.
– Je… Je vais l’dire autrement. Est-ce qu’il t’est arrivé de… de coucher avec des hommes ?
– Oui. Ça fait de moi un homosexuel ?
::: Pascal Bonitzer ; Cherchez Hortense, 2012
Être là. Pour toi. Et pour toi s’il le faut, évidemment, évidemment. Parler de moi pourtant, d’abord. Trop sans doute.
Puis sur les vidéos il y a des arcs-en-ciel dans le désert. Dans mon esprit il y a des taches de couleur, immenses, je m’y accroche.
Vendredi 14 novembre 2025

Et je lis :“Souvent, l’universitaire qui signe un papier, la chroniqueuse qui critique un disque ou l’amoureux éconduit qui met des mots sur ses émotions n’écrivent pas simplement ce qu’ils pensent : ils écrivent pour savoir ce qu’ils pensent.”
C’est ça. Parfois j’écris pour savoir ce que je pense. Ou qui je suis. Ou bien ce que je vis. Pour savoir si j’aime, ou comment. Parfois donc je n’ai pas assez écrit. Parfois je ne me suis pas relu alors c’est comme si j’avais oublié.
Mais pas sur les films. Sur les films je n’écris pas. D’ailleurs celui-ci, je ne sais pas quoi en penser.
Lundi 10 novembre 2025

J’entre dans l’Utopia. J’aime sa terrasse lorsqu’il fait beau, avais-je écrit à Laurent, et puis j’avais rectifié : lorsqu’il ne pleut pas. Je savais la météo incertaine. Il ne pleut pas, mais il n’y a plus de place en terrasse.
Laurent et Jérôme viennent juste d’arriver. Laurent m’a exposé cet été, Villequiers, vous savez… Jérôme a dessiné la couverture du dernier roman de Laurent, Sling. Laurent est de passage. Jérôme non. Nous sommes un trio inédit.
Nous devions nous voir récemment avec Jérôme, mais la vie et la mort, ça déplace les moments. J’aime son travail, beaucoup, il le sait, je lui dis souvent, cette fois encore, deux fois nous avons dîné ensemble et il y a eu des hasards, dans les rues. En revanche je n’ai jamais lu le moindre livre de Laurent, allez savoir pourquoi, sauf quelques paragraphes de Sling dans le tram l’autre jour, mais c’est impossible de lire Sling dans le tram, chaque phrase exprime les corps nus, le désir ou l’acte sexuel. Je n’avais pas mis d’extrait ici. J’attendais surtout de vraiment ouvrir le livre, sans le regard du voisin. J’attendais un extrait qui ne frémirait pas, étrange pudeur.
Je te regarde, presque nu de la tête aux pieds, tandis que je me déshabille dans le vestiaire.
::: Laurent Herrou, Sling
Samedi 8 novembre 2025
« Un port, ce n’est pas tout à fait la province. »
In Muriel ou le Temps d’un retour, d’Alain Resnais
De peu, le voyage, 12 kilos et pas un de plus. Déjà je prépare cela, je réfléchis, je pense au poids du bagage vide, je cherche une solution, j’empile quelques tee-shirts, je mesure mes sacs à dos, je pèse aussi le pour et le contre. Sur les étagères — je tape d’abord le mot « étrangères » — je pointe les livres de poche. Proust ? Tu me dis que pour les chaussures de randonnée on en empruntera, vous faites souvent ainsi, entre vous : tu as des solutions qui ne sont pas mes habitudes, ça me bouscule et tu le sais, déjà tu me connais, mais tu ne dis rien.
Je me demande quel sens a, cette fois, le verbe partir.
Je me demande ce que je vais faire, là-bas, d’être là-bas.
Jeudi 6 novembre 2025

Mercredi 5 novembre 2025
Les paramètres machine retrouvent une pression entre quatre et 10 à 8 cm d'eau à 90 percentiles, des fuites à 18/min, une observance à 7 heures, un index d'apnées hypopnées résiduel à 1/h.
Le chat miaule à la porte. Tu lui ouvres. C’est ici que tu vis à présent, oh tu as juste déménagé de quelques dizaines de mètres, tu voulais regarder le sud. Le lit est face à la baie vitrée, ainsi tu y vois la lumière, le jardin, même depuis là.

Lundi 6 octobre 2025
C’est vous qui travaillez à Neurocampus ?, me demande le caissier. Je le regarde, souris, j’avais un peu oublié son visage comme j’avais oublié de raconter ça ici ou à mes collègues. Lui il se souvient de moi, j’avais un tote-bag estampillé alors il m’avait demandé dans quel labo je travaillais, il allait passer des entretiens, il espérait être embauché, ça se voyait dans ses yeux qu’il l’espérait vraiment. J’ai été embauché, dit-il en souriant.

Samedi 4 octobre 2025
Le laurier et le gros olivier, trois bouteilles, les deux hortensias, une et demie, et pour le citronnier, le maximum. De l’eau dans une bouteille en plastique, plus ou moins une par pot, j’arrose à la simple flotte municipale faute d’avoir trouvé l’additif à diluer. C’est bleu, en poudre, dans le placard, dans une verrine, m’a écrit Sirius au téléphone. J’ai pensé un produit chimique avec le sucre et les nouilles, bienvenue chez les demeurés et l’ai cherché en vain.
::: Maria Pourchet ; Tressaillir
L’homme assis sur la chaise rouge lit un extrait du livre. L’homme est Olivier Mony, journaliste littéraire, il présente la rentrée, sa rentrée, il dit le monde du livre, des livres, ceux de littérature générale, il en a choisi six. L’extrait provient de Tressaillir, pris au hasard : Olivier Mony veut nous faire prendre conscience de la vitesse de l’écriture de Maria Pourchet. Une fois les guillemets fermés, il évoque un détail dans le texte : la précision d’un numéro de place, dans le train. Il parle du style de l’autrice. Il parle de l’ancrage dans le réel par un simple numéro.
C’est comme le numéro du TGV inoui 8421 du 21 avril 2019, dans ce journal et dans Présence. Olivier Steiner avait relevé ça, le numéro du train. Il avait dit ça, aussi, l’ancrage dans le réel.
Alors, une fois la rencontre terminée, je vais le voir, Olivier Mony. Je lui dis que ce qu’il a dit, ça évoque mon style. Je lui dis que peut-être. Je lui dis que je serais ravi de. Je ne veux l’encombrer, mais j’en ai un exemplaire. Dans mon sac.

Vendredi 3 octobre 2025
Vendredi 26 septembre 2025
::: Paul Thomas Anderson ; Punch-Drunk Love, 2002
Mardi 23 septembre 2025
Film : La femme de mon frère, Monia Chokri, 2019
Samedi 30 août 2025
– Papa, est-ce qu’on ne peut connaître que la moitié de la vérité ?
– Quoi ? Je ne comprends pas.
– Je ne peux voir que ce qui est devant moi, pas ce qui est derrière. Je ne peux donc connaître que la moitié de la vérité, n’est-ce pas ?
::: Edward Yang ; Yi Yi, 2000
– Vous voulez qu’on aille boire un café ?
– Oui.
– Parce que j’ai une heure à perdre alors si vous voulez, je peux vous faire visiter la ville sans bouger.
::: Ingrid Gogny ; Rouen, cinq minutes d’arrêt, 2001
– … Et puis finalement j’ai appelé chez lui. Il était en train de manger de la confiture de sa grand-mère et là il m’a dit « Ah non oh la la j’peux pas venir, c’est trop bon »
– Non tu t’fous de moi.
– Non non j’te jure c’est vrai.
– Attends mais c’est un con.
::: Valérie Mréjen ; La Défaite du rouge-gorge, 2000
Vendredi 22 août 2025
Dimanche 17 août 2025
A présent tu vis ailleurs, en ce pays qui a été le mien. Lorsque nous l’évoquons, c’est soudain le lac Chuzenji qui apparait. Pour moi, il était sous la brume d’automne et il reste tant d’images que je n’ai pas montrées. Toi aussi tu as connu la maison où l’Histoire fait encore craquer les planchers, toi non plus tu n’étais pas seul. Tu souris, malicieux.

Samedi 16 août 2025
::: Jonathan Glazer ; Sexy Beast, 2000
Lundi 11 août 2025
Lundi 4 août 2025

Ce sont les vacances, mais ce ne sont pas les vacances. J’ai tant à faire ! Surtout, regarder le passé et chercher des images pour en faire quelque chose. On m’attend. Ou j’attends qu’on m’attende. Il y a tant à en faire de toutes ces photos, ou peut-être est-ce trop tard. Parfois je les ai oubliées. J’oscille alors entre l’épuisement et l’enthousiasme. Entre la certitude et le doute. Qu’est-ce que ça vaut, tout ça ?
Lundi 28 juillet 2025
Dimanche 6 juillet 2025
Mardi 1er juillet 2025
Jeudi 26 juin 2025
Mercredi 25 juin 2025

Confinement. Annulation. Demain dès l’aube, je ne partirai pas, la douleur me retient.
Partir, cela commence à prendre un autre sens : faudra-t-il, un jour, déménager ? Dans un an ou deux ? Faut-il prendre les devants ?
Alors je regarde autrement l’appartement, je jette un œil aux livres, je retrouve l’un d’eux. J’ai le souvenir du jour où je l’ai acheté mais j’ai beau en avoir noté un extrait – les premières phrases – ici, je sais que je ne l’ai pas lu en entier. Je ne sais pourquoi il m’a, alors, comme échappé. Le livre, c’est L’absence est une femme au cheveux noirs, d’Emilienne Malfatto et Rafael Roa.
Je vais devant chez moi, ce n’est pas chez moi, c’est la coursive où j’ai mis une table, deux chaises, je m’assieds, il y a de la musique qui sort d’un téléviseur, ça vient du 2e, rideaux fermés, fenêtre ouverte, c’est peut-être encore ce couple d’hommes qui y loge. La fenêtre du voisin en-dessous de chez moi est aussi ouverte. Je souris de notre point commun à tous. La musique, c’est l’Ave Maria de Schubert. Les voix, ensuite, celles du téléviseur, parlent espagnol.
Les mots du livre pourtant cette fois me happent. Pourtant, c’est-à-dire contrairement à l’autre fois. Pourtant, c’est-à-dire malgré le son qui vient d’un téléviseur. La douleur aussi me happe, celle de la narratrice, celle des « Rouges », morts sous les balles ou dans l’océan, l’Amérique du Sud, une dictature parmi d’autres.
Alors je repense au livre qui attend, à mes pas dans les rues de Santiago, aux mots sur les murs, qui ne veulent ni pardonner ni oublier.
Parfois la douleur, la mienne, « ça me lance« , je dis. Mais : « Tu n’as pas perdu ton humour » quand je plaisantais avec toi au téléphone un peu plus tôt. Tu n’avais pas fait exprès de m’appeler. Je crois que j’aurais préféré que tu mentes.
(…) et elle ramène derrière l’oreilke une mèche de cheveux
qu’elle porte très noirs
parce qu’elle a voulu garder le même visage
malgré les années
pour que le frère disparu puisse la reconnaître
dans la foule
si un jour il revient
Mardi 24 juin 2025
Lundi 23 juin 2025
Dimanche 22 juin 2025

Tu m’as pris en photo ?, me demandes-tu. Oui. C’est la première fois. Oui, je te réponds, des photos floues ; sauf celle de tes mains. Je te les montre, un peu gêné, comme si ça n’était pas nous, ça, ce moment.
La photographie a, je crois, définitivement changé de rythme. Elle est autrement là, elle ne me manque pas au quotidien. Elle est dans ma tête, elle est sur l’image envoyée par Laurent, ma photographie accrochée sur un mur de briques au Château de Villequiers en attendant, jeudi, le vernissage. Elle est dans des projets différents, dans une temporalité reposante. Elle est toujours dans le passé : il faudrait peut-être toutes, mieux les regarder.
Samedi 21 juin 2025

C’est l’été, c’est dans le titre du film, c’est la fête du bruit et de la foule, derrière les murs et mes fenêtres ça boum-boum. Sur mon écran je m’attelle, enfin, à ce projet depuis longtemps dans ma tête, qui s’est appelé / pourrait s’appeler / ne s’appellera probablement pas Love Letters ou Abécadaire amoureux. Le Mausolée des Amants ? C’est déjà pris. Alors, je cherche dans mon journal des images et des mots. J’y pioche surtout le doute.
Vendredi 20 juin 2025

Elle est retrouvée !
— Quoi ? — L’Éternité.
C’est la mer mêlée
Au soleil.
Il est 0h34, il y a ces vers de Rimbaud dans le livre de Marie-Hélène Lafon, j’ai déjà lu ces lignes plus tôt, j’étais dehors, il était peut-être 13h10, il faisait chaud, je buvais mon café. Je les relis.
Mon pied est encore enflé, légèrement endolori, quatrième jour de goutte, ce n’est plus l’atrocité d’hier matin — c’était encore la nuit, pas encore 5 heures — parfois je l’oublie. Les 30mg de cortisone du matin sont loin. Je repense au cahier de la rhumatologue, marqué de petits languettes multicolores ; elle l’a sorti d’un tiroir, l’a ouvert pour vérifier la posologie. « Oui c’est ça », elle a dit.
« C’est la mer mêlée » me fait penser aux mots de Duras dont je n’ai toujours rien fait. C’est dans un coin de ma tête, c’est dans quelques brouillons, ça viendra.
Aujourd’hui je suis resté seul. Je ne suis pas sorti : marcher est pénible, par moments douloureux. J’ai travaillé, étonnamment peu distrait, mais parfois c’était un effort. J’ai travaillé jusqu’à 22 heures. C’est ensuite que j’ai ouvert les fenêtres.
J’ai envie de raconter la solitude, celle d’aujourd’hui, sans poids, juste là. Mais je ne sais pas quoi en dire. Elle est dans des silences rompus par un bonjour à la voisine à peu près lors des secondes rimbaldiennes et par des coups de fil professionnels ce matin. Bien sûr aussi je parle seul parfois. Je m’appelle par mon prénom ou mon nom. Ça me rappelle mon père : « C’est Rodriguez », il disait au téléphone. Les hommes, au bureau, ils étaient un nom de famille.
Lundi 16 juin 2025
Mardi 10 juin 2025
Lundi 9 juin 2025
Samedi 7 juin 2025

Au moment où j’écris ces lignes, mon récit est achevé. Tout est en ordre autour de moi et j’ai accompli la dernière tâche que je m’étais donnée. Cela ne m’a demandé qu’un mois, qui a peut-être été le plus heureux de ma vie. Je ne comprends pas cela : après tout, ce dont je me souvenais n’était que cette existence étrange qui ne m’a pas dispensé beaucoup de bonheur. Y a-t-il dans le travail de la mémoire une satisfaction qui se nourrit d’elle-même et ce dont on se souvient compte-t-il moins que l’activité de se souvenir ? Voilà encore une question qui restera sans réponse : il me semble que je ne suis faite que de cela.
::: Jacqueline Harpman ; Moi qui n’ai pas connu les hommes
C’est ton message d’abord, il est tôt, l’œil à peine ouvert lorsque je le découvre. Je dormais encore lorsque tu m’as écrit. C’est inédit, n’est-ce-pas ? Je ne crois pas que tu m’aies déjà ainsi attendu un matin. Celui de ce jour, alors, glisse ensemble jusqu’à cette habitude que nous avons, déjà évoquée ici, la terrasse de la Mère Michel, un verre, un déjeuner, bien sûr des frites. Ton amie E nous rejoint. Je ne la connais pas. Tu existes, depuis des mois, sans tous ces gens dont tu me parles. J’existe pour toi, depuis des mois, sans tous ces gens dont je te parle. Samedi dernier, tout a changé, peut-être : tu as rencontré P, j’ai rencontré C. Ce fut bref. C’était le signe de quoi ? Que nous pouv(i)ons être autre chose ? Ou que nous ne pouv(i)ons pas être autre chose ?
Ce sont des phrases, ensuite, festival Chahuts. Des phrases fantômes, de celles qui vous hantent, collectées. Je retrouve l’initiateur de ce projet, Lancelin Hamelot. Nous nous sommes rencontrés le 21 mai, je suis venu lui offrir Présence, nous parlons un peu, il m’offre un café ; je perçois qu’il est de ces hommes – c’est l’adjectif délicat qui me vient, mais ça n’est pas ça, ou pas que ça – dont j’aimerais être ami.
Et puis c’est une expo, Thibault Franc, j’aime. Un homme s’approche, me sourit : « Vous n’êtes jamais venu. » Il a raison.
Ce sont tes mots, ensuite. Et aussi, les siens, ceux d’E à propos de moi ou de nous, que tu répètes, auxquels tu réponds, ce genre de paroles qui bousculent à la fois les certitudes et les incertitudes. J’aurais pu ne parler que de cela, exergue. J’aurais aimé me rappeler chaque mot. Ce sont des moments dont on fait des films, tu ne crois pas ?
C’est un livre, enfin. Un livre que Parthiban m’offre, cadeau d’anniversaire, comme ça, là, au milieu de la rue, quelques minutes après s’être retrouvés. C’est l’un des livres dont m’a parlé O, mercredi. J’en suis sûr. Le titre, c’est celui-là, je ne peux pas me tromper. La coïncidence me trouble. Je ne sais pas encore que je vais adorer : le soir, trente pages. Je ne sais pas encore que je me suis trompé : O ne m’en a jamais parlé.
Vendredi 6 juin 2025
Mercredi 16 avril 2025
Mardi 15 avril 2025
Décollage. Fin. Cinq petits jours à Kyoto, folie inordinaire et salvatrice ; j’ai laissé au rebut l’idée que plus jamais je ne prendrais l’avion, vois-tu, j’ai mis dans la balance la folie des hommes, la fatalité, la raison et la déraison.
Sur le petit écran du vol AY0068 qui me ramène en France via Helsinki, je regarde le Magicien d’Oz : c’était comme un moment au-delà de l’arc-en-ciel, ces jours. A côté de moi un couple silencieux, pas un mot entre eux il me semble. De tout le vol, pas un mot ?
Depuis jeudi, j’ai rempli des pages, j’ai amassé des images qu’ici je ne montre pas. J’ai regardé qui j’étais, qui je pouvais être, comment j’aimerais être demain. J’ai aussi compris que ce pays pouvait être autre chose, avec ma propre place, parce que toujours il y a la présence de celui qui m’a amené ici, permis de vivre ici. Hier, à la VK, j’étais encore celui qui a été, l’ex de l’ex. En descendant ensuite le petit chemin avec Charlotte et June, en parlant de moi, j’allais sans doute vers autre chose. Il fallait sûrement ce moment un peu gênant au milieu du béton et des visages. Alors mardi prochain, pendant les 30 minutes de consultation avec Mme M, assis sur le canapé de velours vert, j’aurais sans doute une réponse à la question de la dernière fois.
//

Mercredi 9 avril 2025
Vendredi 4 avril 2025
Dimanche 30 mars 2025
Vendredi 28 mars 2025
Alors, je lis les 3 lignes que j’ai écrites, et tous, ils rient.

Je suis un malade mental. Il m’est difficile de dire depuis combien de temps, vingt ans, peut-être trente, certainement huit, depuis qu’un diagnostic a été posé.
::: Nicolas Demorand ; Intérieur nuit
Jeudi 27 mars 2025
Il est tard, 22h33, à peine rentré chez moi. Le travail m’a emmené du côté de l’IA, d’une conférence menée tambour battant, d’un buffet aux rares convives. Ce sera quoi, demain, la santé avec l’IA ?
Et ce sera quoi, demain, mon travail ? C’est une question, j’ai 50 ans, je veux faire quoi quand je s’rai grand ? C’est ainsi que de 14h à 15h30, j’ai parlé de moi. On verra. Demain est une incertitude. Aujourd’hui tout autant. Décider est parfois une impossibilité, une montagne à franchir.
Bref, il est 22h33 et je me dis que je regarderais volontiers un film. J’allume lacinetek et le bonheur m’envahit. Le sommeil, bientôt, aussi.

Dimanche 23 mars 2025
Samedi 22 mars 2025
Dimanche 16 mars 2025
Alors, les doutes d’hier font naître dans mon esprit d’autres images, un autre récit. Au matin j’écris à Frédéric : « Je pense que je vais en monter un autre avec quelque chose de moins intime. Avec d’autres photos. Pouvant être projeté sans voix par exemple. »
Il est alors tard quand ce sont d’autres images qui s’imposent sur l’écran : Soudain l’été dernier. J’aimerais te dire ce que ce film est pour moi. Demain peut-être, si tu me réponds. Avec une poignée d’autres, il a ouvert mon chemin vers le cinéma, j’avais peut-être dix-huit ans, peut-être vingt, peut-être plus, et dans le salon, chez mes parents, la nuit tombée et tout le monde endormi, je découvrais Une Femme sous influence, Un Tramway nommé désir ou encore, donc, Soudain l’été dernier. Depuis, je ne l’avais jamais revu. Il était un phare, une référence ni très nette ni très floue. Je ne sais plus exactement ce qui m’a marqué dans ce film, si ce n’est ce « quelque chose », qu’ont les grands films et qu’alors j’ignorais. J’avais peur de le revoir. Depuis des jours, j’hésitais. J’avais peur de voir quelque chose s’effondrer. Quelque chose de ma jeunesse peut-être. Ou bien la faire ressurgir ? Confusion.
Ce soir, en le regardant, je suis resté ébahi devant les quasi vingt minutes où le Dr Cukrowicz se rend chez Violetta. Happé. Happé par des fractions de secondes qui s’étirent et me font oublier le sommeil.
Mardi 11 mars 2025
Alors tu es quelque part sur l’écran, quelque part dans ce petit garçon, sans comparaison cependant. Je ne sais pas ton enfance, pas cette partie de ton enfance. Elle n’était pas là entre nous, je ne sais pas où elle était en toi. Je sais juste quelques images de toi. Peut-être voulais-tu l’oublier comme on veut tous oublier ces recoins de nous ; ce sont des étendues parfois.

Jeudi 27 février 2025
Mercredi 26 février 2025
Lundi 24 février 2025
Dimanche 23 février 2025
Vendredi 24 janvier 2025
Mardi 21 janvier 2025

Comment perçois-tu mes silences ? Comment les entends-tu ? Ceux qui se glissent entre tes phrases ? Moi-même, je ne les aime pas, je ne sais pas d’où ils viennent et je ne les aime pas, ils m’ennuient tout comme ils donnent l’impression que je m’ennuie ou que tu m’ennuies, je n’aime pas celui que je suis dans ces silences, empêtré.
Dimanche 19 janvier 2025
Vendredi 10 janvier 2025
Mardi 31 décembre 2024
Pleurer le matin, pleurer le soir, entre les deux rien de cela, regarder maintenant, regarder devant, regarder demain, relever les manches et les défis, vivre en ce jour des instants que je dis inédits, faits de petits plaisirs et de sourires idiots ou immenses, d’achats basiques, d’un petit vase danois, d’une note de poissonnier salée, des sequins de vingt heures trente, d’un « Je te serre fort » qui finit notre année.
Je traverse minuit seul, moment voulu et nécessaire pour être bien avec moi-même et avec vous deux, sans vous deux. J’aime vivre ainsi ces moments de la vie où l’on regarde la pendule en se disant « Voilà », apaisé, sans regards, pas même le mien dans un miroir. J’aime quelque part les rendre, ces moments, ces virages du temps, à la banalité de ce qu’il sont, une fraction de seconde. Je préfère vivre pleinement d’autres heures imprévues que donner à ces rendez-vous obligatoires une présence malvenue. M’amuser, ce soir, aurait été malvenu, impossible. J’attends demain matin, j’attends mon renouveau. Alors je me ressers un verre, Pessac-Léognan, 2012. Dans la douceur de la nuit, quelques messages, je souris.